
Errò, « Collages »
« Le défaut de sens historique est la faute originelle de tous les philosophes ; […] tout est le produit d’une évolution ; il n’y a point de faits éternels : de même qu’il n’y a pas de vérités absolues »
Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, I, §2
L’histoire de la philosophie de l’art peut être interprétée comme une tentative sans cesse reconduite et réactualisée de définir son objet d’étude. L’art, au sens d’une sphère d’activités et d’objets distincte du reste des productions humaines, résiste en effet à une telle entreprise, en témoigne le nombre même des définitions qui ont été élaborées par le passé ainsi que les débats et controverses qu’elles ont suscitées et suscitent encore. On pourrait se résigner, abandonner l’idée de pouvoir un jour énoncer une définition adéquate, une définition qui permette de rendre compte de la réalité riche et plurielle de l’art sans la mutiler arbitrairement. Si l’on se décide à l’inverse à affronter cette difficulté, à tenter le geste définitionnel tout en cernant précisément ce qui lui fait obstacle, un double problème surgit : il faut d’une part que notre définition n’exclue aucune réalité artistique, qu’elle recouvre l’ensemble de ce que l’on reconnaît à un moment donné comme étant de l’art (et ce sans se contenter de n’être qu’une « théorie-emballage » [1], selon la formule de Richard Shusterman, théorie-emballage qui finalement n’énonce plus grand-chose de ce qu’est l’art dans sa réalité concrète), et d’autre part qu’elle prenne en compte la dimension historique, évolutive et mouvante, de l’art, sous peine d’être caduque de se voir réfutée à la première innovation artistique.
C’est cette double exigence que nous essaierons de tenir dans cet article, en insistant tout particulièrement sur la dimension historique de l’idée d’un concept d’art comme « ouvert » ou « en faisceau », telle qu’elle a été développée par Morris Weitz et Berys Gaut. Cela nous amènera à reconsidérer la notion même de définition, lorsque l’on cherche à l’appliquer à une réalité particulière comme peut l’être l’art.
Dans son fameux article de 1956, « Le rôle de la théorie en esthétique » [2], Morris Weitz soutient que la « tâche première de l’esthétique[3] n’est pas de chercher une théorie mais d’élucider le concept d’art. Plus précisément, elle est de décrire les conditions sous lesquelles nous employons directement ce concept »[4]. Par « théorie », Weitz entend la formulation d’une définition de l’art en termes de conditions ou de « propriétés nécessaires et suffisantes »[5], définition qui « vise à être une affirmation vraie ou fausse quant à l’essence de l’art, à ce qui le distingue de toute autre chose ». Or, si la recherche d’une théorie ne peut être le but premier de l’esthétique ou de la philosophie de l’art, c’est selon Weitz parce qu’une telle théorie est impossible, et ce d’un point de vue logique, à trouver :
En pensant qu’une théorie correcte est possible, la théorie esthétique – toute entière – est erronée dans son principe parce qu’elle mésinterprète radicalement la logique du concept d’art. sa thèse principale : que l’« art » est susceptible d’une définition réelle ou de quelque genre de définition vraie, est fausse. Sa tentative de découvrir les propriétés nécessaires et suffisantes de l’art est logiquement mal venue pour la très simple raison qu’un tel ensemble de propriétés et, par conséquent, une telle formule à son sujet, ne verront jamais le jour. L’art, comme le montre la logique du concept, ne possède pas d’ensemble de propriétés nécessaires et suffisantes ; c’est pourquoi une théorie de l’art est logiquement impossible et non pas simplement difficile en fait. La théorie esthétique essaie de définir ce qui ne peut pas être défini dans le sens qu’elle invoque.[6]

Morris Weitz
On peut en effet imaginer que, s’il s’agissait d’une simple difficulté de fait, les efforts soutenus de générations d’esthéticiens et de philosophes de l’art en seraient finalement venu à bout, ou tout du moins que l’on pourrait constater un certain progrès dans la direction de la définition de l’art, qu’une certaine unanimité se serait faite autour de la définition la plus complète, la plus exhaustive, la plus avancée, celle qui aurait accumulé le plus de propriétés nécessaires et suffisantes. Or, force est de constater avec Weitz qu’aujourd’hui comme dans les années cinquante, « nous ne semblons pas plus près du but aujourd’hui qu’on ne l’était au temps de Platon »[7].
Cette impossibilité d’ordre logique à définir le concept d’art tient selon Weitz à la nature singulière, mais partagée avec d’autres types de réalités, de celui-ci. Adoptant une démarche inspirée de celle de Wittgenstein, Weitz laisse en effet de côté la traditionnelle question à laquelle les différentes théories esthétiques tentent de répondre (« “Qu’est-ce que l’art ?” »[8]), au profit de la question : « “De quelle sorte est le concept ‘art’ ?” ». Et, à l’instar du concept de jeu analysé par Wittgenstein[9], le concept d’art se révèle être un concept fondamentalement ouvert, c’est-à-dire que :
ce que nous trouvons, ce ne sont pas des propriétés nécessaires et suffisantes, mais seulement un “réseau compliqué de similitudes qui se chevauchent et s’entrecroisent”, de telle sorte nous pouvons dire des jeux [et des arts] qu’ils constituent une famille, avec des ressemblances de familles et sans trait commun.[10]
Ainsi, si l’on use du même concept d’art lorsque l’on se réfère à des réalités aussi diverses qu’un concerto, un tableau, une sculpture, une installation ou une pièce de théâtre, ce n’est pas parce qu’ils partagent tous un même ensemble déterminé et clos de propriétés nécessaires et suffisantes que l’on pourrait lister ; c’est parce que le tableau et l’installation partagent telle propriété A, le concerto et le tableau telle propriété B, la pièce de théâtre et l’installation telle propriété C, et ainsi de suite, en une trame ou un réseau étendu et varié mais présentant une certaine continuité et une certaine unité, unité qui fait que l’on regroupe bien toutes ces réalités sous le même concept d’art, chaque propriété étant partagée par un ensemble plus ou moins grand de réalités, chaque réalité présentant un plus ou moins grand nombre de propriétés partagées par d’autres. Si l’on se demande sous quelles conditions l’énoncé « X est une œuvre d’art » est correct, il faut donc répondre de la manière suivante :
Il n’y a pas de conditions nécessaires et suffisantes, mais il y a les conditions qui consistent en plages de similitudes, c’est-à-dire des faisceaux de propriétés dont aucune ne doit être présente, mais dont la plupart le sont, quand nous décrivons des choses comme œuvres d’art. J’appellerai ces conditions les « critères de reconnaissance » des œuvres d’art. Toutes ces conditions ont fonctionné comme critère déterminants dans les diverses théories traditionnelles de l’art ; aussi nous sont-elles déjà familières[11].
Ainsi, pour Weitz, « savoir ce qu’est l’art n’est pas saisir une essence manifeste ou latente, mais être capable de reconnaître, de décrire et d’expliquer ces choses que nous appelons “art” en vertu de ces similitudes »[12].

Nelson Goodman, « Langages de l’art » (Fayard/Pluriel, 2011)
Une autre manière possible d’appréhender ces « faisceaux de propriétés » est de les considérer comme des symptômes de l’artisticité, c’est-à-dire du fait que l’on reconnaisse le caractère artistique d’une réalité, d’un objet ou d’une pratique, au sens où, dans Langages de l’art, Nelson Goodman parle de « symptômes de l’esthétique »[13]. Si nous faisons nôtres ses propos et les déplaçons de la problématique de l’expérience esthétique à celle (qui ne la recouvre pas tout à fait) de l’artisticité et de la définition du concept d’art, nous pouvons dire qu’un symptôme « n’est une condition ni nécessaire ni suffisante pour [l’artisticité d’un objet ou d’une pratique], mais [qu’] il tend simplement à y être présent en conjonction avec d’autres symptômes du même genre »[14]. D’une part, ces symptômes peuvent être « conjonctivement suffisants »[15], c’est-à-dire que si, dans notre perspective, un objet ou une pratique les présente ou les manifeste tous, il est presque certain qu’il s’agisse d’une œuvre d’art ou d’un art. Il n’est certes peut-être pas possible d’établir une liste des symptômes qui font qu’une réalité est reconnue comme artistique, à la manière dont Goodman dégage, quant à lui, quatre symptômes de l’esthétique. Toutefois, plus cette réalité présente de symptômes, plus il est probable qu’elle soit reconnue comme étant artistique. Pour reprendre la terminologie wittgensteinienne utilisée par Weitz, plus une réalité présente de propriétés partagées avec les membres de la famille « art », plus elle est susceptible d’être reconnue comme appartenant à celle-ci. D’autre part, les symptômes tels qu’ils sont pensés par Goodman sont « disjonctivement nécessaires »[16], c’est-à-dire que l’objet ou la pratique doit en présenter au moins un pour qu’il puisse s’agir d’une pratique artistique ou d’une œuvre d’art ; si elle ne partage aucune propriété avec aucun membre reconnu de la famille « art », un objet ou une pratique ne sera pas reconnu comme faisant partie de cette famille, dans la mesure où aucune ressemblance n’y invite.
Dans la lignée des réflexions de Weitz et de son approche wittgensteinienne, Berys Gaut caractérise l’art comme un « concept en faisceau » (cluster concept)[17]. Il vise par cette nouvelle formulation à clarifier la position de Weitz quant à l’idée d’un concept d’art « ouvert », à résoudre certaines de ses difficultés et à répondre aux objections qu’elle a pu susciter.
Gaut réfute en particulier l’interprétation de l’ouverture du concept d’art sur le modèle de la ressemblance à des œuvres ou à des pratiques reconnus et consacrés qui feraient office de « paradigmes » à partir desquels on peut déterminer, par ressemblance donc, si d’autres pratiques ou objets sont artistiques. Ce qu’il nomme l’« interprétation de la ressemblance au paradigme » (resemblance-to-paradigm construal)[18] est selon lui une caractérisation erronée de l’art et qui a été rejeté avec raison, d’une part parce qu’elle ne dit pas « quels objets sont des œuvres paradigmatiques »[19], d’autre part parce que « la notion de ressemblance est suffisamment vide (n’importe quoi ressemble à n’importe quoi d’une manière ou d’une autre, puisqu’il partage avec celui-ci quelque propriété) pour que la caractérisation compte n’importe quoi comme art ». C’est à cette interprétation de la position de Weitz que Gaut oppose l’interprétation du concept en faisceau.
Selon Berys Gaut, et le rapprochement peut aisément être fait avec les symptômes goodmaniens, il n’y a pas de propriété ou de critère en tant que tel et par soi nécessaire ni suffisant pour qu’un objet puisse être subsumé sous un concept ouvert. Ainsi, il y a bien des critères, des facteurs ou des propriétés qui font que certains objets ou certaines pratiques sont reconnus comme étant artistiques (Gaut en propose une liste, mais souligne que celle-ci peut être discutée et modifiée : par exemple « posséder des propriétés esthétiques positives », « être formellement complexe et cohérent », « être un artefact ou une performance qui est le produit d’un haut degré de savoir-faire [skill] », etc.[20]). Si un objet ou une pratique présentent l’ensemble de ces propriétés, il ou elle est artistique (se pose toutefois la question de savoir s’il est possible d’établir la liste complète de ces propriétés, nous y reviendrons). Et l’objet ou la pratique n’a pas besoin de présenter toutes les propriétés pour être reconnu comme artistique. Par ailleurs, « il n’y a pas de propriétés individuellement nécessaires pour que les objets tombent sous le concept : c’est-à-dire qu’il n’y a pas de propriété que tous les objets tombant sous le concept [ouvert d’art] doivent posséder »[21]. Et le nombre minimum de critères requis pour qu’un objet tombe sous le concept est indéterminé[22].
Il est un point précis sur lequel Gaut prend ses distances par rapport Morris Weitz, celui de l’artefactualité. Selon celui-ci :
Aucun des critères de reconnaissance n’est un critère déterminant, nécessaire ou suffisant, parce que nous pouvons parfois affirmer de quelque chose que c’est une œuvre d’art et continuer à lui dénier n’importe laquelle de ces conditions, y compris celle que l’on a traditionnellement considérée comme fondamentale, à savoir être un artefact.[23]
Et Weitz justifie sa position en prenant comme exemple l’énoncé suivant : « Ce morceau de bois de dérive est une ravissante sculpture »[24]. Une première objection que nous pouvons émettre, dans le cas où l’on dirait cela d’un morceau de bois que l’on verrait, par exemple, échoué sur une plage, est qu’il semble s’agir plutôt d’un usage métaphorique du terme « art » : on voudrait très probablement dans un tel cas dire que « ce morceau de bois de dérive est [comme] une ravissante sculpture », en fonction sans doute de qualités visuelles réelles, mais non pas qu’il est, au sens propre, une sculpture ou une œuvre d’art.

Berys Gaut
Une seconde objection, dans le cas où l’on prononcerait cette phrase à propos d’un morceau de bois de dérive trouvé et exposé dans une galerie ou un musée, est avancée par Berys Gaut lui-même : l’« art trouvé [found art] »[25] est « sélectionné, et la sélection est une action. La sélection ajoute au champ des propriétés qui peuvent être possédées par les objets, et ainsi les altère, même si ce n’est pas physiquement »[26]. Gaut reprend d’ailleurs l’exemple utilisé par Weitz du « bois de dérive » (driftwood), et en vient à affirmer que la forme du concept en faisceau :
requiert une modification. Une œuvre d’art est le produit d’une action, de manière prééminente d’un faire [making] (un artefact), ou d’un performer [performing] (une performance). Ce sont des œuvres d’art qui sont impliquées ici, puisque dans chaque cas quelque chose est fait. D’où le fait qu’être le produit d’une action est le genre de l’œuvre d’art et ainsi est une condition nécessaire pour que quelque chose soit de l’art.[27]
Dans la perspective qui est lui est propre et à partir du cas similaire d’une « pierre trouvée sur la plage […,] montée et exposée dans un musée d’art »[28], Nelson Goodman est lui-même amené à nuancer la distinction qu’il établit entre la réalisation ou la production d’une œuvre d’art et son « implémentation », notion qui inclut « tout ce qui permet à une œuvre de fonctionner »[29] en tant qu’œuvre d’art : l’ « implémentation, même lorsque la réalisation fait défaut, peut être elle-même productive »[30].
En effet, l’artefactualité peut apparaître, peut-être non pas comme une condition nécessaire d’une définition de l’art, d’une définition au sens donc d’une liste déterminée et finie de conditions nécessaires et suffisantes, en fonction desquelles une réalité est reconnue comme artistique, la particularité du concept d’art serait alors que l’artefactualité en est la seule condition nécessaire), mais plutôt comme le fondement (Weitz parle bien d’une condition que « l’on a traditionnellement considérée comme fondamentale »), au sens de « ce qui fait le fond, l’appui, la base »[31] de quelque chose, fondement préalable sur lequel émerge l’artisticité dans toute son ouverture, fondement partagé par l’art au sens restreint du terme avec l’ensemble des productions humaines, c’est-à-dire l’ « art » dans le sens le plus large que l’on puisse donner à ce terme et dont est tiré « artefact » , le sens d’« activité fabricatrice de l’homme »[32], de « travail humain en tant qu’il réalise des choses qui n’auraient pas existé par le simple jeu des forces naturelles ». L’art, au sens fort d’un domaine spécifique et que l’on peut distinguer du reste de l’activité humaine, est en quelque sorte fondé sur l’« art » au sens premier et large. L’artefact au sens large est ainsi, en quelque sorte, le corps de base qui manifeste (ou non) les symptômes de l’artisticité, même si bien entendu l’artefactualité en tant que telle, comme le souligne Gaut, « ne distingue pas les œuvres d’art de n’importe quels autres produits de l’action (la philosophie, les chaises, [etc.]) »[33]. Mais précisément, ce fondement commun permet dans une certaine mesure de décloisonner l’art compris comme sphère distincte de l’activité humaine, de mettre en valeur le fond commun sur lequel apparaissent les différences ainsi que la porosité des frontières entre art et non-art.
Enfin, le modèle du concept « en faisceau » tel que Berys Gaut le propose permet d’expliquer « pourquoi certaines activités (comme la gastronomie) semblent se situer quelque part près des frontières de l’art sans être clairement de l’art »[34], dans la mesure où elles possèdent un certain nombre des propriétés qui sont pertinentes pour tomber sous le concept d’art, mais où elles en manquent également. Selon Gaut, il s’agit là d’un avantage du concept en faisceau par rapport aux définitions en termes de conditions nécessaires et suffisantes, « qu’il puisse préserver la difficulté de tels cas, et nous permette d’expliquer ce qui les rend difficiles ; de tels cas peuvent être montrés comme étant authentiquement limites [borderline] et indéterminés »[35]. Or, comme il le souligne :
s’il y a des objets pour lesquels l’application du concept est authentiquement, de manière irrésoluble, indéterminée, alors l’interprétation [account] devrait refléter cela aussi, plutôt que de simplement stipuler que le concept s’applique, ou stipuler qu’il ne s’applique pas[36].
Il est en effet sans doute important, voire nécessaire, que la réflexion théorique et conceptuelle ne simplifie pas abusivement une réalité complexe, même pour les besoins de l’analyse, mais se donne les moyens de la penser dans sa complexité. En outre, comme l’exemple de la gastronomie le laisse entrevoir, si l’artisticité consiste en un faisceau de facteurs, de traits ou de symptômes, ceux-ci sont susceptibles d’être partagés avec des activités ou des objets qui ne sont pas considérés comme artistiques : mettre cela en évidence permet de décloisonner l’art, comme nous l’avons déjà évoqué, c’est-à-dire de penser ce qui est commun à l’art et au reste de l’activité ou de la vie humaine dans son ensemble, tout en encourageant à « une plus grande attention à la diversité des propriétés qui tendent à faire de quelque chose une œuvre d’art »[37], à regarder de près la réalité d’objets ou de pratiques dans toute sa complexité, et non pas à se borner à y rechercher quelques critères nécessaires et suffisants.
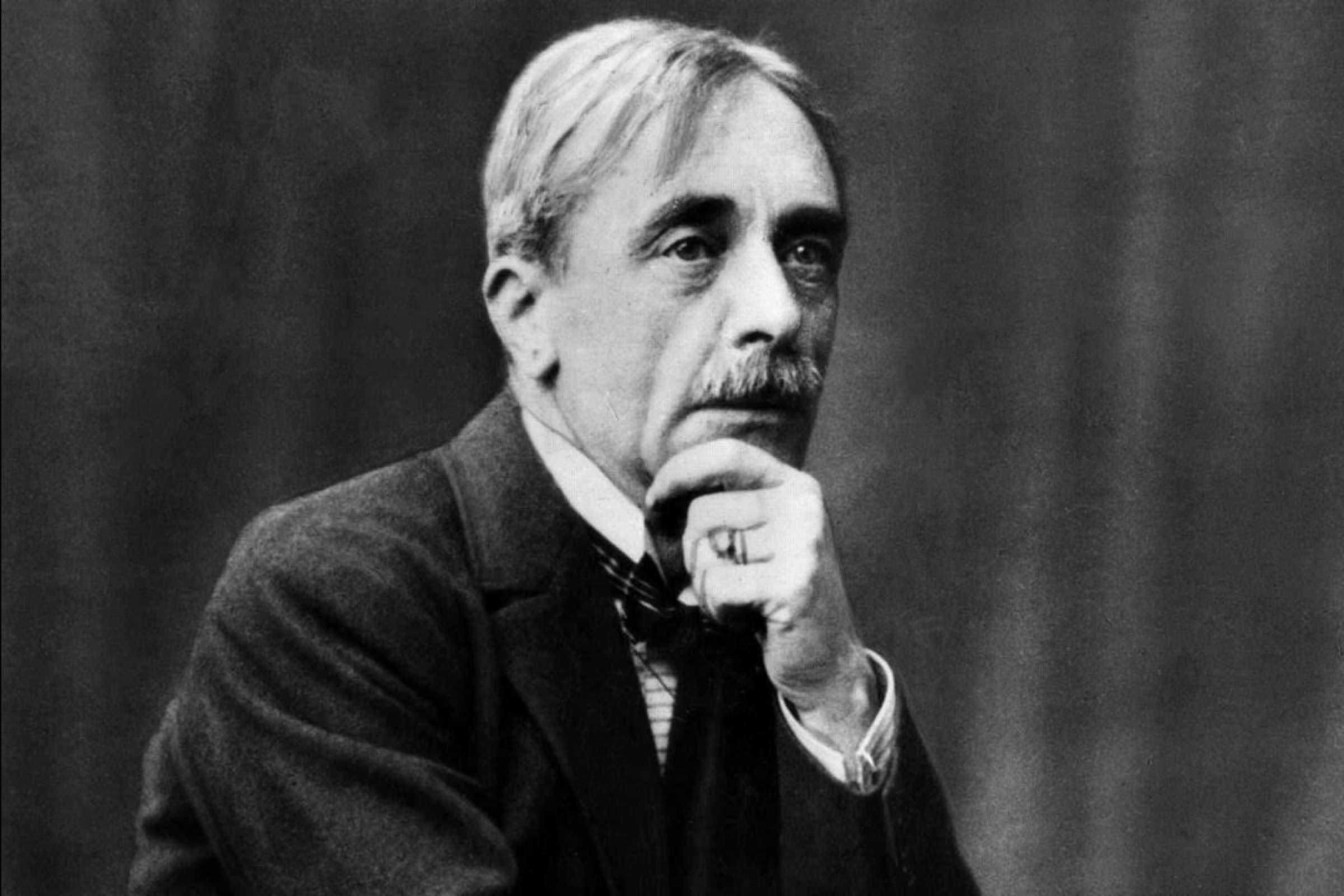
Paul Valéry
Néanmoins, l’idée d’un concept d’art ouvert ou en faisceau peut laisser craindre une sorte de dissolution du concept d’art, une dissolution de l’artisticité dans une multitude infinie de facteurs possibles, au sens où l’on pourrait avoir l’impression que toute propriété est en fin de compte susceptible d’être considérée comme un symptôme de l’artisticité. À cela, nous pouvons répondre qu’en regardant nos usages réels et concrets du concept d’art, il y a bien des caractéristiques ou des symptômes qui apparaissent comme pertinents (et d’autres qui le semblent moins voire pas du tout[38]) et sur lesquels se fonde (ou non), dans les usages empiriques, concrets et intersubjectifs, « la reconnaissance dont l’art est solidaire »[39]. Une théorie de l’art comme faisceau de facteurs ou de symptômes, en s’appuyant sur ces usages empiriques, peut ainsi, comme le souligne Berys Gaut, « formuler des affirmations substantielles en spécifiant quelles sont les propriétés qui sont pertinentes pour déterminer si quelque chose est de l’art »[40].
En outre, une mise en valeur des usages réels et partagés peut permettre d’éviter ce que nous pourrions nommer le « décisionnisme » de Morris Weitz, selon qui il y doit y avoir « une décision de la part de quelqu’un afin d’étendre ou de clore l’ancien concept, ou d’en inventer un nouveau »[41]. Il ne s’agit probablement pas, en général, d’une décision, ponctuelle et pour ainsi dire volontariste, prise par tel individu x en particulier, si légitime qu’il puisse paraître à la prendre (d’ailleurs, qui aurait cette légitimité ? Comment une telle décision serait-elle formulée ? Et comment assurer qu’elle soit largement acceptée ?), mais d’un ensemble d’usages intersubjectifs et partagés, avec leur histoire et leur évolution, qui, de manière moins explicite sûrement, aboutissent à la reconnaissance commune du caractère pleinement artistique d’une pratique.
Enfin, penser le concept d’art en termes d’un faisceau de facteurs ou de symptômes permet de penser et de mettre en valeur sa dimension historique et évolutive, dans la mesure où nous pouvons affirmer avec Nathalie Heinich et Roberta Shapiro qu’« il n’existe que des conceptions historiquement situées, relativement stabilisées et collectives, de ce que les acteurs entendent par “art” »[42] : au cours du temps, de nouveaux symptômes de l’artisticité, de ce que l’on considère comme de l’« art » au sens fort, peuvent apparaître (et peut-être aussi, à l’inverse, disparaître, c’est-à-dire ne plus être considérés comme des propriétés pertinentes de l’artisticité) qui s’ajoutent aux précédents et prennent leur place au sein du faisceau de symptômes[43], ce que permet difficilement de penser une définition d’essence de l’art en termes de conditions nécessaires et suffisantes figées. Cette « flexibilité », pour reprendre le terme de Berys Gaut[44], du concept ouvert ou en faisceau, permet ainsi de rendre compte du « caractère très expansif, aventureux de l’art, [de] ces changements incessants et ses nouvelles créations »[45], de rendre compte de la « dimension expérimentale, constructionnelle, contingente et ouverte des pratiques artistiques »[46], ainsi que de leur apparition et potentiellement aussi de leur disparition[47].

John Dewey
Nous pouvons même peut-être parler, en modifiant la formule de Paul Valéry qui parlait « d’un infini esthétique » [48], d’un infini artistique, mais bien compris : il ne s’agit pas de dire que ce qu’on appelle l’« art », au sens fort, n’a pas, à un temps t donné, de limites de fait, limites d’ailleurs probablement floues et poreuses, mais que ces limites sont historiquement constamment mouvantes et potentiellement toujours extensibles. Enfin, à l’échelle d’une pratique particulière, l’idée d’un faisceau de symptômes permet de rendre compte du « processus »[49]d’artification, de « transformation du non-art en art »[50], dans la mesure où une pratique peut présenter, au cours du temps, de nouveaux symptômes de l’artisticité, ce qui aboutira peut-être finalement à sa pleine reconnaissance comme art.
Ainsi, pour résumer et pour jouer sur l’ambivalence du préfixe latin de-, qui sert soit à appuyer et accentuer le sens d’un mot, soit au contraire à exprimer la cessation ou l’absence de ce sens, il vaut peut-être mieux, au lieu de vouloir définir l’art, c’est-à-dire le déterminer, le délimiter, reconnaître plutôt son caractère dé-fini, dé-limité, dé-terminé, reconnaître en un mot son ouverture. Cela ne vaut pas dire renoncer à la pensée et au concept, mais au contraire s’en servir comme d’un « instrument pour approcher le jeu changeant du matériau concret, et non de le fixer dans une rigide immobilité »[51], véritable fonction des concepts selon John Dewey. Loin d’être une solution simplement aporétique ou un renoncement facile face à la tentative de définir l’art, l’idée d’un concept « ouvert » ou « en faisceau » de l’art, en plus d’inviter à un respect de la réalité artistique, dans sa dimension complexe et évolutive, appelle à sans cesse recommencer à essayer de penser cette réalité.
© Georges Iliopoulos
Notes :
[1] Richard Shusterman, L’Art à l’état vif. La pensée pragmatiste et l’esthétique populaire, trad. Ch. Noille, Paris, Les Éditions de Minuit (« Le Sens commun »), 1992, p. 66.
[2] Morris Weitz, « Le rôle de la théorie en esthétique » [1955], dans Danielle Lories (éd. et trad.), Philosophie analytique et esthétique, Paris, Klincksieck (« Méridiens »), 1988, p. 27-40.
[3] Notons que, dans cet article, Weitz ne semble pas faire de véritable distinction entre esthétique et philosophie de l’art. Or une telle distinction peut voire doit être défendue, en montrant comment ces deux champs ne se recouvrent pas absolument. Par exemple, l’expérience esthétique d’objets naturels relève de l’esthétique mais pas de la philosophie de l’art stricto sensu.
[4] Ibid. p. 35-36.
[5] Ibid. p. 27. Citation suivante, ibid.
[6] Ibid. p. 28.
[7] Morris Weitz, « Le rôle de la théorie en esthétique » [1955], dans Danielle Lories (éd. et trad.), Philosophie analytique et esthétique, op. cit., p. 27.
[8] Ibid. p. 31. Citation suivante, ibid.
[9] Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques [1953], Première partie, § 65-75, trad. F. Dastur et alii, Paris, Gallimard (« Tel »), 2014.
[10] Ludwig Wittgenstein, cité par Morris Weitz, « Le rôle de la théorie en esthétique » [1955], dans Danielle Lories (éd. et trad.), Philosophie analytique et esthétique, op. cit., p. 32.
[11] Morris Weitz, « Le rôle de la théorie en esthétique » [1955], dans Danielle Lories (éd. et trad.), Philosophie analytique et esthétique, op. cit., p. 36. Nous soulignons.
[12] Ibid. p. 32.
[13] Nelson Goodman, Langages de l’art. Une approche de la théorie des symboles, Partie VI, Chapitre 7 « Symptômes de l’esthétique », trad. J. Morizot, Paris, Fayart (« Pluriel »), 2011.
[14] Ibid. p. 295.
[15] Nelson Goodman, Langages de l’art. Une approche de la théorie des symboles, op. cit., p. 297.
[16] Ibid.
[17] Berys Gaut, « “Art” as a Cluster Concept », dans Noël Caroll (dir.), Theories of Art Today, Madison, The University of Wisconsin Press, 2000, p. 25-44. Le terme cluster peut également être traduit en français par « grappe », « bouquet », « amas », etc. L’Oxford Dictionnary en donne la définition suivante : « un groupe de choses ou de personnes similaires, positionnées ou survenant dans une étroite proximité (a group of similar things or people positioned or occuring closely together) ».
[18] Ibid. p. 26
[19] Ibid. p. 25. Citation suivante, ibid.
[20] Berys Gaut, « “Art” as a Cluster Concept », dans Noël Caroll (dir.), Theories of Art Today, op. cit., p. 28.
[21] Ibid. p. 27.
[22] Ibid. p. 26.
[23] Ibid. p. 36.
[24] Morris Weitz, « Le rôle de la théorie en esthétique » [1955], dans Danielle Lories (éd. et trad.), Philosophie analytique et esthétique, op. cit., p. 36-37.
[25] Berys Gaut, « “Art” as a Cluster Concept », dans Noël Caroll (dir.), Theories of Art Today, op. cit., p. 29.
[26] Ibid.
[27] Berys Gaut, « “Art” as a Cluster Concept », dans Noël Caroll (dir.), Theories of Art Today, op. cit., p. 29. Nous soulignons.
[28] Nelson Goodman, L’Art en théorie et en action, trad. J.-P. Cometti et R. Pouivet, Paris, Gallimard (« Folio essais »), 2009, p. 67.
[29] Ibid. p. 64. Pour Goodman, une œuvre d’art fonctionne comme telle « dans la mesure où elle est comprise, où ce qu’elle symbolise et la façon dont elle le symbolise […] est discerné et affecte la façon dont nous organisons et percevons un monde » (ibid).
[30] Ibid. p. 67.
[31] Dictionnaire Le Littré.
[32] Étienne Souriau, « Art », dans Étienne Souriau (dir.), Vocabulaire d’esthétique, op. cit., p. 174. Citation suivante, ibid.
[33] Berys Gaut, « “Art” as a Cluster Concept », dans Noël Caroll (dir.), Theories of Art Today, op. cit., p. 29.
[34] Ibid. p. 36.
[35] Ibid. p. 36.
[36] Ibid. p. 30.
[37] Ibid. p. 41.
[38] Pour reprendre un exemple donné par Berys Gaut, « être un bloc de granite » n’est de toute évidence pas un symptôme pertinent de l’artisticité dans nos usages du concept d’art. Voir Berys Gaut, « “Art” as a Cluster Concept », dans Noël Caroll (dir.), Theories of Art Today, op. cit., p. 32.
[39] Jean-Pierre Cometti, La Force d’un malentendu. Essais sur l’art et la philosophie de l’art, Paris, Questions théoriques (« Saggio Casino »), 2009, p. 113. Voir également, sur la notion d’usage, Jean-Pierre Cometti, Art, modes d’emploi. Esquisses d’une philosophie de l’usage, Bruxelles, La Lettre volée (« Essais »), 2000.
Toutefois, il nous semble que, d’une manière générale, les réflexions de Jean-Pierre Cometti sur la reconnaissance et son lien aux usages, si éclairantes soient-elles, laissent peut-être trop de côté la question des propriétés des œuvres d’art. Or, la reconnaissance dont parle Jean-Pierre Cometti doit sans doute se faire sur la base de propriétés, de facteurs ou de symptômes réels (qu’ils soient intrinsèques ou relationnels), sous peine d’apparaître en fin de compte comme totalement arbitraire et incompréhensible.
[40] Voir Berys Gaut, « “Art” as a Cluster Concept », dans Noël Caroll (dir.), Theories of Art Today, op. cit., p. 27-28.
[41] Morris Weitz, « Le rôle de la théorie en esthétique » [1955], dans Danielle Lories (éd. et trad.), Philosophie analytique et esthétique, op. cit., p. 34. Nous soulignons.
[42] Nathalie Heinich et Roberta Shapiro (dir.), De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art, op. cit., p 299.
[43] En outre, même une fois qu’ils fonctionnent comme tels, les symptômes de l’artisticité sont sans doute susceptibles de gagner ou de perdre historiquement en importance ou en force.
[44] Berys Gaut, « “Art” as a Cluster Concept », dans Noël Caroll (dir.), Theories of Art Today, op. cit., p. 39.
[45] Morris Weitz, « Le rôle de la théorie en esthétique » [1955], dans Danielle Lories (éd. et trad.), Philosophie analytique et esthétique, op. cit., p. 34.
[46] Jean-Pierre Cometti, La Force d’un malentendu. Essais sur l’art et la philosophie de l’art, op. cit., p. 154.
[47] Comme le souligne en effet Walter Benjamin, « maintes formes d’art sont nées et ont disparu » au cours du temps, bien que leur disparition soit d’une manière générale bien moins souvent abordée que leur apparition. Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, op. cit., p. 49, nous soulignons.
[48] Paul Valéry, « L’infini esthétique » [1934], Œuvres (t. II), Paris, Gallimard (« Bibliothèque de la Pléiade »), 1960, p. 1342-1343.
[49] Nathalie Heinich et Roberta Shapiro (dir.), De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art, op. cit., p. 25. Nous soulignons.
[50] Ibid. p. 20.
[51] John Dewey, L’Art comme expérience, op. cit., p. 371.