
Bernard Stiegler et Jean-Hugues Barthélémy lors de la Décade internationale « Simondon ou l’invention du futur », Cerisy-la-salle, août 2013 © Ludovic Duhem
Il était mon « grand-frère en philosophie », et il l’est resté dans mon cœur et mon esprit malgré notre rupture en 2015. J’étais en sympathie spontanée avec son absence de préciosité et de frilosité, j’approuvais ses combats et ses projections vers l’avenir. Je rejetais seulement, mais fermement, les moments où ces qualités se transformaient en défauts pouvant faire quelques dégâts humains. En définitive, Bernard Stiegler a marqué vingt années de ma vie exactement, et son œuvre est incontestablement l’une des plus importantes des dernières décennies au sein de la philosophie dite « continentale ». Que la construction de ses ouvrages, ainsi qu’on le dit souvent, ait été moins soignée depuis 2010, et que la conceptualisation s’y soit de plus en plus appuyée sur une création de mots qui pourtant ne fait pas encore qu’il y ait bien du concept, cela est incontestable et j’ai moi-même eu l’occasion de le signaler. Mais l’œuvre reste, et son décisif coup d’envoi dans La technique et le temps est absolument ineffaçable. Après avoir beaucoup écrit sur Simondon[1], je consacrerai bientôt à Bernard cet ouvrage dont j’ai le projet depuis des années, mais dont il ne voulait pas que je l’écrive de son vivant. Il avait raison, puisque sa conceptualité était évolutive dans sa recherche des « critères », celle-là même qui peut résumer les différences entre sa pensée et mon propre projet philosophique de jeunesse, à la fois plus systématique et beaucoup plus radicalement anti-dogmatique – tel est le paradoxe fondamental de ce que je développe aujourd’hui sous le nom de Relativité philosophique.
Ici, où il est question, non de produire déjà l’exégèse de son œuvre, mais de lui rendre hommage à l’heure où nous sommes saisis par sa brutale disparition, je parlerai de ma relation à Bernard entre 1995 et 2015. Je dirai notre rencontre, qui fut LA rencontre intellectuelle de ma vie, fondatrice d’une intimité à la fois philosophique et humaine dont je rappellerai les faits marquants. Je dirai aussi la collaboration qui fut la nôtre, et enfin nos brouilles à la fois philosophiques et humaines, au confluent du désir et de l’humain, ces deux questions à la fois théoriques et existentielles qui ont finalement provoqué la rupture entre nous. Toute cette trajectoire fut cependant commandée par la rencontre entre deux projets philosophiques donnés dès le départ, et c’est pourquoi il me faudra commencer par un propos général sur les affinités et les différences entre ces deux projets philosophiques. Outre nos divergences sur les questions du désir et de l’humain, qui nous ont conduit à la rupture pour des raisons non seulement théoriques mais aussi existentielles, il y avait la question proprement architectonique de la méthode en philosophie, qui cependant ne pouvait déjà faire l’objet explicite d’un débat entre nous parce que Bernard la repoussait au dernier tome prévu de La technique et le temps, et parce que de mon côté je n’en avais parlé que dans quelques textes, seulement préparatoires à une reconstruction philosophique générale qui ne devait commencer de voir vraiment le jour qu’en 2018 avec La Société de l’invention[2], donc après la rupture avec lui.
Le cadre préalable : deux projets philosophiques amis et rivaux

« De la misère symbolique », Bernard Stiegler (Champs-Essais Flammarion, 2013)
Bernard était né exactement quinze ans moins un jour avant moi. Son amitié était aussi une connivence dans la volonté d’une critique inédite du capitalisme comme dans la défense et la réhabilitation de l’œuvre de Simondon, à l’exégèse de laquelle j’ai en effet consacré la première partie (2000-2014) de ma propre œuvre. Bernard, lui, n’a pas commencé son œuvre en tant qu’exégète de celle d’un autre, mais dès sa thèse de doctorat, soutenue en 1993 sous la direction de Jacques Derrida, il a développé sa propre philosophie, certes nourrie de dialogues critiques constants. La plus grande part de la première moitié de son œuvre constitue à mes yeux ce que la philosophie continentale a proposé de plus puissant durant les deux décennies 1990-2010. C’était plus conceptuel et plus profond que Sloterdijk ou Zizek ou Badiou, et beaucoup plus essentiel pour penser-surmonter notre époque et sa crise pluridimensionnelle. Je l’ai accompagné durant toutes ces années où il écrivit d’abord son Opus magnum, c’est-à-dire l’extraordinaire tome 3 de La technique et le temps, puis, notamment, les différents tomes de De la misère symbolique et Mécréance et discrédit, puis Prendre soin.
Outre sa thèse de doctorat, j’ai encore dans mes dossiers une bonne part de la première version du tome 4, resté inédit et appelé à devenir tome 5, de La technique et le temps, qu’il m’avait envoyée en toute confidentialité dès 2004-2005 – les souvenirs sont déjà vieux et approximatifs. Nous étions très complices en ces années 2000-2010. En 2009, au terme d’une décennie dont je dirai plus bas en quoi elle fut décisive pour moi, je l’avais remplacé pour donner une conférence sur l’Opus magnum dans le cadre du colloque « Memoria, Immaginazione e Tecnica » organisé par Martino Feyles à l’Université La Sapienza de Rome. Ce tome 3 de La technique et le temps étant le lieu où se projetait pour la première fois, en 2001, l’idée d’une « nouvelle critique » – au sens de Kant – qui, dans le même temps, articulerait la nouvelle anthropo(techno)logie[3] philosophique des deux premiers tomes (1994 et 1996) à l’idée d’une nouvelle critique de l’économie politique développée ultérieurement, je présentais au seuil de ma conférence la thèse globale de son œuvre – telle qu’elle se donnait à l’époque – dans les termes suivants : en vertu de la « finitude rétentionnelle » (Husserl+Stiegler), le processus « transindividuel » ou « psycho-social » d’ « individuation » (Simondon) repose sur une « extériorisation de la mémoire » (Leroi-Gourhan+Stiegler) qui fait de lui un processus « transductif » (Simondon) d’« épiphylogenèse » (Stiegler) fondée sur des « prothèses » (Simondon+Stiegler) comprises comme « déjà-là » et « supplément » (Heidegger+Derrida) pouvant aujourd’hui, à l’ère des « technologies de l’esprit » (Stiegler) et de leur exploitation consumériste, engendrer une « désindividuation » (Simondon+Stiegler) comprise comme « désublimation » (Marcuse+Stiegler), c’est-à-dire une régression du désir à la « pulsion » (Freud) et une « prolétarisation des consommateurs » (Stiegler) comme perte de savoir-désirer – après la « prolétarisation des producteurs » (Marx) entendue ici comme « aliénation psycho-physiologique » (Simondon) et perte de savoir-faire. La mention « +Stiegler » signifiait à chaque fois que Bernard avait réélaboré le concept en question, au lieu de l’emprunter directement. C’est évidemment le cas pour la « finitude rétentionnelle », Husserl n’ayant pas pensé la finitude, ni donc ce que Bernard nomme la « rétention tertiaire », qui suppose l’extériorisation de la mémoire comme condition du développement de l’intériorité psychique. L’entreprise théorique me fascinait dans son audace, qui prétendait définir le point de convergence de tant de grandes pensées antérieures par un processus théorique de prolongement-dépassement.
Je n’étais pas pour autant prêt à suivre Bernard dans tous ses choix, ni théoriques ni pratiques, et je lui disais parfois mes désaccords, jusqu’à cette rupture qui eut lieu fin 2015, et dont les signes avant-coureurs étaient en réalité présents dès 2012. Sa mort est venue rendre à jamais impossible toute réconciliation future avec ce grand-frère auquel je continuais, ces dernières années, de penser secrètement, moi qui m’apprêtais par ailleurs à poursuivre dans ma future Critique de la raison désirante le dialogue critique entamé en 2018 dans La Société de l’invention. Entre ces deux ouvrages, il y a La Philosophie du paradoxe, qui est à paraître en 2021 mais qui ne touche pas aux questions de Bernard, hormis peut-être ce qu’il avait en vue pour le dernier tome de La technique et temps en tant que « discours aux limites du dicible », comme il disait. Dans La philosophie du paradoxe, donc, il s’agit d’asseoir ma problématique première et fondamentale de la sémantique archiréflexive, celle que je projetais toujours plus précisément, depuis mes 22 ans, comme devant livrer la méthode du futur système radicalement anti-dogmatique de la Relativité philosophique. La seconde partie de La Société de l’invention, elle, a donné la structure de ce futur système, et insisté au chapitre VII sur son telos politique, par lequel la Relativité philosophique est aussi une « écologie humaine ».
Je peux dire aujourd’hui que deux trajectoires théoriques se sont rencontrées, ont cheminé ensemble pendant quinze ans puis se sont séparées, mais pour des raisons qui, étant liées non seulement au problème architectonique de la méthode en philosophie mais aussi aux deux questions à la fois théoriques et existentielles du désir et de l’humain, ne pouvaient rester des raisons seulement théoriques et touchaient aussi aux « principes pratiques », comme aurait dit Kant. La double question théorico-pratique de l’humain et du désir engage même, bien sûr, ce qui s’est joué dans la relation entre deux hommes d’âges différents, et dont les projets philosophiques respectifs étaient incontestablement obsessionnels etprioritaires dans leurs vies. Pour ma part, j’avais fait ma toute première découverte philosophique d’enfant l’après-midi du 24 décembre 1972, en comprenant après Descartes que même dans l’hypothèse où la vie ne serait qu’un rêve et donc une illusion, il serait au moins certain que je penserais, pour pouvoir rêver ainsi. Je communiquais aussitôt ma découverte au meilleur ami de mon père, qui se trouvait en ma compagnie dans le salon de notre appartement familial. Seize ans plus tard, mon projet naissant de la Relativité philosophique se voulait le renversement post-wittgensteinien, et radical parce que paradoxal, du « cogito » cartésien : comme l’écrivait Wittgenstein dans son dernier texte De la certitude – qui m’avait fasciné, et auquel l’étudiant que j’étais alors avait consacré un exposé explicatif de 3 heures -, « où manque le doute, manque aussi le savoir », et « ce qu’il faut à nouveau ici, c’est un pas, pareil à celui que fait la théorie de la relativité »[4]. Six années après la naissance de ce projet de la Relativité philosophique, donc à l’âge de 28 ans, je rencontrais Bernard, qui allait m’aider à penser que je suis fait par cela même que je pense comme étant pourtant « là-devant ». Mais il m’y aiderait sur un plan qui, selon moi, ne devait plus être premier dès lors que l’individu philosophant se reconnaît et doit d’abord se penser lui-même comme n’étant pas originaire dans son rapport au faire-sens pluridimensionnel des significations mêmes qu’il manipule – les mal nommées « représentations ».
Tel fut, tel est et tel sera l’objet le plus fondamental de notre désaccord, qui concerne en fait l’architectoniquephilosophique et l’exigence de redéfinir et reconstruire tous les domaines de la philosophie après la « déconstruction » derridienne et la « thérapeutique » wittgensteinienne.

« La Société de l’invention », Jean-Hugues Barthélémy (Editions Matériologiques, 2018)
Ce projet philosophique que j’ai eu dès ma jeunesse estudiantine, celui d’une redéfinition et reconstruction de tous les domaines de la philosophie, je l’ai laissé fermenter en silence, ou presque, pendant toutes ces années où je me spécialisais sur l’œuvre de Simondon puis publiais des ouvrages et des articles sur cette œuvre. Il prit enfin forme dans La Société de l’invention, et je le développerai au cours des vingt-cinq années à venir si la vie m’accorde la santé durable. Bernard, qui a brûlé sa vie comme il a bombardé nos esprits de textes écrits sur un rythme infernal, ne comprenait manifestement pas une telle patience, et je soupçonne qu’il la prenait en fait pour de la lenteur. Mais c’est l’immensité même de la tâche qui impose la patience, c’est-à-dire l’urgence absolue de prendre le temps en cette époque de crise manifeste de la réflexivité.
Que la catastrophe écologique en cours impose d’agir rapidement, cela même oblige à bien choisir « les armes », pour reprendre son expression, et ma voie propre est la difficile mais nécessaire refondation du droit compris comme faire-droit, laquelle suppose aussi une préalable réorganisation générale des domaines de la philosophie pour ce que je nomme l’âge écologique de la pensée. La philosophie ne peut rien pour changer le monde, si elle ne prend pas le risque de venir trop tard en s’obligeant à jouer le rôle qui lui revient : repenser le faire-droit qui est au fondement même des lois. Car ce sont les lois qu’il faut changer, sans quoi la planète brûlera de toute façon. Or, repenser le faire-droit, c’est d’abordrepenser le faire-sens de toute chose en tant qu’il est pluridimensionnel et commande la place du faire-droit au sein de l’ensemble des champs de la philosophie. C’est pourquoi ma voie propre est systématique, bien que radicalement anti-dogmatique dans la manière même dont cette systématicité est requise depuis La Société de l’invention. Je ne pouvais donc suivre Bernard dans la façon qu’il avait de comprendre l’urgence. L’hommage que je veux lui rendre sera ainsi celui, non d’un disciple, mais d’un « petit-frère » à la fois admiratif et porté par d’autres impératifs, qui sont en dialogue critique avec le type de réflexivité mis en œuvre par lui.
La rencontre du « grand-frère en philosophie »
J’ai rencontré Bernard en 1995, alors que j’étais installé dans le Nord de la France. Ayant travaillé dès 1989-1990 sur Simondon, tout en lisant Heidegger – et Wittgenstein, mais ceci me sépare de Bernard – après avoir beaucoup lu Husserl en 1988-1989, j’avais ensuite littéralement dévoré, en 1994, l’ouvrage La technique et le temps 1. La faute d’Épiméthée, puis je m’étais décidé à téléphoner à l’université de Compiègne pour découvrir la voix de Bernard et, surtout, lui dire mon enthousiasme devant l’extrême convergence et complémentarité entre sa thèse de la « prothéticité » de la conscience humaine et la manière dont j’entendais reconstruire l’ontologie de Simondon à partir de ce que je concevais, depuis mon mémoire de maîtrise (Master 1), comme sa refondation englobante au sein du futur système de la Relativité philosophique. Bien sûr, des différences évidentes existaient entre nos projets respectifs, mais l’idée stieglerienne de prothéticité me renvoyait directement à ma propre idée de la « transcendance constitutive », et elle le faisait en procédant à un formidable dialogue critique avec Leroi-Gourhan, Simondon, Heidegger. Bernard s’imposait donc, par ce livre novateur et profond, comme mon grand-frère en philosophie, et cela avant même de devenir véritablement un ami dans la vie.
Aujourd’hui, je conteste que l’artefact puisse inclure la langue pour définir l’unique transcendance constitutive sous le nom générique de « téchnè », et dans le premier chapitre de La Société de l’invention je reviens à l’irréductible dualité leroi-gourhanienne langage-technique, mais pour transformer la « coordination » qu’y voyait Leroi-Gourhan en une très progressive interpénétration formant une interface langue grammaticalisée (technicisée)/système d’objets symbolisés (renvoyant les uns aux autres), c’est-à-dire une double transcendance constitutive. Mais en 1995, l’urgence pour moi était de rencontrer ce théoricien qui, au téléphone, se disait aussi surpris que moi par la convergence dont je lui parlais. Je lui rendis visite dans le village où il résidait, et à 18h30, dans le jardin ensoleillé de cette grande maison où il semblait vivre seul – je me posais du moins la question -, nous prenions notre premier verre tout en parlant de Simondon et de La Technique et le temps 1. Ce jour-là, en 90 minutes, il avait commencé de devenir un ami dans mon esprit, et, définitivement à mes yeux, mon grand-frère en philosophie.

« La technique et le temps », Bernard Stiegler (Fayard)
En 1996 parut le second tome de La technique et le temps, où Derrida et surtout Husserl se voyaient mobilisés comme l’avaient été, dans le tome 1, Simondon mais aussi Leroi-Gourhan et Heidegger, ces deux-ci étant encore présents au début du tome 2. Bernard y installait cette fois définitivement ce qui devait constituer à mes yeux sa plus grande singularité dans l’écriture : la construction d’une pensée nouvelle par le biais d’incessantes relectures – qui étaient aussides lectures critiques – des grands penseurs qui l’avaient précédé. Plus encore que Deleuze, et beaucoup plus explicitement et honnêtement que lui, Bernard ne pensait ni sans les autres ni avec eux. Il pratiquait avec virtuosité le prolongement-dépassement. De mon côté, j’étais rentré dans ma Bretagne d’enfance, où j’enseignais désormais comme titulaire. C’est en 1999 seulement, donc à l’âge de 32 ans, que je repris les études en passant un DEA (Master 2) sur « L’idée de Relativité philosophique chez Simondon ». Je montrais que le « nouveau relativisme » étrangement revendiqué par Simondon dans une note n’était évidemment plus du relativisme, mais une amorce de Relativité philosophique, dont la vocation la plus profonde était cependant, par-delà Simondon, de ne plus commencer par l’ontologie comme prétendue « philosophie première », mais par la nouvelle sémantique archiréflexive, que Simondon n’avait absolument pas pensée et dont l’ontologie ne serait plus qu’une traduction seconde. En d’autres termes, et dans la stricte filiation de mon ancien mémoire de maîtrise – qui n’avait pas porté exclusivement sur Simondon cependant -, je posais déjà les premières pierres pour la refondation englobante de l’ontologie simondonienne, opération complexe dont le second volet de Penser l’individuation[5], puis le chapitre VI de La Société de l’invention, ont ensuite montré qu’elle s’impose pour dissoudre les contradictions méthodologiques de Simondon.
J’envoyais un exemplaire à Bernard, qui devait ensuite y renvoyer dans le tome 3 de La Technique et le temps, mais en commettant une erreur sur l’université – celle de Rennes, et non pas celle de Nantes comme il l’écrivait – où j’avais soutenu le mémoire de recherche. Le tome 3 du grand œuvre de Bernard est à mes yeux l’ouvrage de philosophie continentale le plus important des années 1990-2010. C’est chez lui, après une soirée passée en tête-à-tête, que Bernard me l’offrait en 2001 au moment de sa parution. C’était la première nuit que je passais chez ce grand-frère en philosophie, dont l’Opus magnum devait me conduire quelques années plus tard à décider qu’un jour j’écrirais un ouvrage sur la pensée de Bernard. La table détaillée de ce futur livre, qui découpe l’œuvre de Bernard en périodes définies à la fois par des concepts et par des auteurs prolongés-dépassés, a d’ailleurs été jetée sur le papier en une heure de temps, il y a six ou sept ans, et elle demande seulement à être complétée par un nouveau chapitre sur la dernière période de l’oeuvre, puis un éventuel chapitre final de discussion de son entreprise théorique. Je peux le dire, aujourd’hui : il sera écrit durant les années 2022-2026, en parallèle étroit avec la Critique de la raison désirante où je développerai le triple dialogue critique central avec Kant, Rawls, Stiegler que j’ai entamé au chapitre VII de La Société de l’invention.

Gilbert Simondon
En cette année 2001, j’étais désormais en thèse à l’université Paris VII depuis un an, ayant choisi comme directeur de thèse Dominique Lecourt parce qu’il était un spécialiste de Gaston Bachelard, le grand précurseur de ma théorie du décentrement du sujet connaissant, et parce qu’il avait écrit, à la dernière page de son pamphlet Les piètres penseurs, qu’au lieu de lire les « nouveaux philosophes » (Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann) on ferait mieux de lire Wittgenstein[6], Simondon et Foucault. Les deux premiers de ces trois grands noms étaient justement les précurseurs – plutôt que les origines – de la structure étagée, pluridimensionnelle et traductive-analogique (1. Sémantique archiréflexive ; 2. a/ Philosophie de l’information ontologique ; 2. b/ Philosophie de la production économique ; 2. c/ Philosophie de l’éducation axiologique) de mon futur système radicalement anti-dogmatique, et comme je voulais travailler à nouveau sur Simondon pour en devenir le spécialiste, je choisissais Lecourt, l’Université française ne comptant de toute façon pas encore, à l’époque, de spécialiste susceptible de diriger mon travail sur l’œuvre de Simondon – qu’il s’agissait donc d’introduire dans les études philosophiques[7]. Ma thèse de doctorat, à l’instar du mémoire de maîtrise et de celui de DEA, était dirigée vers la refondation englobante de l’ontologie de Simondon, mais de façon encore plus approfondie, et dans des proportions beaucoup plus larges – 612 pages. Elle s’ouvrait sur une longue Introduction consacrée aux idées d’« exégèse polémique » et de « relativisation refondatrice de l’ontologie de l’individuation » – ce que je nomme aujourd’hui la « refondation englobante » au sens d’une secondarisation de l’ontologie -, et s’achevait par une quatrième Partie intitulée « Penser le sens », qui explorait et critiquait Husserl, Heidegger et Wittgenstein durant trois chapitres avant de donner, en un chapitre final, le programme très général du futur système de l’individuation du sens. Cette thèse était aussi la première thèse de doctorat à consacrer un chapitre à la pensée de Bernard, en fin de troisième Partie, laquelle s’intitulait « Penser la technique ». Bernard, le 14 novembre 2003, jour de la soutenance, était évidemment dans le jury, et il m’avait fait le cadeau d’envoyer à tout son carnet d’adresses une annonce de soutenance où il parlait d’une thèse « hors du commun ». J’avais certes conscience que ce qui se préparait depuis mon mémoire de maîtrise était plus qu’une réhabilitation de l’œuvre de Simondon, puisqu’il s’agissait d’ouvrir à une nouvelle systématicité dont le paradoxe suprême était qu’elle résultait de mon radical anti-dogmatisme post-wittgensteinien. J’avais aussi conscience qu’il me faudrait un jour réhabiliter le paradoxe dans sa différence trop oubliée par rapport à la contradiction, la confusion entre les deux, qui est devenue fréquente chez les philosophes eux-mêmes, étant à mes yeux l’un des symptômes de ce que je pense depuis La Société de l’invention sous le nom de « crise de la réflexivité ». La réhabilitation du paradoxe, mais aussi celle de l’analogie versus la métaphore, sont centrales dans La Philosophie du paradoxe, dont les 480 pages prévues seront achevées dans quelques mois.
Grâce à l’annonce de Bernard, ma thèse trouvait un possible éditeur en la personne de Jean-Louis Déotte, qui se disait intéressé de la publier dans un avenir proche, mais de son côté Bernard décidait, dès 2004, de tenter de me publier chez son propre éditeur Galilée. Une brouille financière entre lui et l’éditeur déboucha cependant sur un appel téléphonique où je me voyais simplement signifier, par l’éditeur, que la publication ne se ferait finalement pas. L’appel fut extrêmement froid et dura cinq secondes. Je compris que je faisais l’objet d’un dégât collatéral, et décidais d’accepter la proposition de Déotte, qui publia ainsi en février et juin 2005 les deux volets de Penser l’individuation. Bernard, lui, publiait en 2004 et 2005 les deux tomes de De la misère symbolique, ainsi que le premier tome de Mécréance et discrédit, dont les tomes 2 et 3 suivaient en 2006. C’était une période d’intense activité éditoriale pour lui, qui avait aussi publié en 2003 et 2004 la conférence faite à Beaubourg Passer à l’acte, l’opuscule Aimer, s’aimer, nous aimer et Philosopher par accident, puis les deux tomes de Constituer l’Europe en 2005. Il m’envoyait toutes ses publications au fur et à mesure, et je les dévorais aussitôt reçues. Mais sa collaboration avec les éditions Galilée était appelée à se terminer dès 2006.
C’est également durant ces années d’intense production que Bernard m’envoya, en toute confidentialité, les 150 premières pages du futur tome 4 de La technique et le temps, resté inédit et appelé à devenir tome 5. J’étais comblé, mais je m’interrogeais sur son titre spécifique : « Symboles et diaboles, ou la guerre des esprits ». De mon côté je publiais en 2004 et 2006, dans la Revue philosophique de la France et de l’étranger, des recensions du tome 3 de La technique et le temps et du tome 1 de Mécréance et discrédit. Je publiais aussi en 2005, dans cette même revue, une recension de l’ouvrage issu de la thèse de doctorat de Barbara, dont j’avais fait la connaissance et suivi la brillante soutenance de thèse, et qui m’avait dit avoir choisi de travailler sur Nietzsche plutôt que Marx – qui la tentait – parce que son père n’avait pas encore parlé du premier. Je garde un souvenir impressionné de ce jury de soutenance associant notamment Jean-Luc Nancy, au propos si profond et subtil, Jean-Luc Marion, le directeur de thèse et l’auteur de l’important Réduction et donation, et Jean-François Marquet, l’érudit dont le propos nous surprit en évoquant le « maître » Simondon. La thèse de Barbara était une très grande réussite en termes de réinterprétation-actualisation de la pensée nietzschéenne. J’en faisais un compte-rendu dithyrambique. Un autre souvenir marquant est celui, amusé, de cette très longue soirée que Barbara et moi avons passée dans l’appartement de Bernard et Caroline en face de Beaubourg, où j’étais seul pendant trois jours. Elle rendait visite à son père, mais elle tombait sur moi. Nous avons eu le culot de boire toute la bouteille de digestif brésilien offerte à Bernard par mon ami Fernando Fragozo, dont Bernard avait été le co-directeur de thèse.

Bernard Stiegler et Jean-Hugues Barthélémy lors de la Décade internationale « Simondon ou l’invention du futur », Cerisy-la-salle, août 2013 © Ludovic Duhem
La collaboration et la spirale
2006 est l’année charnière où paraissaient les actes d’une journée d’études sur Simondon et Heidegger, à laquelle Bernard et moi avions participé à l’université de Toulouse. Nos textes respectifs sont à mes yeux particulièrement significatifs de nos deux trajectoires de pensée, et le texte de Bernard m’a servi quelques années plus tard pour introduire à sa pensée dans le sous-chapitre du Simondon qui est spécifiquement consacré aux postérités de la pensée simondonienne[8]. L’année 2006 est aussi celle où je publiais le texte de Bernard « Chute et élévation. L’a-politique de Simondon », dans un numéro sur Simondon que je dirigeais pour la Revue philosophique de la France et de l’étranger. J’avais dû, quelques mois plus tôt, hurler au téléphone à 22h pour obtenir ce texte, que Bernard, fâché pour une raison que j’ai oubliée, ne voulait plus m’accorder alors que le numéro était prévu de longue date. Il découvrait là à la fois mon intégrité dans l’amitié, dont il avait douté de façon quelque peu paranoïaque à mes yeux – cela, je me souviens l’avoir pensé -, mais aussi ma force de caractère et mon absence de soumission au « grand-frère », qui faisaient de moi l’un des seuls, parmi ses amis, à oser lui hurler dessus – mes indignations et colères étant facilement pleines et entières. Il avait finalement cédé, me rappelant une heure plus tard pour me dire « Jean-Hugues, c’est bon, tu auras ton texte ».
En 2007, Bernard soutenait son HDR à l’âge de 55 ans, et il avait choisi pour garant mon ancien directeur de thèse Dominique Lecourt. Pour cette soutenance, j’étais placé juste derrière Bernard, et me réjouissais profondément pour lui, à qui il manquait encore cet ultime diplôme alors que son œuvre, elle, commençait déjà de se faire réellement connaître à l’échelle internationale. Lecourt, dans son discours introductif, osa parler d’un « jour historique », car on n’avait jamais vu un philosophe d’une telle dimension soutenir une HDR. Il créa également ce jour-là le mot « simondialisation » pour désigner ce à quoi Bernard participait exemplairement par son œuvre, où Simondon était très présent. Quatre ans plus tôt, alors que Lecourt finissait de diriger ma thèse, il m’avait accueilli dans son bureau en me montrant les trois tomes de La technique et le temps, qu’il avait enfin achetés, et en me disant avec un large sourire : « Barthélémy, vous avez gagné ! ». Par mon chapitre de thèse sur la pensée de Bernard, j’avais convaincu Lecourt de l’importance de cette pensée – et de son affranchissement à l’égard de Derrida, que Lecourt jugeait bien trop littéraire et heideggérien à la fois. Dans les années qui suivirent, Bernard et Lecourt eurent des collaborations institutionnelles.
En 2008 Bernard publiait Prendre soin 1. De la jeunesse et des générations, qui s’ouvrait sur l’idée que « remettre en cause la minorité des enfants, c’est aussi remettre en cause la majorité de leurs ascendants adultes, et en fin de compte, décharger ceux-ci des responsabilités que leur confère leur majorité »[9]. Cet ouvrage, qui revisitait l’inconscient freudien pour le rendre collectif et historique, me semblait aussi confirmer que la pensée de Bernard se voulait ce que j’avais nommé une « psycho-sociologie historique des profondeurs » – en laquelle, bien sûr, la prothèse technique est le « troisème brin » de notre être psycho-social -, discours dont la nécessité était aussi pour moi l’occasion d’interroger la nature exacte de son statut philosophique. Mais le temps n’était pas encore venu pour une véritable confrontation sur le terrain archiréflexif qui doit être, aujourd’hui, celui de la philosophie, et de mon côté je publiais « De la finitude rétentionnelle. Sur La technique et le temps de Bernard Stiegler »[10], qui était issu de mon chapitre de thèse consacré à l’importance de la pensée de Bernard.
Les années 2007-2008 définissent aussi l’époque où il me faisait entrer dans le Conseil d’Administration d’Ars Industrialis, au sein duquel je me liais rapidement d’amitié avec Arnauld De l’Épine et sa femme Françoise, qui dès lors m’hébergeaient régulièrement pour mes brefs séjours à Paris. Bernard n’a sans doute pas toujours été conscient du degré de fidélité et d’engagement de membres comme Arnauld. De mon côté, je restais prioritairement attaché à mon projet philosophique de jeunesse, qui définit le sens même de toute mon existence, mais je participais à Ars Industrialis sur le plan de l’engagement politique et de la nouvelle critique du capitalisme qu’apportait Bernard. Je commençais dans le même temps de m’interroger sur la refondation du droit en tant que faire-droit, dont je ressentais de plus en plus fortement la nécessité, et qui me conduit depuis La Société de l’invention à vouloir construire ce que j’y ai présenté, au chapitre VII, sous le nom d’« éco-logie politique », ou économie politique pour l’âge écologique, à laquelle introduira de façon plus précise la Critique de la raison désirante en tant que lieu de la triple réconciliation de la philosophie du droit, de l’économie politique et de l’écologie politique.
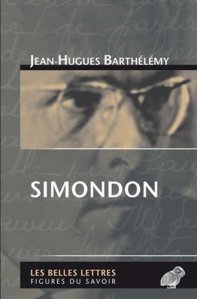
« Simondon », Jean-Hugues Barthélémy (Les Belles Lettres, 2014)
Mon indépendance persistante s’exprimait aussi dans l’article « Philosophie de la nature et artefact. La question du préindividuel »[11], où Vincent Bontems et moi discutions la façon dont Bernard récupérait le préindividuel simondonien pour affirmer une « constitutivité technologique » de ce préindividuel, dont les conditions seraient toujours-déjà techniques. Cette discussion a pris une dimension supplémentaire en 2012 dans mon article « Individuation and Knowledge. The “refutation of idealism” in Simondon’s Heritage in France »[12], où je proposais ma propre voie comme constituant l’autre héritage possible de Simondon et posais la question des fondements architectoniques et méthodologiques chez Bernard. Tout en reconnaissant la force de sa critique de Heidegger – ce dernier avait certes affirmé que la question kantienne de la réfutation de l’idéalisme était une pseudo-question, mais il n’avait pas fait de l’artefact cette extériorité qui nous fait -, je jugeais qu’il fallait aller encore plus loin que la dissolution de la question de la réfutation de l’idéalisme par la prothéticité de la conscience : si le monde est toujours-déjà donné, ce n’est pas seulement parce que ma conscience du monde repose sur les artefacts comme « béquilles de l’esprit », mais c’est plus fondamentalement parce que le (faire-)sens de toute chose est irréductible à la seule dimension de l’ob-jet de connaissance et doit être pensé comme une transcendance constitutive qui s’individue en moi dans sa pluridimensionnalité. Au lieu donc de prendre le risque de partager avec Heidegger une position qui rendrait la conscience humaine non-dérivable à partir de la conscience de l’animal non-humain, il s’agissait à mes yeux de quitter le terrain du savoir proprement dit, pour ensuite faire de l’ontologie entière une traduction seconde de la simple et prioritaire « connaissance » de soi-même comme « sens-sujet » non-originaire ou fait par le sens dans sa pluridimensionnalité, cette traduction ontologique seconde faisant, elle, dériver la conscience humaine de la conscience animale non-humaine par progressive interpénétration de la technique et du langage pré-humains, devenus le doublet langue grammaticalisée-technicisée/système d’objets symbolisés qui existe à l’extérieur de nous et s’individue en nous.
J’ai parlé, en titre, de « spirale ». Celle-ci n’est pas seulement le fait que Bernard et son rythme de production comme ses idées engagées m’aient « aspiré » dans un tourbillon de vie et un collectif qui lui étaient sans doute vitaux – tandis que pour ma part, j’ai besoin du temps long et de la solitude pour construire la Relativité philosophique. Le mot « spirale » me sert aussi à renvoyer à ce texte très mystérieux où Bernard, dessinant des spirales, livrait enfin l’origine même – survenue une nuit alors qu’il était en prison – mais aussi l’utime fondement de toute son oeuvre. Je veux bien sûr parler du texte « Le concept d’“idiotexte” : esquisses », paru en 2010[13], qui est donc une version réactualisée de cette Origine-programme carcérale de l’œuvre. La thèse doctorale de Bernard, bien sûr, contenait déjà des traces de ce texte-Origine dans sa quatrième partie, intitulée « L’idiot ». Cette thèse, en effet, contient la source des tomes 1, 2 et 4 de La technique et le temps, mais aussi des éléments pour les tomes suivants. Quant au tome 3, qui n’était pas prévu au départ, il vint à Bernard lors d’une relecture de la Critique de la raison pure, et c’est sans doute ce qui explique son génie particulier et sa profondeur accrue. On peut préciser aussi que la thèse avait pour titre principal La Faute d’Épiméthée, et pour sous-titre « La technique et le temps ».
En tant qu’il livre les fondements ultimes de toute l’œuvre, le texte – toujours programmatique – paru en 2010 était l’annonce du dernier tome de La technique et le temps, celui où Bernard me disait « rejoindre » ma question architectonique de l’archiréflexivité sémantique. En lisant ce texte, je comprends immédiatement pourquoi il me disait cela, mais il me faudra produire dans l’avenir une explication de ce texte étrange, afin de montrer en quoi sa problématique fondamentale ne répond toujours pas à mon questionnement archiréflexif sur le rapport de l’individu philosophant au faire-sens des significations manipulées. En fait, et comme permet de le comprendre le §53 de Qu’appelle-t-on panser ? 1. L’immense régression, où Bernard annonçait derechef le tome 7 de La technique et le temps et la théorie de l’idiotexte, le fond de l’affaire est chez lui post-nietzschéen, tandis qu’il est chez moi post-wittgensteinien. Le problème du décentrement, tel que je le pose au chapitre V de La Société de l’invention et le développe dans La Philosophie du paradoxe, permet déjà de saisir les différences entre nos problématiques fondamentales respectives.
Désirer l’humain
Le confluent où se croisent les deux questions à la fois philosophiques et existentielles du désir et de l’humain définit le lieu de toutes les forces, violentes et contradictoires, qui ont fait de ma relation à Bernard une amitié absolument décisive dans mon existence, mais aussi une relation complexe et tumulteuse. Nos divergences quant à la question de l’architectonique philosophique, elles, pouvaient d’autant moins créer la rupture entre nous que le débat n’avait pas encore eu lieu. C’est donc bien plutôt sur les deux questions de l’humanisme – et par conséquent de l’humain – et du désir que nous avons eu l’occasion de nous déchirer. Mais ceci signifie que le « débat » ne se déroula pas comme il aurait dû : la dimension existentielle des questions l’emporta sur l’argumentation purement philosophique.

Jacques Derrida
D’abord, et ainsi que pouvait le laisser deviner la troisième et dernière section de la Conclusion de la thèse de Bernard, intitulée « L’atranscendantal », Bernard transformait le « quasi-transcendantal » de Derrida en une perspective se voulant plus neutre, mais qui restait du non-transcendantal maintenant le transcendantal sous une nouvelle forme. D’où les « structures omni-temporelles » dans La société automatique 1. L’Avenir du travail. Son Désir était d’infinitiser le désir humain afin de pouvoir faire de l’idéaLISATION désirante « la matrice » des idéaTIONS du savoir – comme dira Pharmacologie du Front national. Notre premier accrochage eut lieu à ce propos lors de l’Académie d’été de 2012 à Épineuil-le-Fleuriel, où je suggérais que la pulsion pouvait être du désir devenu pulsionnel, puisque le désir pouvait désublimer tout autant que sublimer. Bernard, qui pensait la « désublimation » à la suite de Marcuse, refusa pourtant de nommer « désir » le désir devenu pulsion, et le fit d’une façon d’autant plus inappropriée, à mes yeux, que nous étions en public. J’avais déjà assisté à ces emportements à la fois extrêmes et injustifiés que je rejetais, chez lui, dans sa relation aux contradicteurs, et j’en étais ce jour-là à mon tour la victime. Je l’avais aussi entendu valoriser la veille, et de façon dithyrambique, un exposé de disciple dont le propos avait donné à sa théorie « pharmacologique » une dimension cosmologique, mais qui, sur le plan épistémologique, mélangeait absolument tout – jusqu’au non-sens. Je l’avais signalé peu après, en privé, à Bernard, mais j’étais manifestement l’un des seuls, au sein de l’Académie d’été – et qui comptait par ailleurs peu de philosophes, et encore moins d’épistémologues -, à oser lui dire « Fais gaffe ! », et je le faisais à mes dépens. Chez Bernard, donc, le Désir était plus qu’un objet de réflexion, il débordait existentiellement la réflexion jusqu’à, parfois, rompre le dialogue argumentatif. Je quittais Épineuil-le-Fleuriel le soir même après notre accrochage.
Sur le plan théorique, je comprenais que sa pensée du Désir le maintenait dans une coupure anthropologique qui expliquait pourquoi il n’avait pas pensé la technique humaine comme étant issue de la technique pré-humaine par interpénétration progressive avec le langage pré-humain. Comme Heidegger, il pensait un « qui » – nom donné par Bernard au Dasein dans le tome 2 de La technique et le temps – non-dérivable à partir de l’animal non-humain, et la question du Désir comme « infini » relevait de cette même logique. Mais les animaux non-humains sont capables de désirs, parce que l’infinité éventuelle de l’objet du désir prend sens dans le cadre de la finitude du désir lui-même. Notre époque est celle de la bouleversante découverte éthologique de la complexité psychique et émotionnelle des animaux non-humains, dont les besoins peuvent aller jusqu’aux besoins non-vitaux de liberté bien sûr, mais aussi d’équité – je pense aux célèbres expériences de Frans de Waal avec des singes capucins -, vecteurs de la satisfaction du besoin central et auto-normatif de santé physiologique et psychique – ainsi que je le théorise au chapitre VII de La Société de l’invention -, et qui ont par ailleurs occasionnellement des désirs et pas seulement des besoins. Cette dernière précision signifie qu’il faudra également, dans l’avenir, reposer la question des différences entre désir, volonté et besoin, qui, à l’instar des différences paradoxe/contradiction et analogie/métaphore, ont été quelque peu perdues de vue par la philosophie alors que le besoin, tel qu’il n’est ni le désir ni simplement le « besoin vital », possède sa propre normativité faisant droit – tel est l’objet du chapitre VII de La Société de l’invention -, pendant que la volonté, elle, se définit comme ce qui se retourne contre les désirs pour aider le besoin à faire reconnaître son faire-droit contre nos sociétés du désir surproductrices-surconsommatrices – et écologiquement destructrices.
Le paradoxe est alors que dans mon combat contre toute forme de coupure anthropologique et ma dénonciation d’une coupure résiduelle chez Bernard, je revendique malgré tout un « humanisme », tandis que Bernard, lui, disait rejeter l’humanisme. Comme tout simple paradoxe, celui-ci trouve sa résolution parce qu’il n’est pas une contradiction : mon humanisme n’en est un que parce qu’il maintient l’unique constante de l’humanisme dans son histoire, c’est-à-dire le combat pour la libération des humains. Mais aujourd’hui, ce combat pour la libération des humains consiste notamment à libérer les animaux non-humains de la culture aliénée qui leur fabrique un univers concentrationnaire. Lorsque le prétendu « élevage » intensif sera aboli, l’humain se sera lui-même libéré d’une aliénation qui consiste à croire à d’illusoires « nécessités » – engendrées par le consumérisme. Mon humanisme, héritier direct de ce que j’ai nommé « humanisme difficile » en parlant du « nouvel humanisme » revendiqué par Simondon, est en fait un humanisme décentré, véritable adversaire des coupures anthropologiques pré- et post-darwiniennes qui faisaient de l’humain tantôt le « Centre » – c’était le vieil anthropocentrisme -, tantôt le « Dehors » historico-culturel – c’était Sartre ou Heidegger -, de la Nature, alors que l’humain en est en réalité un prolongement culturel spécifique, parmi d’autres prolongements (proto-)culturels – ceux visibles chez les grands singes, en lesquels simplement le langage et la technique ne se sont pas interpénétrés pour engendrer ce processus cumulatif que l’on nomme « histoire ».

« Penser l’individuation.
Simondon et la philosophie de la nature »,
Jean-Hugues Barthélémy (L’Harmattan, Coll. Esthétiques, 2005)
Notre accrochage de 2012 n’empêcha pas Bernard d’envisager, avec un éditeur américain, un ouvrage réunissant des traductions de certains de nos textes respectifs sur Simondon. Bernard et moi avions même enregistré, en septembre 2013 et dans la perspective de cet ouvrage écrit à quatre mains, un entretien sur son rapport à la pensée de Simondon. Malheureusement, l’éditeur nous fit rapidement savoir que ce projet était empêché, parce que la possibilité lui était soudain offerte de publier la traduction anglaise de plusieurs ouvrages de Simondon, mais à la condition, nous disait-il, de ne pas publier notre ouvrage, qui ne se fit donc pas. Quelques années auparavant, notre projet de traduction de L’individuation psychique et collective – dont la réédition française en 2007 avait été préfacée par Bernard, qui m’avait ensuite mis en relation avec Arne De Boever et deux autres traducteurs américains – avait déjà capoté, alors que le travail de traduction et mon appareil critique étaient très engagés. Le projet des ayant droits était de publier bien plutôt une traduction complète, et sans aucun appareil critique, de L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, dont L’individuation psychique et collective ne livrait en fait que le dernier tiers. Cette traduction, assurée par Taylor Adkins qui avait déjà traduit des extraits de mon Penser l’individuation, parut dix ans plus tard. À ce jour, l’entretien entre Bernard et moi sur son rapport à Simondon est toujours inédit.
Ma rupture avec Bernard devint « définitive » – seule sa mort la rend vraiment telle – le jour où Bernard, ne voulant toujours pas comprendre les spécificités de mon humanisme décentré, en parla en séminaire doctoral – je le sus en le visionnant – comme d’un humanisme classique de type essentialiste. Moi qui lui reprochais justement de maintenir en sous-main la coupure anthropologique, je jugeais qu’il y avait là un comble, et le lui faisais savoir en des termes profondément indignés, auxquels il ne répondit jamais. Sans doute n’aurais-je pas réagi si vivement, de mon côté, s’il ne s’était rien produit entre nous auparavant. Sans doute serais-je aussi plus facilement revenu vers lui si son œuvre n’avait pas connu l’évolution ésotérico-rhétorique et la précipitation assertive que, comme tant d’autres, j’y voyais de plus en plus. Je veux aujourd’hui bien plutôt garder en mémoire toutes ces années de complicité, celles qui faisaient que malgré notre premier accrochage en 2012 il était venu en 2013 à la décade internationale « Simondon ou l’invention du futur » que Vincent Bontems et moi organisions à Cerisy, avait aussi envisagé le livre à quatre mains dont j’ai parlé, puis m’avait invité une fois de plus à parler en 2014 à l’Académie d’été d’Épineuil-le-Fleuriel.
Il sera pour nombre d’entre nous, c’est certain, un interlocuteur central par ses textes, voire même un objet d’exégèse – telle sera ma tâche propre, pour ce livre que je veux lui consacrer. Pour d’autres, il restera le maître qu’il a voulu être à la manière des célèbres Maîtres français de l’époque de Lacan, Deleuze et Derrida – mais avec un sens hyper-développé du collectif politique -, et dont il faudrait prolonger l’œuvre – et l’action.
Dans mon propre parcours de vie et de pensée, il fut et restera le grand-frère en philosophie, celui dont l’œuvre m’a aidé, dans la complicité comme dans le dialogue critique, à développer conceptuellement mes intuitions de jeunesse, avec pour foyer commun l’obsession inhérente à tout véritable projet philosophique.
© Jean-Hugues Barthélémy
Notes :
[1] Les deux volets de Penser l’individuation en 2005, issus des trois premières parties de ma thèse de doctorat Sens et connaissance (2003), puis l’ouvrage de synthèse Simondon ou l’encyclopédisme génétique en 2008, et enfin, en 2014, le Simondon que m’avait demandé le regretté Richard Zrehen pour la collection « Figures du savoir » aux Belles Lettres, et qui me donna l’occasion d’évoquer aussi les cours de Simondon, ainsi que son actualité et ses postérités. L’opuscule Life and Technology : An Inquiry Into and Beyond Simondon (Meson Press, 2015), lui, réunit les traductions anglaises de deux articles d’abord publiés en français. Quant aux six numéros des Cahiers Simondon, ils m’ont permis de publier entre 2009 et 2015 les chercheurs français et étrangers qui me paraissaient les plus compétents sur Simondon, et dont certains devaient constituer entre 2014 et 2019 l’équipe du Centre international des études simondoniennes, créé à la suite de la Décade internationale « Simondon ou l’invention du futur » que Vincent Bontems et moi avions organisée à Cerisy en 2013.
[2] Jean-Hugues Barthélémy, La Société de l’invention. Pour une architectonique philosophique de l’âge écologique, Paris, Éditions Matériologiques, 2018. Pour une introduction à cet ouvrage, voir l’interview en deux parties aux liens suivants : https://www.implications-philosophiques.org/varia/entretien-jean-hugues-barthelemy/
http://www.implications-philosophiques.org/varia/entretien-jean-hugues-barthelemy-2-2/
[3] Bernard refusait l’idée d’anthropologie pour qualifier sa pensée de la prothéticité de l’humain, sous prétexte de pensée philosophique. Mais je soutiens qu’il a en fait renouvelé la tradition de l’anthropologie philosophique. L’entretien inédit que nous avons enregistré en 2013, et que j’aurai l’occasion d’évoquer rapidement plus bas, est révélateur d’un malentendu à cet égard, sur lequel il me faudra revenir dans l’ouvrage que je lui consacrerai. Par-delà ce simple malentendu, la question de fond est celle de savoir comment secondariser l’ontologie, et sur ce point je soutiens que sa voie propre ne peut le faire parce que l’humain, auquel il s’attache pour le rendre prothétique, dérive malgré tout de l’animal non-humain au lieu de rendre possible une problématique qui serait plus fondamentale que l’ontologie. Je rappellerai ici même en quoi la pensée de Bernard, à l’instar de celle de Sloterdijk, présuppose une coupure anthropologique résiduelle, dont il refusait tout bonnement de parler mais dont sa pensée a besoin. Voir sur ce point également La Société de l’invention, op. cit., §10.
[4] L. Wittgenstein, De la certitude, trad. J. Fauve, Paris, Gallimard, 1976, respectivement, n°121 et n°305.
[5] Voir le dernier chapitre de Penser la connaissance et la technique après Simondon, Paris, L’Harmattan, 2005.
[6] J’ignorais, au moment où je choisissais Lecourt comme directeur de thèse, qu’il avait en fait consacré sa propre thèse à Wittgenstein et Popper.
[7] Avec la réforme du baccalauréat, Simondon, à l’instar de Rawls ou de Jonas, a fait son entrée dans la liste officielle des auteurs qui accompagnent le programme de notions à étudier. L’Éducation Nationale m’a demandé de rédiger la présentation de son œuvre pour la ressource numérique DGESCO.
[8] Le texte de Bernard est « Le théâtre de l’individuation. Déphasage et résolution chez Simondon et Heidegger », et le mien est « La question de la non-anthropologie », l’ouvrage collectif où ils figurent réunissant en fait deux journées d’études distinctes et étant édité par le regretté Jean-Marie Vaysse sous le titre Technique, monde, individuation. Heidegger, Simondon, Deleuze (Olms, 2006).
[9] Bernard Stiegler, Prendre soin 1. De la jeunesse et des générations, Paris, Flammarion, 2008, p. 12.
[10] In P-E. Schmit & P-A. Chardel (dir.), Phénoménologie et technique(s), Le Cercle Herméneutique Éditeur, pp. 199-226.
[11] In J-L. Déotte (dir.), Le milieu des appareils, Paris, L’Harmattan, pp. 97-108.
[12] Trad. M. Hayward & A De Boever, in SubStance, n°3/2012, University of Wisconsin Press, pp. 60-75.
[13] Voir Intellectica, 53-54, 2010/1-2, pp. 51-66, et ma présentation de ce texte pp. 41-42.
Bonjour Jean-Hugues, j’ai pensé à toi récemment, forcément.
Je viens de lire cet article et je me permets donc un message amical dans ces circonstances tristes et surprenantes pour moi qui venais de lire « Bifurquer ».
Bien à toi,
Anne Morin-Audebrand
J’aimeJ’aime
Pingback: Entretien avec Jean-Hugues Barthélémy : « L’écologie sans la refondation du droit au profit des non-humains, c’est de l’anthropocentrisme persistant protégeant l’équilibre biosphérique pour sauver l’humanité » | Un Philosophe