
Laurent de Sutter © Hannah Assouline
Laurent de Sutter est professeur de théorie du droit à la Vrije Universiteit Brussels. Il dirige la collection Perspectives critiques aux Presses universitaires de France et la collection Theory Redux chez Polity Press. Dernièrement, il a publié Pornographie du contemporain (La lettre volée, 2018), L’âge de l’anesthésie: La mise sous contrôle des affects (Les Liens qui Libèrent, 2017), ou encore Après la loi (PUF, 2018), que nous avions qualifié de grande œuvre philosophique de ce début de siècle et qui vient d’être récompensé par le décoré du Prix Léopold Rosy de l’essai de l’Académie Royale de Belgique. Fidèle interlocuteur de notre revue, il est ici question de son dernier ouvrage en date Qu’est-ce que la pop’philosophie ? aux Presses Universitaires de France, renouant avec son écriture ciselée travaillant un texte aussi court et percutant qu’un coup de fusil. La victime ? La philosophie telle qu’elle est pratiquée, éditée et enseignée encore aujourd’hui. A partir de certaines intuitions formulées par Gilles Deleuze, voilà un texte redessinant avec brio les marges de la philosophie, avec rigueur, en forme d’incipit à la pensée pop’philosophique à venir dans ce XXIème qui débute. Nous avons saisi l’occasion de cette nouvelle publication pour renouveler la discussion avec l’auteur — avec qui le « pop’ » précédent philosophie sonne aussi comme un « pan! ».
Dans votre nouvel ouvrage, la philosophie se trouve prise comme objet à partir duquel penser quelque chose, dans la veine de Qu’est-ce que la philosophie ? de Deleuze et Guattari. Selon vous, l’écriture pop’philosophique est-elle celle qui permet d’échapper aux vieilles méthodes universitaires du commentaire supplémentaire d’auteurs supplémentaires ?

« Qu’est-ce que la pop’philosophie ? », Laurent de Sutter (PUF, 2019)
Laurent de Sutter : C’est du moins ce dont, de son propre aveu, rêvait Gilles Deleuze. Lorsqu’il évoqua pour la première fois le concept de pop’philosophie de manière articulée (dans la lettre-postface qu’il donna pour le livre de Michel Cressole consacré à son travail), c’était pour reconnaître que la pratique de la philosophie qu’il tentait de mettre en œuvre avec Guattari demeurait bien loin de la « pop’philosophie, la pop’analyse rêvée ». Je crois que cette dimension de rêve, et l’horizon d’échec qui en délimite l’écologie, est capital pour comprendre en quoi, pour Deleuze, répondre à la question « Qu’est-ce que la philosophie ? » n’est pas la même chose que répondre à la question « Qu’est-ce que la pop’philosophie ? » Là où la première, suivant la définition fameuse qu’il en donna, est création de concept, la pop’philosophie est autre chose, qui ne pouvait, à ses yeux, que demeurer dans une espace virtuel – comme une inspiration à laquelle ordonner tout le reste. La pop’philosophie, par conséquent, n’est pas création de concept, et ne peut pas l’être, parce que la création de concept constitue encore une activité rattachée à ce qui, toujours selon Deleuze, se distingue de la pensée rêvée, à savoir l’université, la morale ou l’érudition – ici, sans doute, l’université. La création de concepts demeure une pratique de lecture relevant d’une histoire, d’un héritage, d’une tradition nouée de manière inextricable avec la philosophie comme discipline universitaire fonctionnant dans son monde propre, à partir de ses propres enjeux. Du moins, c’est l’hypothèse qu’on peut suggérer : qu’il y a, chez Deleuze, une sorte de regret hantant jusqu’à l’idée la plus positive qu’il ait pu se faire de la philosophie comme discipline – une discipline à laquelle il ne voulait ou ne pouvait pas renoncer tout à fait. Par hypothèse, donc, la pop’philosophie ne peut être qu’autre chose, qu’une anti-discipline, ou une a-discipline, un espace de création qui fasse voler en éclat jusqu’à l’idée de discipline. Or, parmi les attendus de l’idée de discipline, il y a en effet celle de son matériau ou de son objet – c’est-à-dire du morceau de monde qui lui est cédé en usufruit exclusif, à charge pour elle de le faire fructifier en bon père de famille, comme disent les juristes. Dans le cas de la philosophie, ce morceau n’est nul autre qu’une bibliothèque : celle des textes qui prétendent s’interroger sur, comme le dit Patrice Maniglier dans le fascinant recueil d’entretiens qu’il vient de faire paraître, ce qui est « Premier ». Ce « Premier » peut être le temps, l’espace, l’être, la vérité, le bien, la représentation, l’esprit, la raison, etc. – cela importe peu pour autant qu’il puisse être instauré comme le point à partir duquel la totalité de l’ordonnancement du monde peut être actée. Parfois, bien entendu, cette totalité peut être négative et l’ordonnancement en question n’être acté que comme vide, comme ratage ou comme impossible, mais, du point de vue de la structure, les conséquences en sont équivalentes : pour qu’il y a vide, ratage ou impossible, il faut qu’il y ait une archè d’où déduire son absence. Je crois que le rêve de Deleuze était le rêve d’une pratique de la pensée qui n’ait besoin ni de recourir à la bibliothèque constitutive de la tradition philosophique, ni d’en passer pour l’obsession du « Premier » – et, a fortiori, par les listes des items que la tradition philosophique a voulu placer à cette place. J’imagine, en tout cas, que c’est la raison pour laquelle il a insisté, toutes les fois où il a évoqué le concept de pop’philosophie, sur le fait qu’elle désignait une pratique de la lecture : c’était à partir du lieu de la lecture qu’il était possible de sortir de la bibliothèque de la philosophie et de s’en choisir une autre, ou aucune.
Strip-tease, putains, kamikaze, super-héros, pornostars, Jeff Koons ou encore récemment Jack Sparrow sont autant d’objets dont vous vous saisissez dans chacun de vos ouvrages, afin de les traverser, sans pour autant réduire vos travaux à écrire sur ces objets. Ils ne correspondent, vous en conviendrez, à aucune des thématiques classiques de la philosophie. Au paragraphe 45 de ses Thèses pour une réforme de la philosophiede 1842, Feuerbach affirme que « la philosophie ne commence pas avec elle-même, mais par […] la non-philosophie».Est-ce à dire que l’écriture pop’philosophique doit travailler à partir des marges de la philosophie, c’est-à-dire de ce qu’elle exclut de son champ habituel tels que des déchets ou des ordures ?

« Des détritus, des déchets, de l’abject. Une philosophie écologique », François Dagognet (Les Empêcheurs de penser en rond, 1998)
Je dois avouer que j’ai été très frappé par la lecture de Des détritus, des déchets de l’abject, du regretté François Dagognet, dont j’avais découvert les travaux par Isabelle Stengers et Bruno Latour. Dans ce livre, Dagognet en appelait à ce qu’il nommait une « matériologie » : non pas un matérialisme, au sens le plus trivial qu’on peut donner à ce mot, c’est-à-dire la simple affirmation de la primauté du monde matériel sur ce qui serait, par ailleurs, un monde spirituel, mais une véritable assomption de ce que tout est matière, en ce compris le plus abstrait, le plus immatériel, parce que tout est affection. D’après Dagognet, un regard matériologique doit de façon nécessaire considérer ce qu’il y a non pas dans sa plus grande splendeur (celle de sa vérité, de son idée, de sa maturité, peu importe), mais dans la totalité du spectre allant de sa génération à sa disparition, en passant par toutes les étapes intermédiaires de ce qui n’est au fond qu’un vaste processus de pourrissement. Toute vie est corruption – et c’est l’acception de la dimension de corruption de la vie qui permet de la regarder comme autre chose que l’affirmation à la limite de la souveraineté de ce qui vit. En réalité, ce moment de souveraineté n’arrive jamais, de sorte qu’observer les détritus, les déchets ou l’abject est observer l’état normal de tout ce qui est ; ce sont les détritus, les déchets et l’abject qui sont le lieu de la vérité et non le grand, l’essentiel ou le supérieur. Il me semble qu’il y a là une leçon très importante à méditer, et qui est très différente de celle liée à l’exigence, comme le fait Feuerbach dans le texte que vous citez, mais comme ont pu aussi le faire François Laruelle ou Georges Canguilhem, de la nécessité pour la philosophie de reconnaître dans la « non-philosophie » ou dans la « matière étrangère » sa condition (je pense aussi à Alain Badiou). Dans tous ces cas, ce qui me semble à l’œuvre est l’idée que la philosophie doit pouvoir triompher à un moment donné de la condition posée à son déploiement – et si jamais il s’agit de quelque chose de bas, de nul ou de négligeable, de parvenir à le transfigurer par la puissance du concept. C’est-à-dire à le réinscrire à l’intérieur du catalogue plus ou moins vaste de catégories par lesquelles la tradition philosophique nous a appris à distinguer le « Premier » dans le monde, en tant que celui-ci demeure l’horizon final de son activité. On pourrait faire l’exercice chez Feuerbach comme chez Canguilhem ou Laruelle : quoi qu’il en soit de la trajectoire singulière des œuvres, elles finissent toujours par retomber sur l’affirmation fondamentale d’une sorte de nécessité de la philosophie. Du reste, c’était aussi le cas chez Deleuze, par exemple lorsqu’il s’intéressait au droit, dont il disait d’un côté que la jurisprudence qui le travaille devrait constituer l’horizon de la philosophie, pour mieux soutenir, de l’autre, que c’est bien à la philosophie qu’il revient de poser cet horizon. En ce qui me concerne, je dois bien reconnaître que je m’en fiche pas mal, de la philosophie ; si je m’intéresse à quelque chose, c’est parce que cette chose me semble introduire une différence dans le monde dont je tente de suivre le déploiement. Cette différence peut être de toute sorte ; la seule chose dont je suis à peu près certain à son propos est qu’il s’agit à chaque fois d’une différence sensible, concernant les corps, et non pas la question du temps, de l’espace de la vérité ou que sais-je. Mon destinataire n’est jamais la philosophie mais, en bon matériologue, la manière dont la matière affecte la matière dans le processus même de sa transformation – si cela peut avoir des conséquences philosophiques, tant mieux, mais ce ne sont pas elles qui m’intéressent, car ce ne sont pas celles qui me paraissent les plus urgentes. Or je crois que je ne travaille qu’à la condition de l’urgence : les différences qui m’intéressent présentent (ou me paraissent présenter) l’intensité de l’urgence, et c’est cette intensité dont je tente de me faire le relais. Je pense dans l’urgence, et pas dans l’éternité.
Jamais les textes dits de pop-philosophie tel que vous les écrivez, les éditez ou les recensez (comme succinctement à la note de bas de page 28) ne sont des ouvrages qui travaillent sur un objet, c’est-à-dire qui le soumettent à la philosophie. Deleuze disait justement dans son Abécédaire qui fallait en philosophie toujours penser avecou écrire pour. Dans quelles mesures cette approche pourrait correspondre, d’après vous, au statut même de la pop’philosophie ?
C’est une excellente question. Je pense que la distinction que vous rappelez touche à un point capital, qui est celui de la démocratisation de la pensée, c’est-à-dire de la politique des places qui y est mise à l’œuvre par ceux qui se sont octroyés le pouvoir de décider de son ordre, à savoir les philosophes eux-mêmes. L’histoire de la philosophie est en effet celle de l’introduction d’un paramètre de distance plus ou moins important à l’intérieur de la relation supposée unir, suturer ou séparer celui qui pense de ce qui est pensé – distance qui est toujours équivalente à x > 0. Cela a défini la scène de la philosophie comme un théâtre défini par une règle de frontalité, installant le regard à une place lui imposant comme principe le fait de voir les choses en face, au sens aussi où voir les choses en face implique d’y voir clair. Le corollaire de cette scénographie ségrégationniste de la pensée est bien entendu que cette dernière ne peut s’exercer que « sur » son objet, de la même manière que le chirurgien se penche « sur » son patient, une fois celui-ci transformé en masse inerte par l’anesthésie. Rien de plus métaphysique, soit dit en passant, que l’anesthésie. Il va de soi que, dans un tel contexte, l’ « objet », la « chose », bref, ce sur quoi se penche le penseur n’est guère mise en situation de dire ou faire quoi que ce soit ; elle n’est que l’occasion passive de la mise en œuvre d’une science destinée à lui rester étrangère, même si elle a besoin de son « cas » pour se déployer. C’est encore pire, d’ailleurs, lorsqu’on prétend « respecter » ce qu’on pense – dans la mesure où à l’insulte du regard venu du haut se surajoute une pétition de fragilité conférant au regard le supplément de grandeur qu’il y a à faire preuve de tact, de mesure ou d’accueil.
Rien de moins respectueux que le respect, car il s’agit encore d’une manière de se montrer plus fort que ce que l’on pense, d’assujettir ce que l’on regarde aux catégories par lesquelles ont le regarde, au premier rang desquelles figure précisément le « respect ». Plutôt que de respect, ce dont nous avons besoin est, comme Deleuze l’avait signalé, d’un « pour » ou d’un « avec », c’est-à-dire de travailler à la construction d’un agencement de penser qui ne mette pas en présence un « objet » et un « sujet », mais procède à l’invention d’un être nouveau et hybride, une sorte de centaure épistémologique. Penser « avec », c’est devenir ensemble, travailler à des conséquences inédites emportant le composite centaure vers un ailleurs dont l’horizon est la remise en cause des conditions même de regard qui en avaient initié le mouvement de constitution. Et écrire « pour » revient » à attester de ces conséquences, à en déployer les potentialités le plus loin possible, en un processus qui soit expérimental au vrai sens du terme, à savoir celui de l’exploration d’un espace de non-savoir ne cessant jamais d’aspirer le savoir, plutôt que l’inverse. Dans un tel contexte, plus besoin de théâtre, plus besoin de frontalité, plus besoin de force, puisque cette dernière n’est rien d’autre, désormais, que la capacité des conséquences nées de la création d’un agencement épistémologique à produire d’autres conséquences. A mon sens, c’est là la définition même du pragmatisme – en tout cas, c’est celle que j’ai retenue de ma fréquentation d’Isabelle Stengers. Et il me semble que c’était aussi ce que Deleuze avait en tête lorsqu’il parlait de pop’philosophie : plus que l’affirmation vide d’une tolérance ontologique se donnant par-derrière les moyens de reprendre le pouvoir sur ce qu’elle tolère, de parquer les êtres dans une sorte de zoo égalitaire, il s’agit de devenir un être nouveau au contact avec ce qu’on rencontre. Ce processus de transformation correspond assez bien, je crois, avec l’idée de « passage » qui accompagnait, chez Deleuze, la formulation du concept de pop’philosophie : il faut que quelque chose passe, qui soit de l’ordre de l’ « électricité », disait-il. Peut-être que cette électricité n’est nulle autre, dans le domaine du savoir, que celui d’un devenir hybride s’ouvrant au déploiement d’autres modalités du regard – non plus frontal, mais latéral, parallactique, myope, flou, aveugle ou même saturé.
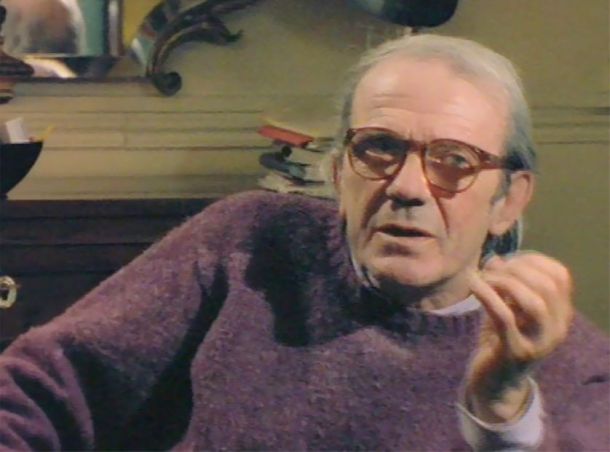
Capture d’écran de l’Abécédaire de Gilles Deleuze
A plusieurs reprises, vous exprimez l’idée géniale selon laquelle la pop’philosophie doit se saisir de quelque chose qui n’est « rien » pour en faire « quelque chose ». De plus, si nous nous en tenons à Perspectives critiques, il faut dire que cette collection regorge d’ouvrages et de textes que l’on ne retrouve pas ailleurs. Ce texte n’est-il pas une manière, voire une propédeutique afin d’envisager votre travail d’écriture et votre travail d’éditeur ?
Oui, je crois. Il y a en tout cas une connexion très forte entre mon travail personnel et celui que je mène comme éditeur : celle qui consiste à refuser avec la dernière force de se laisser aller au plaisir de rassurer telle ou telle des innombrables micro-côteries dont la vie intellectuelle est faite. Je dois d’ailleurs avouer que je trouve la situation contemporaine assez critique de ce point de vue : tout se passe, désormais, comme si certains mots-clés (comme « soin », « décolonial », etc.) suffisaient pour produire un signe de pensée considéré comme décisif dans l’esprit de nombreuses personnes. Cela ne laisse pas de m’inquiéter, dans la mesure où je ne vois d’intérêt à la pensée que dans le cheminement inverse, à savoir la déstabilisation, l’inquiétude par rapport à tout mot qui prétendrait être « Premier », aussi transitoire, circonstanciel ou stratégique soit-il. J’éprouve le sentiment que les mots-clés en question sont destinés à jouer le même rôle, dans la « gauche radicale » d’aujourd’hui, que ceux jadis brandis par les « Nouveaux Philosophes » devaient le faire pour la « gauche antitotalitaire » : faire clan. C’est d’autant plus triste que les combats qu’ils recouvrent sont nobles et, précisément, urgents – de sorte qu’ils requièrent, à titre de condition minimale, que l’on fasse un peu d’effort de pensée pour se montrer à leur hauteur ; or c’est cet effort que je ne vois pas. La seule chose que je vois, c’est que les arbres, les subalternes et les migrants, c’est bien, en une sorte de pétition morale atroce qui, à nouveau, n’a pas d’autre but ou objet que de placer celui qui la formule dans une position où il remporte deux fois la mise : il demeure au-dessus de ce qu’il pense, et il y gagne en grandeur morale.
J’ose croire que les livres que je publie dans ma collection, ainsi que les miens propres, procèdent autrement, et qu’ils s’ouvrent de manière véritable à la rencontre avec ce qu’ils croisent de telle sorte à ne pas démériter du mouvement pragmatiste que je signalais tout à l’heure. Vous avez raison de souligner à ce propos que ce mouvement ce traduit en effet par une transformation reposant sur l’idée que tout peut devenir quelque chose, même le plus nul, le plus vide, le plus rien – même les détritus, les déchets et l’abject, pour citer à nouveau Dagognet. Que n’importe quoi puisse devenir quelque chose n’est pas une affirmation triviale : elle implique au contraire un nombre considérable de conditions, dont celles qui concernent le changement de position de pensée que j’ai aussi mentionnée tout à l’heure. Faire de n’importe quoi quelque chose, c’est passer d’un espace de pensée où un « objet » se définit selon l’ordre des qualités (grand ou petit, beau ou laid, important ou futile, etc.) à un agencement de déployant selon les potentialités de son devenir. A l’intérieur d’un tel agencement, les « qualités », en tant que propriétés, sont indifférentes, dans la mesure où elles ne produisent rien : la grandeur, la beauté ou l’importance n’ont jamais rien produit ; elle ne sont que le résultat d’un jugement venant confirmer la puissance de ce qui est susceptible de le formuler. Une qualité confirme, là où un agencement infirme – telle est peut-être la plus importante leçon de la pop’philosophie : une qualité ne dit rien, ne fait rien, ne vaut rien, tout simplement parce qu’elle ne fait rien ; on s’en fout qu’un texte, un film, un geste politique, soit grand ou pas. La seule chose qui nous intéresse (ou, en tout cas, qui m’intéresse moi) est de savoir ce qu’il rend possible, ce qu’il permet de faire – au sens intransitif d’un faire faire, d’une contrainte irrésistible à faire. Si j’écris sous la pression de l’urgence, c’est donc avant tout celle de ce avec quoi je me branche, je m’hybride dans la rencontre, et non pas celle d’un contexte qui l’exigerait de moi, par une sorte de principe que je n’aurais pas le droit de remettre en cause. J’espère que mes livres rendent cela perceptible.
Dans un entretien télévisé de 22 mai 2002 dans l’émission Cultures et dépendances animé par Franz-Olivier Giesbert, Jacques Derrida affirmait que tout philosophe tente sans cesse de répondre à la question « qu’est-ce que la philosophie ? ». Néanmoins, au paragraphe 213 de Par-delà le bien et le mal, Nietzsche écrit ceci : « Il est difficile d’enseigner ce qu’est un philosophe, parce qu’il n’y a rien à apprendre : on doit le « savoir » d’expérience, ou avoir l’orgueil de ne pasle savoir. Si de nos jours chacun parle de choses dont il ne peut avoir aucune expérience, cela est vrai surtout du philosophe et de l’esprit philosophique : très peu d’hommes connaissent cet esprit, peuvent le connaître, et toutes les opinions populaires sur ce chapitre sont fausses ». Souscrivez-vous à cette idée ? Ajoutons à cela l’idée que vous proposez en énonçant que la pop’philosophie ne veut rien dire.
Oui, vous avez raison. L’idée que la pop’philosophie ne veuille rien dire, c’est-à-dire qu’elle ne se déploie pas depuis une exigence de sens, mais plutôt depuis les potentialités qu’offre le non-sens, l’absence de sens, ce qui implique qu’il soit toujours à construire n’est pas sans lien avec le ne-pas-savoir évoqué par Nietzsche. J’irais même plus loin que lui : nous avons un besoin urgent de crétins. Il y a trop de gens intelligents, cultivés, sachant – beaucoup trop, en particulier dans les parages de la philosophie, qui semble encore aujourd’hui fonctionner comme un aimant à cerveaux qui carburent trop, qui moulinent à mort la fumette métaphysique. Ce qui est fascinant, avec les drogués du concept, c’est de voir à quel point il s’agit d’une drogue addictive : toute chose, toute parole, toute idée, sous leurs mains, doit toujours ramener au conatuschez Spinoza, aux ressemblances de famille de Wittgenstein, à l’esprit absolu selon Hegel. Impossible de dire la moindre chose sans qu’ils viennent aussitôt vous rabâcher les oreilles avec leur culture philosophique – oxymore qui dit assez la totale inutilité qui est celle du mouvement de pensée dont il est question ici : l’inutilité du concierge. Or je crois que ce que nous dit la pop’philosophie, c’est qu’un concept sans enjeu n’est pas un concept : compte comme partie intégrante du travail du concept le fait qu’il se constitue comme un problème au sens le plus radical du terme – non pas un puzzle pour esprit oisif, mais, à nouveau, une urgence qui saisisse les corps. Une telle urgence peut prendre un nombre à peu près infini de visages, dans la mesure où, par définition, on ignore ses traits tant qu’une rencontre ne l’a pas fait naître, sauf qu’il engage toujours à la réécriture d’un régime spécifique d’affection. Il y a urgence lorsque la manière dont des corps s’affectent atteint un point d’impossible (disons de réel pour parler lacanien) qui appelle la reconfiguration du nœud d’affection en question – un appel qui est inaudible en-dehors de la contingence d’une rencontre. Notons que n’importe quoi peut être rencontré : une équation, l’Union Européenne, la chaise d’un philosophe analytique ou celle d’un psychanalyste, une licorne, Elric le Nécromancien, une Gibson ES330, le virus de la grippe ou une personne qui m’attire.
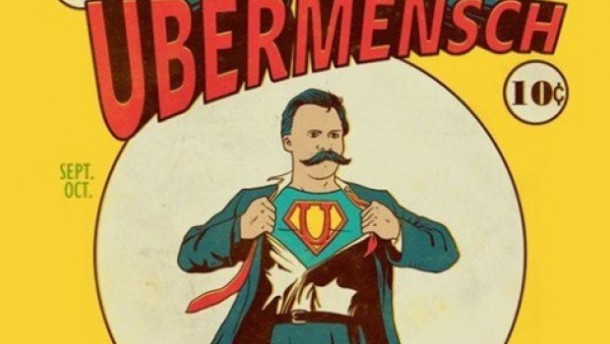
Lorsqu’on parle de rencontre, la tendance est d’imaginer une sorte de face-à-face comme on en voit dans tous les restaurants et cafés ; mais, précisément, la topologie de la rencontre, pour qu’il y ait rencontre, ne peut que prendre une forme autre que celle d’un rendez-vous Tinder. La rencontre peut arriver de partout et sous toutes les formes ; dans ce domaine-là aussi, il n’y a rien à savoir, aucune « culture de la rencontre » à vouloir construire, aucune intelligence de la manière dont on se tire d’affaire lorsqu’une urgence vous saisit du dehors. De ce point de vue, il n’y a rien de plus nécessairement concret que la pensée, puisqu’elle ne peut se déployer qu’à la condition, toujours aléatoire, d’une rencontre – là où trop d’individus continuent à croire que penser serait une activité ressemblant un peu à la méditation. En réalité, l’idée d’un problème qui serait éternel est une contradiction dans les termes : un problème est toujours transitoire et voué à l’obsolescence, ne fût-ce que parce qu’il exige de ceux qui se trouvent pris dans un agencement auquel il lui confère son urgence qu’ils se transforment à son contact. C’est ça, au fond, devenir quelque chose : c’est être transformé par un problème de telle sorte que cette transformation transforme aussi le problème lui-même – lui fasse faire un tour de piste supplémentaire, au terme duquel il revient avec une autre tête. Cependant, un tel ne-pas-savoir n’est pas pour autant une ignorance : rien de plus romantique que la figure de celui qui ignore et qui tire de ce fond d’ignorance la pureté d’une intuition qui ne serait pas entachée par la culture ou par le cirque de l’intelligence. Le ne-pas-savoir dont il est question n’est pas celui de l’innocence et de la pureté ; il est au contraire celui de la compromission totale avec ce qui nous entoure, sans considération aucune, comme je l’ai dit tout à l’heure, pour les qualités : il est un ne-pas-savoir qui se déploie sur la possibilité de tout savoir (et non de savoir le tout), pour reprendre une idée de Jean-Claude Milner que j’aime beaucoup.
Dans son histoire, la philosophie a toujours semblé indéfinissable mais s’est toujours comprise par ses bords et les disciplines qu’elle a engendrées comme la biologie, la zoologie, la psychologie, la phénoménologie, la sociologie, l’anthropologie…etc. Pourtant, vous ne proposez (et heureusement !) aucune règle ou aucun commandement, mais des thèses comme des lignes de fuites à l’usage de la pop’philosophie. En quoi la pop’philosophie permettrait à la fois de caractériser la philosophie et de la faire échapper au statut de « discipline » (avec toutes les acceptions liées à l’ordre et à la police que ce terme peut recouvrir) ?
Merci pour cette remarque. De fait, j’ai les commandements en horreur, en particulier dans le domaine de la pensée. Pas du tout parce que je nourrirais en moi quelque pulsion rebelle, mais tout simplement parce que tout « il faut » (en réalité, toute exigence déontique) se présente avant tout comme l’affirmation tendancielle de l’impossibilité d’autre chose. S’il faut, c’est soit qu’on ne peut pas faire autrement, soit qu’on ne veut pas que ce soit fait autrement – bref, dans tous les cas, on biffe un certain type de possibilité de l’horizon qu’on se donne, et ça, ça me rend complètement chèvre. Outre que c’est la stratégie adoptée par les gouvernants de la plupart des Etats dits « démocratiques » d’Occident depuis beaucoup trop longtemps, avec les résultats désastreux que l’on sait, il y a à l’œuvre dans l’affirmation du devoir une sorte de négationnisme métaphysique fondamental. Ce négationnisme est celui qui concerne précisément le possible : de ce qu’il y ait du possible s’ensuit de manière nécessaire que toutsoit possible à peine de n’être pas du possible – mais du probable, de l’éventuel, de l’imaginable, de l’envisageable, etc. De la même manière que n’importe quoi peut devenir quelque chose (et de n’importe quelle façon dans n’importe quelles circonstances), n’importe quoi est également possible – du reste, c’est ce que notre monde démontre par l’absurde plus souvent qu’à son tour. Donc, non, je ne suis pas très amateur de commandements. Ceci dit, je me rends compte que le mot « thèse », que j’aime utiliser pour sa tonalité un peu technique, un peu aride, ne vaut pas beaucoup mieux, puisqu’il ne désigne rien d’autre qu’un « position » ou une « posture », et on sait combien une position se garde ou se défend, un peu comme une forteresse. De sorte que j’ai tendance à préférer parler de « propositions » lorsque je me livre au genre de petit exercice de synthèse que l’on peut trouver dans certains de mes livres, dont Qu’est-ce que la pop’philosophie ? – même si je finis tout de même par recourir au mot « thèse ».
Disons que par « thèse », chez moi, il faut entendre « proposition », c’est-à-dire suggestion, question, scénario ou envie, dont tout l’intérêt, une fois de plus, réside dans ce qu’il rend possible, les conséquences qu’il est possible d’en tirer ou d’en construire. Le mode de fonctionnement de mes livres n’est pas celui du « et donc » (même si je n’hésite pas à recourir à l’affirmation fracassante et à la conclusion qui se voudrait irréfutable), mais plutôt celui du « et si » : j’aimerais que mes lecteurs voient mes livres comme une possibilité de se laisser aller à la pensée d’autre chose. Et si en effet n’importe quoi pouvait devenir quelque chose ? C’est une question qui m’a parue assez urgente et assez concrète pour mériter ce petit livre – urgence née de l’exigence de comprendre ce que signifiait ce mot souvent utilisé pour décrire ce que je fais sans que je comprenne vraiment pourquoi (sauf qu’il ne s’agissait visiblement pas vraiment d’un compliment). En accomplissant ce travail, il va de soi que je n’ai pas eu l’intention de me redonner les galons qu’on voulait me retirer, mais de proposer une version plus riche, plus porteuse de possibles du concept de pop’philosophie que celle que ceux qui l’utilisent comme insulte ne sont capables de l’imaginer. Bien entendu, le fait que, chez Deleuze même, celui-ci se dessine sur le fond d’un rêve de sortie de la philosophie ne pouvait que me séduire, moi qui, comme je l’ai dit, n’ai aucune passion pour la philosophie, voire même ai tendance à l’accuser d’une certain nombre de maux, à commencer par celui de la promotion de la figure du nomos, donc du commandement. Ce dont je rêve, moi, c’est en effet d’un monde où la pensée serait partout, sans classement ni division, et où la « philosophie » appartiendrait à une sorte de passé archaïque et un peu rigolo – celui où on considérait comme important de s’intéresser à la nature du temps, au destin de l’être ou à vérité de la beauté, et donc à la discipline qui prétendait s’y intéresser par vocation. Et je crois que ce rêve est tout à fait réel, tout à fait actuel. Je crois qu’il n’est pas un rêve – mais que Deleuze, qui était encore trop philosophe, ne pouvait pas l’accepter.
Entretien préparé par Jonathan Daudey
Propos recueillis par Jonathan Daudey
Pingback: Qu’est-ce que la pop’philosophie? – BCUL Le Blog
Pingback: Entretien avec Laurent de Sutter : « La raison n’est raison que parce qu’elle est délire » | Un Philosophe
Pingback: Qu’est-ce que la pop’philosophie? – BCUL
Pingback: Qu'est-ce que la pop'philosophie? | BCUL
Pingback: Entretien avec Laurent de Sutter : « La critique était une manière de gagner sur tout ; je cherche une pensée qui accepte de perdre sur tout – face à elle-même pour commencer » | Un Philosophe