
Gérard Bensussan et Jean-Luc Nancy
Un entretien entre Gérard Bensussan et Jean-Luc Nancy* [1]
Gérard Bensussan :
1. Je voudrais essayer d’introduire, de façon un peu erratique peut-être, sans doute trop grossièrement et parfois naïvement, à une série de questions sur la communauté, sur les résonances de ce mot de communauté, sur ses usages, sur sa pensée chez Jean-Luc Nancy. Je voudrais dire aussi que je n’ai pas de titre particulier à intervenir sur la communauté, ce qui n’est pas le cas des intervenants conviés, et ma participation à cette soirée n’a d’autre sens, si c’en est un, que la conversation amicale. Je le ferai donc en lecteur de Jean-Luc Nancy, et de quelques autres aussi bien sûr, Tönnies, Esposito. Je le ferai aussi, comme je viens de le dire, sans viser ni même articuler une critique, un propos ordonné jusqu’à une fin ou depuis cette fin, mais simplement en me posant quelques questions, en les adressant d’abord à Jean-Luc, mais aussi à vous tous, à nous tous, à notre communauté, la communauté de ceux que la question de la communauté intéresse et partage. Une considération personnelle, si je puis me permettre, pour commencer et introduire. Je dois faire le constat, un peu étrange, pour moi qui fut, et longtemps, communiste, de la faible fréquence, voire d’une certaine inimportance, si je puis dire, dans la langue et les thèmes philosophiques auxquels j’ai le plus souvent recours, de ce mot de communauté. Cela explique peut-être ceci, diront certains. Je n’en sais rien. Si j’avais à m’en expliquer, je dirais que le communisme fut pour moi et pour une génération au moins de communistes non point un état, Zustand, comme disait Marx, une consistance sociale et historique, pas même un état ou une communauté à venir (toute la rhétorique des socialismes dits utopiques, rhétorique radicalement révoquée dans le geste même de Marx, s’échine et s’enraye à décrire cette communauté à venir), mais un mouvement, un mouvement réel, soit la dislocation de l’état de choses existant, de la consistance telle qu’elle peut être connotée dans et par la communauté. Le mouvement contre l’Etat, le communisme contre la ou même les communautés, aliénées ou à venir. Nous reviendrons peut-être sur Marx parce que la vieille question marxienne de l’être social me paraît sans cesse croiser un thème comme celui de la comparution.
2. La vingtaine d’années qui nous sépare de la publication de la Communauté désœuvrée a été comme hantée par le double spectre d’une disparition et d’une menace. Disons qu’un contraste se marque fortement entre deux moments disjoints de la pensée (ou plutôt ou aussi des usages sociaux diffus) de la communauté. Il y a vingt ans, quelque chose se découpait et s’emportait sur le fond de la fin, d’une fin du communisme (ce sont les premiers mots de la Communauté désœuvrée), qu’on fût alors dans la déploration d’une perte ou la Schwärmerei d’un nouveau commencement. De nos jours, a contrario, menace ou menacerait l’hypostase de toutes les différences dans des communautés. De la fin du communisme au commencement du communautarisme, on aperçoit comment la mise au pluriel du terme de communauté emporte son retournement radical. Comme si, par conséquent, de communauté, il irait de soi depuis toujours, en tout cas depuis Aristote qui invente le terme de communauté en un sens spécifique, contre Platon (la koinonia constituant un système, une totalité de relations, et non pas une chose), qu’il ne peut y en avoir qu’une ou plusieurs fois une. Harmonieuse ou tendanciellement harmonieuse, totale ou processuellement totale et, par conséquent, foncièrement compréhensive-consensuelle. C’est la Verständnisde Tönnies, le consensus comme sens mis en commun, production de significations à quoi chacun a sa part, mais où l’organicité, le sens organique, précèderait toujours la part, la participation et le partage. Le sens communautaire, le sens de la communauté et la communauté de ce sens commun ne partage pas, il ne divise pas, il se partage au contraire, il est censé assembler ou pré-assembler des morceaux.

« La communauté désoeuvrée », Jean-Luc Nancy (Bourgois, 2004)
3. Depuis ce simple diagnostic, depuis ce constat : nous sommes passés du communisme perdu au communautarisme montant, un premier soupçon émerge. Le communautarisme dans ce qu’il peut porter de menace pour la « république » viendrait dire quelque chose d’une certaine vérité de la communauté qu’il faut bien prendre en charge. Au fond, le communautarisme, comme affirmation d’une pluralité foncière des essences singulières contre l’universalité et l’unicité abstraites d’une substance communautaire originaire et homogène, ne nous fait-il pas voir, à même le mot de communauté, à même son improbable mais très effectif maintien, la possibilité de déploiement de significations extraordinairement hétérogènes : la communauté nationale contre les communautés différentielles, la communauté européenne ou internationale contre les communautés nationales-étatiques. On voit bien qu’il y a là un éventail d’imbrications historico-politiques et d’antagonismes complexes dont l’aspect le plus paradoxal est qu’elles jouent selon la modulation d’un même, comme s’il en allait toujours d’une même essence, ou d’une même identité substantielle, qui se modaliserait et se phénoménaliserait dans des différences et des configurations tout à la fois majeures, décisives politiquement, mais inessentielles métaphysiquement. Le maintien de ce même mot de communauté signifierait son extension maximale, planétaire et « continue » comme dit Kant. Et en effet la communauté semble épouser spontanément l’idéal kantien d’une « communauté pacifique et continue de tous les peuples sur la terre » – continuité finie car, ajoute Kant, dans le Projet de paix perpétuelle, « la forme sphérique (de la terre) oblige [les hommes] à se supporter les uns à côté des autres parce qu’ils ne sauraient s’y dissiper à l’infini et qu’originairement l’un n’a pas plus de droit que l’autre à une contrée ». Le paradoxe qui fait donc question est bien décrit par Kant : une continuité, depuis la plus petite cellule communautaire jusqu’à la terre entière, et une finitude sphérique, si je puis dire, c’est-à-dire aussi une contiguïté, une communauté-une et/ou des communautés-plusieurs fois unes.
4. De l’hypertrophie universelle et continuée de la communauté (étatique-nationale puis internationale-terrestre) à ses hypostases ou micro-hypostases différentialistes proliférantes (lesquelles, dans leurs contiguïtés, impliquent d’ailleurs quelque chose comme la perspective d’une recomposition, d’un réassemblage, voire d’une refondation) : pourquoi parlons-nous, à chaque fois, de communauté pour signifier ces formes hétérogènes, hétéroclites, pourquoi un même mot pour des choses si différentes, si contraires les unes aux autres? Pourquoi, si j’élargis ma question jusqu’à la disrompre, la communauté ne se laisse-t-elle pas inter-dire, et pas seulement interrompre, depuis son « défaut de langage » (Blanchot) ? Pourquoi nous est-il impossible de la perdre [2]. Nous ne l’avons pas perdue car la question même de la comparution, c’est : qu’avons-nous fait de la communauté ?. Pourquoi communauté serait le nom même de la résistance à la communauté ? La réponse, celle de Jean-Luc Nancy, à ces pourquoi serait : parce que l’effacement sans reste de la communauté serait un désastre ontologique, un malheur de l’être comme être en commun et donc des singularités exposées les unes aux autres. La communauté, ce serait massivement cela, ce qui résiste, et ce qui résiste à l’immanentisation sans comparution des êtres singuliers, ce qui, ainsi, se communiquerait de place en place, de bord en bord, de singularité interrompante en singularité interrompante, ce serait cet espacement même. Cette résistance du sans (une communauté sans mythe, sans origine, sans fin, une « communauté-sans ») dirait la vérité de l’avec. Dans cette irrésistibilité de la communauté y va-t-il de la communauté ou seulement de son désir irrésistible –désir qui serait désir d’événements, d’événements du désœuvrement ? Si la communauté, c’est au fond ce désir, le désir de comparution, le désir que s’écarte enfin l’immanence pure et opaque de l’être communautaire, alors il est peut-être possible de se demander avec Levinas : « Quel sens peut revêtir la communauté dans la différence sans réduire la différence ? »[3]. Le désir de communauté comme désir de différence, que signifie-t-il pour la communauté immanentisée, toujours-déjà immanente ? La réponse que propose Levinas, c’est : « une corrélation absorbant la proximité »[4]. Même question, dans les mots de Derrida : « Pourquoi ces mots encore là où ils ne veulent plus dire ce qu’on a toujours cru qu’ils voulaient dire ? »[5]. Pourquoi le ne-plus-vouloir-dire l’absorption de la proximité ou de l’espacement de la comparution [6]doit-il se dire du même mot de communauté que la corrélation immanentisante ou la réduction de la différence ? Il y a donc là en suspens, un trouble –que je viens de dire avec les mots de Levinas ou Derrida. Trouble d’une communauté qui, sans se perdre comme communauté, serait capable d’interrompre sa propre onto-théologie, son propre organicisme de communauté-sujet. Qu’est-ce qu’une communauté comme impossibilité de la communauté, comme impossibilité de sa propre immanence, comme impossibilité d’un être communautaire comme sujet que la communauté justement assumerait et inscrirait en quelque sorte à même soi ?
5. Si on revient aux considérants de l’énonciation communautaire, ou de son exigence, jusqu’à la « communauté de ceux qui n’ont pas de communauté » (mais sans l’y inclure puisqu’elle s’en défait), on se trouve renvoyé à un présupposé qu’on peut dire fondatif, la fondation philosophique de la communauté (ce qui veut dire, de proche en proche, de la politique et de l’histoire). Ce présupposé fondatif se pré-articulerait, dans cette constellation communauté/politique/histoire, autour d’une essence à accomplir, ou à ré-accomplir, ou à récupérer. La communauté, la cité, l’Etat, le monde autant que le groupe, l’association constituée autour d’un commun et d’un même, serait ainsi le lieu de l’accomplissement réel d’une essence, l’espace où l’existence de l’homme se réaliserait dans une totalité de sens et de présence visant et incarnant en même temps un ordre du bien-vivre, ou bien une régulation, une auto-régulation depuis l’insociable sociabilité, ou encore un sujet historique collectif ou d’autres choses encore. Cette réalisation communautaire de l’essence, ce faire-œuvre de la communauté s’est historiquement constituée selon deux voies principales et non-exclusives :
— dans une transcendance destinale, la nation, par exemple, pour nous (et y compris dans sa forme monarchique, pré-révolutionnaire), soit dans une forme historiale qui viendrait supporter la vérité d’une essence co-incidente des individus (la communauté comme clinamen de ces individus, pour reprendre une très forte analyse de la Communauté désoeuvrée), à en produire la coïncidence tendancielle, ce clinamen des individus séparés qu’est la communauté ;
— dans l’immanentisation démocratique d’une transcendance, dont le mouvement aurait à accomplir un horizon de totalisation, si je puis dire, l’horizon d’une identification de la suppression de la politique avec sa réalisation, condition de la totalisation. Le dépérissement de l’Etat, singulièrement, au profit d’une nouvelle communauté qui, absorbant l’Etat en en relayant les fonctions, réaliserait à son tour une essence, ou une origine, un communisme primitif à venir, en quelque sorte, le parcours téléologique de l’accomplissement d’un dessein de la raison. On retrouverait alors, plus ou moins subrepticement, cette détermination générique de la communauté comme totalité organique –et au fond elle perdurerait à travers tous ses avatars sociaux ou sociétaux. On retrouverait la communalisation, la communisation à rebours de toute sociation, pour parler comme Weber, la Gemeinschaft à rebours de la Gesellschaft chez Tönnies. J’ai toujours été frappé par la façon qu’a Tönnies d’utiliser le mot de communisme pour désigner simplement une origine, une archi-origine, à savoir l’origine communautaire de toute subjectivation. La communauté fusionnelle de la mère et du nourrisson, il l’appelle communisme. L’œuvre de la communauté, ce serait alors cette communauté à deux où donner le sein est le premier partage commun (sans comparution, on voit bien pourquoi ici) où s’engage une appartenance. Le Sein est ontologiquement primordial –on a presque envie de lire sein comme Sein, Mit-Sein comme être-avec le sein, monde commun originé, matricé dans le sein maternel. Le lien social s’établirait selon une dynamique extensive (la continuité plus la contiguïté) qui irait de l’amour maternel au communisme en passant par l’amitié, qui serait donc matriciellement lié à un moment de fusion.
Entre la transcendance destinale et l’immanentisation ontologique, ou plus exactement à l’écart de ce couple dialectique, la communauté négative, celle qui nous intéresse. Ce serait la communauté qui ne s’effectue pas, contrairement à la nation ou au communisme, si on veut. Elle ne s’effectue pas dès lors qu’elle désigne encore un partage, mais pas le partage d’un propre, plutôt le partage d’un vide, d’un manque, d’un rien. Je songe ici autant, ou davantage, à Esposito qu’à Nancy. Le problème avec la négativité, inesquivable depuis son instruction hégélienne, c’est qu’elle risque toujours d’effectuer ce qu’elle n’effectue pas. Dans cette amphiblogie, se joue une inversion, la symétrie d’un renversement, plus qu’une destruction ou un anéantissement et ce qui se montre ce serait l’essence de l’essence (c’est un risque incessant en tout cas), l’essence vide, le vide d’essence de la plénitude communautaire identifiée. Cette essence de l’essence dirait ainsi (je ne dis pas que tel ou tel y succombe, mais qu’il convient d’être attentif à cette question quand on parle de communauté négative) l’ultime vérité ontologique de la communauté, la « communauté-sans » comme vérité de l’avec. En d’autres termes, et pour me tourner plus précisément vers la la communauté comme « tâche et comme responsabilité ontologiques de l’être-en-commun » (Nancy), vers la comparution, si la comparution, c’est la communauté en tant qu’elle ne s’accomplit pas, en tant qu’elle ne s’engendre pas comme un individu : la pensée de l’être-communautaire comme désœuvrement et comparution, n’emporte-t-elle pas à son tour, mais selon un tout autre mode, sous la loi de l’interruption et pas de la continuité, la détermination d’une essence communautaire plus essentielle, plus vraie que l’essence œuvrée/œuvrante de la communauté d’identification communielle, d’une essence de l’être social de l’homme ? Trouble, donc, là encore. La communauté embrasserait un spectre qui irait du désir de communauté à l’être social de l’homme. Ne peut-on pas dire d’ailleurs de la société ce que Jean-Luc Nancy dit de la communauté ?
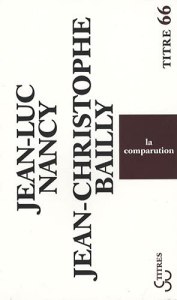
« La comparution », Jean-Luc Nancy et Jean-Christophe Bailly (Bourgois, 2007)
6. De fait, est-il seulement possible de penser quelque chose comme la communauté sans ipso facto référer ce quelque chose à l’individu ou au rien, au rien de l’individu, fût-ce pour ne voir dans l’individu qu’un artefact social (Tönnies) ou pour l’hypertrophier en individu collectif ou encore pour ouvrir à l’entrechoquement des individus depuis une déviation de leur chute, clinamen? N’y a-t-il pas une solidarité indéfectible, spectrale, structurale, de la communauté avec l’autre de la communauté (l’individu, la société, l’immunité, rien), mais un autre toujours déjà pris ou qui risque de l’être dans une dialectisation (puisqu’il est condition de possibilité de la pensée de la communauté), c’est-à-dire dans le mouvement d’une immanentisation, d’une sécularisation –par où se retrouveraient toutes les questions politiques que j’évoquais introductivement.
Je ne prétends pas, évidemment, apporter la moindre réponse à cette noria de questions, mais simplement indiquer quelques éléments de ma réticence devant le motif de la communauté.
D’autres vocables, associés chez Jean-Luc Nancy à la communauté, me semblent en revanche infiniment précieux, celui de partage par exemple, le partage des voix – soit quelque chose qui serait plutôt du côté du dia grec ou de l’entre du français que du Ge- allemand (c’est-à-dire du côté du collectif et finalement du destinal, Geschick). Un dia- qui ne serait pas celui d’une dialectique, mais d’un entre-nous, un entre-nous plutôt qu’un nous [7]. C’est peut-être cela qui est visé par la communauté sans, interrompue, désœuvrée, inavouable, etc. Entre-nous qui pourrait par ailleurs résonner, ou laisser résonner la question de l’altérité, avec l’entre-nous lévinassien, plutôt énigmatique d’ailleurs. On passerait alors à la possibilité du dialogue que « nous sommes » (Hölderlin), à nous entendre les uns les autres. Là aussi, les pièges et les périls ne manquent pas : celui de la communication par exemple. De la communication comme appropriation rationnelle, raisonnable, d’un consensus, d’un échange discursif qui formerait un espace réglé par des normes rationnelles, soit une communauté des locuteurs, quelque chose de tout à fait différent de la « communication » lévinassienne (titre d’un § d’AE) comme ce qui excède tout contenu signifié, une structure où l’exposition s’expose et où « manque toute communauté »[8], manque communautaire d’où vient que nous parlons sans pour autant en avoir jamais fini avec cette parole, avec son dire, sans pouvoir jamais faire communauté de ce manque (l’autre en son étrangeté n’a rien de commun avec moi, sinon je ne parlerais pas).
L’entre-nous, ou la communication au sens de Levinas, mettrait d’emblée en jeu, en question, toutes les communications d’essence et de présence attestées par la communauté –entre des éléments ou des conditions (l’essence, la substance, le sujet, le phénomène, l’origine), qui renvoient à l’appropriation ou la réappropriation du sens par la communauté, du sens qu’elle serait toujours-déjà, sur le mode de l’organique de Tönnies. L’entre-nous, c’est la comparution si on veut –mais avec une différence d’accentuation : l’entre, l’écart, souligne autre chose que le cum du paraître ensemble au monde. Comment penser ensemble le en du en-commun, soit le désœuvrement, ou le dis- (disparité, dislocation, dispersion) et le cum (de l’unus ou du munus), la continuité et la discontinuité, la contigüité et la distance ?
Pour formuler l’immensité de la question à la façon lapidaire d’un Levinas : pourquoi « communauté » ? Ou pour renverser la formule de Jean-Luc Nancy : qu’avons-nous à faire de la communauté ?
Jean-Luc Nancy : Ce sont des questions qui comportent leurs réponses, par ce que tu mets de façon continue dans ce que tu viens de dire, que je peux immédiatement dire sans bêtise rhétorique que je partage tout. Je partage tout sauf que je ne sais pas comment je le partage. C’est peut-être là l’amorce de toutes les questions c’est-à-dire que qu’on partage, nous partageons toi et moi la même interrogation, perplexité ou défiance envers le mot de communauté. Mais comment la partageons-nous ? A peine commençons-nous à parler qu’il est manifeste que pour l’un comme pour l’autre il y a ici un accent, là une nuance et puis certainement des histoires. Des histoires qui sont très importantes. En fait si je m’arrête un moment là-dessus, tu as commencé en disant que tu avais été longtemps communiste. Et tu as fait remarqué ensuite que la communauté comme telle occupait très peu de place chez Marx sauf sous la forme de ces diverses communautés qu’il prend comme étapes d’une histoire qui devient ensuite justement l’histoire de la destruction de forme de communauté et le communisme est le mouvement qui […] Evidemment je pense que tu le dis pour indiquer, pas du tout de façon biographique mais de façon théorique, pourquoi, comment tu peux être méfiant vis-à-vis de communauté.
Alors il est peut-être aussi significatif pour moi de dire « je n’ai jamais été communiste. » Je ne l’ai jamais été tout simplement parce que j’étais – je ne sais comment il faut appeler cela – un socialiste chrétien et qu’à un socialiste chrétien était d’avance donné – ce qui nous était donné dans les années, dans notre berceau – certainement quelque chose de la communauté en même temps que le mot n’était pas donné et que ce mot-là c’était le communisme qui le portait. Pas le mot de communauté mais le mot de commun. Et donc ce n’était pas quelqu’un comme moi mais quelqu’un qui grandissait sans doute dans l’esprit d’une communauté toujours déjà donnée, toujours déjà à l’horizon. Donnée alors peut-être sous la forme la plus éthérée, je ne sais pas quoi, du corps mystique du Christ avec lequel je ne sais quelle forme socialisante vague pouvait très bien s’accommoder en même temps qu’aucun instrument de véritable communautarisation – si on tient à l’écart ce mot de ce qui est devenu aujourd’hui communautarisme – n’était donné. Et en même temps il me semble que comme ça, entre ces deux trajectoires, la tienne et la mienne, qui n’ont rien de très particulier, qui sont banales, que nous partageons chacun avec plein d’autres, et bien se jouait quelque chose de très important et à quoi l’arrêt du communisme a apporté une exigence de problématisation et de verbalisation c’est-à-dire que à nous tous, parce que derrière le communiste et le communisme il y avait forcément aussi quelque chose du déjà donné chrétien (ça me rappelle le texte de Engels sur les premiers chrétiens et les premiers communistes). Je dirais volontiers que dans toute cette histoire, qui est l’histoire ou un aspect très important du XXe siècle, il s’est joué un trop donné de communauté contre un beaucoup trop peu donné de commun si tu veux.
 Je dirai ça d’abord parce que j’ai l’impression en effet que nous sommes allés, comme tu l’as dit, de la fin du communisme au début du communautarisme et là c’est comme s’il s’était produit une sorte de renversement avec accélérations extraordinaires du processus qui a nécessité de retrouver dans ou au-delà plutôt et contre le désert final du communisme cette communauté qu’on avait crue au fond toujours déjà donnée mais qui s’avérait n’être plus donnée nulle part, ni dans le communisme ni dans le christianisme ou toute autre forme (mais est-ce qu’il y en a une autre ?) d’assemblée ou d’assemblage mystique. Est revenue la nécessité de penser du commun et le communautarisme – que j’ai reçu en pleine figure aussi comme une gifle donnée au travail même que j’avais pensé devoir entreprendre sous le nom de communauté – dans ses crispations, dans ses essencifications, tout ce que tu voudras, témoigne contre nous et malgré nous d’un reste, d’un en reste, en trop. Et au nom de ça je n’oppose rien à tout ce que tu dis du point de vue des significations, de la pensée. D’une certaine façon jusque là je n’oppose rien. Mais quand tu dis « qu’avons-nous à faire avec la communauté ? » j’ai quand même envie de dire mais que nous veux malgré tout cette chose qui sous le nom, le signe l’index du cum qui résiste évidemment de la pire façon. Et qui en nous résistant de la pire façon indique quelque chose qui malgré tout résiste à ce que, à ceci que le mot de partage que tu avais dit – Dieu si j’aime ce mot de partage, mais Dieu sait si aussi ce mot (tu n’y as pas fait allusion) sur un autre plan où ce mot je le vois dévoré par une idéologie consensuelle. Il y a du partage partout. Du partage à tous les coins de journaux et il se trouve que je suis comme ça, avec les mots que j’ai trouvés les plus porteurs, comme communauté, partage – sens partage aussi le même destin – je me trouve devant une situation étrange où je me suis confié à des mots qui se trouvent se réapproprier à toute vitesse un espace public dans lequel ils dévoient systématiquement ce que j’ai voulu dire. Seulement cette histoire elle-même me semble signifier quelque chose.
Je dirai ça d’abord parce que j’ai l’impression en effet que nous sommes allés, comme tu l’as dit, de la fin du communisme au début du communautarisme et là c’est comme s’il s’était produit une sorte de renversement avec accélérations extraordinaires du processus qui a nécessité de retrouver dans ou au-delà plutôt et contre le désert final du communisme cette communauté qu’on avait crue au fond toujours déjà donnée mais qui s’avérait n’être plus donnée nulle part, ni dans le communisme ni dans le christianisme ou toute autre forme (mais est-ce qu’il y en a une autre ?) d’assemblée ou d’assemblage mystique. Est revenue la nécessité de penser du commun et le communautarisme – que j’ai reçu en pleine figure aussi comme une gifle donnée au travail même que j’avais pensé devoir entreprendre sous le nom de communauté – dans ses crispations, dans ses essencifications, tout ce que tu voudras, témoigne contre nous et malgré nous d’un reste, d’un en reste, en trop. Et au nom de ça je n’oppose rien à tout ce que tu dis du point de vue des significations, de la pensée. D’une certaine façon jusque là je n’oppose rien. Mais quand tu dis « qu’avons-nous à faire avec la communauté ? » j’ai quand même envie de dire mais que nous veux malgré tout cette chose qui sous le nom, le signe l’index du cum qui résiste évidemment de la pire façon. Et qui en nous résistant de la pire façon indique quelque chose qui malgré tout résiste à ce que, à ceci que le mot de partage que tu avais dit – Dieu si j’aime ce mot de partage, mais Dieu sait si aussi ce mot (tu n’y as pas fait allusion) sur un autre plan où ce mot je le vois dévoré par une idéologie consensuelle. Il y a du partage partout. Du partage à tous les coins de journaux et il se trouve que je suis comme ça, avec les mots que j’ai trouvés les plus porteurs, comme communauté, partage – sens partage aussi le même destin – je me trouve devant une situation étrange où je me suis confié à des mots qui se trouvent se réapproprier à toute vitesse un espace public dans lequel ils dévoient systématiquement ce que j’ai voulu dire. Seulement cette histoire elle-même me semble signifier quelque chose.
G.B. : Qu’est-ce qui, pour toi, tient dans la communauté et qu’est-ce qui fait que tu tiens à ce mot même de communauté ? Et qu’est-ce qui s’engage autour de ce maintien, pour toi, d’un rapport entre ce que l’on pourrait appeler une ontologie de la comparution, c’est-à-dire une structure quasi-transcendantale, et le désœuvrement ? Désœuvrement dans des événements. Et, alors, la question du politique se pose à l’horizon ou dans la perspective de cette articulation entre l’ontologie de la communauté, de la comparution, et l’événement du désœuvrement. Tu tiens à ce terme, donc. Effectivement, entre nous, il y a des déplacements d’accentuation, c’est tout à fait remarquable. Ce que tu dis du sens m’y fait penser. Il y a chez toi quelque chose, comme pour la communauté, comme pour le partage sans doute, qui te contraint à maintenir l’usage de ce mot de sens, à l’écart de tout usage du mot de vérité.
J.-L. N. : Non, non.
G.B. : Mais il me semble qu’on pourrait très bien dénier tout usage possible du terme même de sens,dans la mesure où tout sens se fixe ontologiquement, et en revanche tourner autour d’un travail de la vérité qui serait un travail infini, indéfini, d’ouverture sans fixation d’un sens. Tu ne renonces pas au sens, au mot de sens. Dans le geste même de renoncement au sens – il y aurait à faire sens, fût-ce sur le mode du désœuvrement, et en particulier sur ce mode désœuvrant.Mais tu refuses en revanche, il me semble, celui de vérité qui connoterait la dimension d’un absolu ou d’une transcendance dans un rapport dogmatique d’obéissance ou de soumission. Mais il y a aussi peut-être une vérité qui échappe à toute transcendance, qui vient de l’immanence, une vérité qui n’est pas révélée, mais exposée, celle précisément qui ne peut s’épuiser dans un sens, une vérité infinie dont le langage forme l’expression, l’actualisation. Une vérité qui serait rapport à l’infini. La philosophie, ce pourrait être ce rapport : le langage renvoyé à sa puissance de vérité, à la « puissance infinie de la raison » (Schelling). Cette vérité infinie, ce serait, elle serait de l’ordre d’une nomination, toujours à la limite de l’impossible et du désastre qui sont les affaires de la vérité, d’une vérité. Une pensée, une philosophie ne formule pas un sens, ni ne le détient – elle le déjoue plutôt et le défait – ouvrant ainsi l’espace d’une nomination de vérité. Est-ce que c’est cela, tu tiens à « sens » comme tu tiens à « communauté »… ?
J.-L. N. : Il y a deux aspects forcément dans la réponse que je peux te faire. Le premier aspect c’est que je n’y tiens pas non plus tant que ça. Ou plutôt j’ai été forcé de ne plus y tenir. J’ai été forcé sous des coups de boutoir répétés de presque tout le monde. Après c’est très frappant : quand j’avais publié La Communauté désœuvrée tout de suite après Agamben a publié La Communauté qui vient, Blanchot La Communauté inavouable ; un peu plus longtemps après Rancière parlait de communauté et puis assez vite Derrida refusait l’usage du mot communauté, je me faisais traiter de nazi par les gauchistes de Berlin de 1985 pour me faire saluer comme le nouveau communiste par les jeunes gauchistes de Berlin dix ans plus tard. Donc j’ai reconnu qu’il était nécessaire de se désapproprier ce mot de communauté, qu’il était porteur de trop de dangers. Bien. Mais encore maintenant, quand nous parlons, je trouve que, pour le prendre par là, le refus de l’abandon de ce mot ne fait d’une certaine de façon que désigner une place vide, une place manquante dans notre lexique.
Parce quand tu dis « partage », bien. Mais partage désigne une opération et ne désigne pas un statut. Si je dis « statut », j’emploie un mot qui désigne la famille de l’Etat, etc. Un statut ou une qualité (communautécomme qualité de ce qui est commun). Si on fait – ce que tu n’as pas fait ou plutôt tu l’as frôlé – si on parle d’avec, d’être-avec, d’être-en-commun, il me semble qu’à chaque fois, simplement par le fait qu’on a recourt à des termes qui échappent à l’usage le plus spontané, le plus obvie de la langue, on désigne un problème : là où il manque un mot il y a un problème.
G.B. : Est-ce qu’il y a vraiment manque du mot communauté? Est-ce qu’il n’y a pas au contraire quelque chose de proliférant, d’envahissant, de surabondant dans le mot même de communauté qui fait que si on le désapproprie il y a quelque chose comme ce que tu désignais comme « une place manquante » ? La place manquante au bout de l’opération de désappropriation. Mais on peut dire aussi que c’est là où se tient une place manquante, là où manque toute communauté qu’une communauté advient.
J.-L. N. : Tu viens de dire « qu’une communauté advient ». Mais pourquoi emploies-tu encore ce mot ?
G.B. : J’y suis sans doute encore contraint, bien sûr. Et puis je reprends tes questions. Il y a usage et usage du mot communauté. Nous sommes dans notre problème, dans les questions que je t’adressais…
J.-L. N. : Mais, si tu veux, je dirai ça précisément. L’opération a commencé par une mise en question du mot de communauté. J’avais travaillé dans l’ombre portée de Bataille, « la communauté de ceux qui n’ont pas de communauté », comme tu l’as rappelé. Le mot de communauté porte au moins, au minimum, la question justement de ce cum qui le fait. Qu’est communauté en effet sinon la qualité de ce qui est selon le cum ?
Le cum c’est l’avec. Et qu’est-ce que l’avec ? Il y a dans Sein und Zeit, au §25 je crois, une phrase de Heidegger qui est un programme immense, qui est peut-être le programme de tout ce dont on parle, quand ayant introduit le Mitsein et le Mitdasein il dit « il ne faut pas comprendre le mit dans un sens catégorial mais existential. » Le mit catégorial ça veut dire le avec de « tu es avec moi ici ce soir » mais cela veut dire également que tu n’es pas plus avec moi que la bouteille, le verre, etc. Et depuis longtemps ce qui m’a frappé c’est que cette catégorie du avec est une catégorie absente de l’horizon philosophique en général, sauf quand elle est relevée dans le syn- de la synthèse et de toutes les formes de synergie. Et pour cette raison, le avec retombe toujours dans ce que Heidegger appelle le catégorial. Que veut dire avec comme existential ? C’est là la question dont pour moi le mot communauté reste porteur.
G.B. : Cet avec existential serait quelque chose qui appartiendrait originairement au Dasein mais la détermination existentiale de l’avec par différence avec la détermination catégoriale, comme tu viens de le rappeler, n’empêche pas que pour le Dasein il y va encore et toujours du Dasein, c’est-à-dire que je suis aussi frappé de voir que la question politique ne s’ouvre pas à partir du § 26 ou 25 mais une cinquantaine de paragraphes plus loin.
Au fond, il y a quelque chose qui, chez Heidegger, est avancé comme co-originarité, Mitsein, Mitdaseinavec le Dasein et cette co-originarité n’a pas d’implication politique, même pas ontologique finalement. Ce qui m’intéresse – et c’est peut-être la seule question que je t’adressais – c’est : qu’est-ce qui sort de l’ontologie de la communauté si j’appelle ça comme ça. Il faudrait d’ailleurs plutôt dire ontologie de la comparution et du désœuvrement qui serait plus rigoureux. Qu’est-ce qui politiquement en sort ? C’est ce que j’appelais événement.

« Politiques de l’amitié », Jacques Derrida (Galilée, 1994)
J.-L. N. : Alors justement je voulais y venir aussi, non sans te faire remarquer au passage que le mot de comparution que je vois bien que tu préfères – moi aussi j’étais très content de le trouver comme ça sur mon chemin – contient cum aussi. Je voulais en venir à la question politique parce que de plus en plus je me reproche à moi-même d’avoir pu dire et écrire que la communauté engageait la politique et que peut-être l’affaire de la communauté était politique. Parce qu’enfin que veut dire politique ? Politique veut dire constitution et existence de la polis en tant que la polis est définie par le retrait, la disparition d’un cumdonné, préalable. Si la polis c’est la nécessité d’inventer, d’autodéterminer, d’autogérer, d’autolégitimer l’être-ensemble alors la seule histoire rigoureuse de la politique est celle que tu as rappelée à un moment, c’est-à-dire celle de la suppression de la politique comme séparée. Au fond, la question que je me pose de plus en plus au sujet du politique c’est celle-ci : est-ce que par politique on désigne ce qui ne peut se réaliser que par la suppression de sa propre séparation ? Cela c’est vraiment la communauté. C’est là que politique veut entièrement dire au fond communauté. Et c’est pour cela que nous avons depuis si longtemps cette série de représentations à la fois rétrospectives et prospectives de la démocratie athénienne puis de la république romaine qui sont finalement toutes des représentations à l’avance d’une disparition de la politique comme sphère séparée venant imprégner toutes les sphères de l’existence sociale. C’est une citation de Marx de la Critique de la philosophie du droit. Si politique veut dire ça, si politique est équivalent à communauté, je crains toujours que parler de politique plutôt que de communauté ne change pas le fond du problème. Si au contraire politique désigne – ce qu’aujourd’hui on tendra à appeler la politique plutôt que le politique – désigne une sphère séparée et en même temps l’impossibilité de résorber cette séparation et le danger de la résorber alors qu’en est-il de cela dont la politique est séparée ? C’est quoi le reste ? Je constate que nous sommes maintenant bien éloignés de projeter le dépérissement de l’Etat, que même des gens de provenance et de constitution très communistes – je pense à Badiou – se sont mis à réaffirmer la nécessité de l’Etat. Quand on affirme la nécessité de l’Etat, est-ce qu’on affirme simplement une sorte de pis-aller, de résignation ? Est-on toujours sur l’horizon de la disparition de toute séparation ? Ou est-ce qu’au contraire politique ne devrait pas désigner au moins une des modalités – pas n’importe laquelle – de la nécessaire séparation c’est-à-dire du nécessaire écartement à l’intérieur de la communauté ? Un écartement de la communauté par rapport à elle-même dont d’ailleurs les autres sphères devraient être considérées pour elles-mêmes.
G.B. : Il y a la figure de la suppression de la séparation comme réalisation de la politique qui correspond à ce que tu appelles l’immanentisation. Cela veut dire dépérissement de l’Etat et réappropriation d’une communauté perdue en quelque sorte, perdue et à réinventer. Il y a peut-être dans le même champ quelque chose qui est le produit du capitalisme lui-même. Je pense à une formule extraordinaire qui désigne peut-être une figure inédite et inavouable du désœuvrement. Une formule qu’on trouve dans le Manifeste du parti communiste de Marx et Engels où il est dit du mode de production capitaliste que ce qu’il réalise quotidiennement c’est une Verdampfung, une volatilisation de tout ce qui est établi et substantiel, alles Ständische und Stehende – les classes, toute consistance sociale, historique, les rapports, les conditions, les situations établies. Il y a d’un côté l’horizon immanentiste du communisme comme réalisation de l’unité à rebours de la séparation et il y a aussi ce qui s’ouvre à l’horizon du révolutionnement, de la volatilisation désœuvrante du capitalisme qui réalise aussi quelque chose d’une immanentisation.
Il n’y a pas simplement la politique comme suppression de la séparation et la politique comme lieu ou institution de quelque chose qui doit demeurer séparé. Il y a aussi dans la logique même du désœuvrement quelque chose que le capitalisme, dans son fonctionnement historique mais en même temps le plus quotidien, réalise à chaque phase, à chaque instant et chaque jour.
J.-L. N. : Est-ce que c’est la logique du désœuvrement ça ? J’espère penser que non parce que la logique…
G.B. : Une logique du désœuvrement capitaliste en quelque sorte, une pure circulation sous la loi de l’équivalence universelle et de l’interchangeabilité.
J.-L. N. : Oui, mais le désœuvrement capitaliste c’est le désœuvrement qui procède par la multiplication indéfinie des œuvres c’est-à-dire en fait des produits, des productions. Dans cette Verdampfung – qui n’est pas autre chose que la volatilisation des différences ou même des différentiels qui permettent qu’il y ait de la communication et non pas de l’équivalence générale – c’est la grande affaire de Marx. Et celle que rien ne peut lui enlever et qu’aucun effondrement d’aucun marxisme ne peut enlever à Marx c’est l’équivalence générale, d’avoir mis le doigt sur l’équivalence générale qui n’est pas une propriété économique ou de l’économie monétaire mais l’index, le premier index d’une…
G.B. : … circulation de tout dans tout.
J.-L. N. : Oui, mais derrière ça c’est un choix, une option métaphysique de civilisation entière qui fait qu’il n’y a pas eu jusqu’ici d’autre économie que capitaliste, d’Etat, ou tout ce qu’on voudra. Alors ça n’est pas du désœuvrement, pas au sens de Blanchot.
G.B. : Je te taquine un peu en parlant de désœuvrement capitaliste parce que ce sur quoi je voudrais t’entendre, c’est ce rapport entre structure quasi- transcendantale de la comparution et politique de l’événement du désœuvrement.
J.-L. N. : Qu’est-ce que tu voudrais entendre ? Je ne sais pas si tu voudrais entendre quelque chose. J’ai l’impression que je ne peux rien te faire entendre d’autre que ceci…
G.B. : C’est le rapport entre communauté et politique dont tu avais à l’instant commencé de parler.
J.-L. N. : Oui, seulement je dirais que si la comparution, si tu veux, désigne autre chose que la politique comme appropriation de la vérité de la communauté ou de la comparution elle-même, si la communauté désigne autre chose, elle désigne alors aussi l’écart de la politique à la comparution en général et le fait que ce que tu viens d’appeler « un transcendantal de la comparution » c’est la situation générale de la non équivalence. Et c’est par conséquent à l’intérieur même du capitalisme qu’il y a ce qui de toute façon lui résiste et ne peut que lui résister. Reste à savoir jusqu’où… Peut-être que cette résistance peut ne pas arriver à autre chose qu’à rester latente. Si le capitalisme se réalise intégralement, il n’y aura plus de résistance ; il n’y aura plus non plus de comparution.
G.B. : C’est pour cela que je distinguais deux figures possibles – communisme et capitalisme – de l’immanentisation.

« Être singulier pluriel », Jean-Luc Nancy (Galilée, 1996, réédition 2013)
J.-L. N. : Là, tout à fait d’accord. Mais à ce moment là, que veut dire politique ? C’est la question que je me pose et à laquelle je n’ai pas de réponse. Mais je me dis du moins politique ne veut pas dire refondation de la communauté comme telle, ne veut pas dire refondation, pour reprendre plus près des termes que tu choisis, de la comparution. Plus près, plus fidèle de quelque chose qui serait une essence communautaire qu’on pourrait présenter. Donc politique doit vouloir désigner ce que peut-être cela n’a jamais désigné jusqu’ici, à savoir comment maintenir la résistance de la comparution comme telle à toute forme d’immanentisation. Comment est-ce possible sans faire appel à un autre, à un énième modèle communautaire ? Je ne sais pas mais je suis persuadé que c’est dans ces termes là que la question se pose, c’est-à-dire politique comme invention, création d’une différenciation rendant possible la comparution mais ne l’assumant pas.
A un moment donné, tu as employé le mot de sécularisation, « immanentisation ou sécularisation » tu as dit. Et alors, à chaque fois que j’entends ce mot de sécularisation mes oreilles se dressent.
G.B. : Je me souviens qu’on en a déjà parlé, oui.
J.-L. N. : Je me demande si la question de la politique et celle de la communauté n’est pas celle de la sécularisation.
G.B. : Es-ce que l’immanentisation c’est la sécularisation ?
J.-L. N. : Peut-être, oui. Mais qu’est-ce que c’est que la sécularisation ? C’est le débat entre Schmidt et Blumemberg. Si la sécularisation veut dire, comme Schmidt le dit, que c’est le transfert de tous les grands concepts théologiques à la politique, ce que cette description ne résout absolument pas c’est la question que Blumemberg pose à Schmidt : qu’est-ce qu’il advient du théologique là-dedans ? Ce théologique sécularisé n’est plus du théologique. Mais c’est quoi ? C’est peut-être justement la politique dans sa représentation tendanciellement disparaissante et revenant à l’imprégnation de la totalité des sphères sociales qui est précisément à la place théologique.
Mais si on pouvait du moins poser la question de la sécularisation comme un processus qui ne serait véritablement sécularisant que dans la mesure où dans la sécularisation il emporterait avec lui non pas le principe de subsomption théologique – du moins ce qu’on se représente comme devant avoir été autrefois avant l’occident, la subsomption qu’on se représente avoir eu lieu dans les empires égyptiens, babyloniens, etc. – si le théologique au contraire pouvait être compris comme principe de différenciation à la fois de lui-même, de lui-même, du théologique et du politique et à l’intérieur des sphères de l’existence sociale, alors la tâche de la sécularisation (si c’est une tâche) ne serait pas de rendre à nouveau possible la différenciation. Que s’est-il passé avec la Grèce et la démocrate athénienne ? Il s’est passé la perte de la possibilité d’être dans la différence entre – justement ce qu’on ne peut pas appeler les cités – les modes communs collectifs qui pouvaient être ceux de la Syrie, ceux de L’Egypte, ceux des Hittites, etc. Et le politique à partir de ce moment là veut toujours dire aussi un seul régime de vie commune. Mais si justement les dieux (dieux locaux, dieux des peuples, etc.) avaient avant tout servi à faire la différence ? Et maintenant, comment faire la différence ?
Le capitalisme est justement ce qui empêche de faire la différence. Alors je voulais dire aussi qu’en parlant de communauté négative et de partage d’un vide, tu introduisais une problématique d’impasse : avec ça on peut aller vers une sorte de suressencialisation. Tu disais « est-ce que ce n’est pas une essence encore toujours plus vraie, etc. » En même temps, est-ce qu’on n’est pas obligés de reconnaître que la question de la sécularisation c’est bien la question d’avoir à se donner le partage d’un vide ou d’un rien – comme tu voudras – si ça n’est pas le partage d’un dieu ? Et alors que veut dire le partage d’un vide ou d’un rien. Ce n’est pas nécessairement exposé à la réappropriation d’une suressence, etc.
G.B. : Je me demande… Pour qu’il y ait communauté il faut que quelque chose se dispose à partir d’une absence de communauté – je parle de communauté, là où il y a communauté, bien sûr. J’ai précisément en tête une remarque que fait Rosenzweig dans L’Etoile de la Rédemption quand il compare la liturgie du judaïsme et celle du christianisme. Et en particulier (il y a de longs développements sur les arts sacrés, la musique d’église, etc.), il explique que dans le christianisme, il faut à chaque fois que la communauté puisse se reconstituer à partir d’un ordonnancement liturgique, de la considération de la lumière traversant les vitraux, de la musique. Il y aurait là une constitution communautaire en train de se faire et qui serait à chaque fois à recommencer parce que là manquerait tout rapport à la communauté. Il ajoute alors, dans ses mots à lui, qu’en revanche, pour le judaïsme, pas d’architecture sacrée, pas de synagogues comparables à des cathédrales, ou à des mosquées faudrait-il ajouter, parce que quelque chose d’une communauté – il appelle ça aussi comme ça – serait toujours déjà par avance pré-donné. Il y aurait donc une institution de la communauté là où manque toute communauté (le christianisme) et en revanche quelque chose d’une défection préalable de toute communauté là où – paradoxe suprême – une communauté préexisterait ou pré-articulerait en quelque sorte le lien social lui-même.
J.-L. N. : Ce que tu dis là est étrange parce que cela rejoint exactement ce que j’allais te dire, pas du tout dans les termes du judaïsme et christianisme.
G.B. : L’une des occurrences de communauté c’est aussi, dans le panorama des communautarismes à la française, ce qui s’expose dans les questions de la communauté musulmane, des communautés juives, etc. Il y a là aussi une question politique.
J.-L. N. : Ce que j’allais te dire c’est que le plus grand paradoxe de la question de la communauté est peut-être par excellence la question qu’on se pose alors qu’elle est toujours déjà par avance répondue ou résolue. On ne poserait même pas la question de la communauté si on n’était pas en communauté.
La communauté – c’est ce que je voulais dire tout à l’heure en parlant de résistance – c’est ce qui au moins me semble toujours aujourd’hui constituer – dans l’état du capitalisme et du monde en général dans lequel on est –au moins un minimum, mais un minimum en même temps toujours énorme si on y pense, de résistance qui fait que nous sommes toujours les uns avec les autres et c’est là un insuppressible dans sa proximité et dans sa distance. Et la différence c’est que ce qui nous est demandé là c’est de nous réapproprier cela qui nous est de toute façon donné et je dirais même cela par quoi nous sommes donnés sans que ce soit une entité ou une naissance préalable à la Tönnies comme tu l’as rappelé à un moment. Mais nous y sommes. Nous ne pouvons ni y entrer ni en sortir. Et ce que tu rappelais tout à l’heure du sein et de l’enfant au sein c’est aussi cela dans quoi nous sommes. Nous ne pouvons ni entrer no sortir mais c’est exactement aussi par là qu’on sort et qu’on entre. Ce qui, en effet, sous le nom de communauté – pour revenir à l’axe majeur de ton interrogation – ne cesse pas de nous menacer c’est la tentation de nier que cela nous serait déjà donné et que nous sommes dedans. Mais au contraire d’en faire quelque chose que nous aurions à créer, à inventer, à produire, etc.
G.B. : Mais est-ce qu’il n’y a pas quelque chose d’indéfinissable dans cette réinvention de ce dans quoi nous sommes toujours déjà ? Réinvention qui est de l’ordre d’une politique… Une communauté perdue à retrouver, une communauté primitive, originaire, et une communauté à venir. C’est là où mon interrogation, ma perplexité se tient. C’est là qu’elle se fait lieu. Comment au fond – c’est peut-être ce que tu appelles résistance ou résistibilité – désajointer cet insuppressible dans quoi nous sommes toujours déjà, dans quoi nous nous trouvons, l’être en commun, très précisément la comparution, avec la projection de ce comparaître dans une communauté à venir ? Le sous-titre de La comparution, c’était « politique à venir »…
J.-L. N. : C’est une chose qu’il faut tout à fait critiquer. Je suis très mécontent de ce sous-titre et je vais faire une nouvelle édition exprès pour supprimer le sous-titre. Parce qu’il n’y a pas un mot de politique dans ce livre. C’est indécent de sous-titrer un livre « politique à venir » où il n’y a pas un mot de politique…
G.B. : Il y a quand même une réflexion sur le communisme… Le sous-titre je l’ai toujours compris dans cette perspective. Je ne savais pas ta réserve…
J.-L. N. : Elle m’est venue après-coup. Heureusement qu’on a des lecteurs pour ne pas partager ses autocritiques !
Mais ces réflexions sur le communisme… Justement, si le communisme a tendanciellement été l’autosuppression de la politique alors que veut dire « politique à venir » ? Cela veut dire plus de politique ?

« Totalité et infini », Emmanuel Levinas (Kluwer Academic Publishers, 1981 – 4e éd.)
La question de la politique aujourd’hui me semble être la question de comment dégager et situer un ordre de pensées et d’actions spécifique, distinct, séparé et qui ait pour tâche le maintien et la promotion du principe de la séparation de la communauté avec elle-même pour faire communauté. Donc à ce moment, politique ne peut ni être l’instance complètement séparée (et finalement subordonnée) d’une gestion, ni être l’instance tendanciellement disparaissante de la vérité commune elle-même ; Mais entre les deux, le lieu d’activation de l’entre comme tel. Le paradoxe c’est qu’il faut qu’il y ait lieu – tu viens de dire d’activation – de l’entre en tant que tel. Mais ce lieu – justement parce qu’il est en charge de l’entre – ne doit pas prétendre être nous. Entre nous doit toujours aussi montrer que nous ne consistons pas, nous ne sommes pas consistants en dehors de l’entre. Il n’y a pas nous puis après entre nous. Il y a entre. Ce n’est peut-être pas très éloigné de Levinas.
Il me semble que politique ne peut avoir que ce sens là. : prendre en charge l’entre comme tel et par conséquent aussi ouvrir l’espace dans lequel peuvent se disposer les différentes modalités d’être entre nous. Par exemple la modalité artistique aussi bien que la modalité sportive que la modalité des rencontres de savants ou toutes les formes de petites « communautés » de partage. Comment appeler cela ? C’est exactement l’endroit où nous n’avons ni communisme, ni simplement Etat, pour autant que nous sachions encore ce que Etat veut dire autrement qu’organisme de gestion. Et ni non plus – et c’est peut-être là notre vrai problème – ni en république.
Tout à l’heure tu as employé le mot de république et tu as immédiatement dit « pour autant que ce mot ait jamais voulu dire quelque chose. »
G.B. : Ma réticence est la même que celle que j’ai devant communauté.
J.-L. N. : Devant république ? Bien sûr, je partage entièrement. Mais je crois que ce qui est très intéressant, très remarquable et que pour quoi il faut encore tirer son chapeau à la république et en particulier à la république française – si j’ai le droit de me montrer un instant cocardier – c’est que dans la république il me semble qu’elle a été la pensée de la politique sans assomption essentielle. Au bord mais restant au bord justement parce que la république n’a jamais vraiment défini sa propre substantialité.
G.B. : Eperdument surdéterminée comme française, populaire, démocratique…
J.-L. N. : C’est vrai. Bien sûr. Mais quelle est la question de la république ? La république est très bien nommée. C’est la chose publique. Quelle est la chose publique. De quelle nature est cette chose ? Autrement dit laissons la république ; je ne fais pas de profession de foi républicaine ici mais…
G.B. : Mais tu pourrais. Il n’y aurait là rien de déshonorant…
J.-L. N. : Est-ce que la chose publique est quelque chose ou rien ? Et si elle n’est pas rien – au sens du nihil negativum – si elle est rien au sens où rien « est le res lui-même », etc. comment saisir la nature de cette chose qui n’est pas une chose mais qui est un peu quelque chose ?
Je dirai que c’est quelque chose qui n’est pas vraiment une chose mais qui n’est pas tout à faite et qui est exactement ce que notre langue appelle aussi un rien, comme les « petits riens » de Mozart ou quand on dit « il s’en faut de rien ». Cela veut dire la même chose que ce qu’on veut dire en disant « presque rien ». Ce mot s’est gauchi jusqu’à ne plus du tout dire quelque chose alors que nous comprenons tous ce que je veux dire quand je dis « il s’en faut de rien » c’est-à-dire qu’il s’en faut d’un petit écart. Mais l’écart est là et c’est donc quelque chose.
Si tu veux, cette chose, est le cum justement. C’est l’avec, la proximité, mais qui garde l’écart et l’écart grâce auquel il peut y avoir ce qu’il y a – comme je disais tout à l’heure « nous y sommes déjà ». Si nous n’y étions pas nous ne serions pas nés, nous ne serions pas sortis du ventre donc nous n’y serions pas non plus rentrés, nous n’aurions pas non plus tété le sein… pour autant que nous l’aurions tété.
***
J.-L. N. : Il est bien évident que nous n’avons pas cessé de parler de l’altérité parce que de quoi est-il question dans un partage, dans une comparution, donc dans le cum du commun ? Il est question d’altérité. Si nous n’étions pas des autres il n’y aurait pas de problème.
G.B. : Je n’ai pas l’impression que nous ayons à aucun moment parlé de l’altérité. Ce dont nous avons parlé, c’est ce dans quoi nous sommes toujours déjà les uns avec les autres, les uns comme les autres. Donc là, ce qui d’emblée s’est évidé, c’est la question de l’altérité de l’autre. Tu viens de dire : nous sommes toujours des autres. La question de l’altérité, prise radicalement, est celle de l’altérité de l’autre et pas celle de l’autre que je peux être moi, à mon tour. Ça c’est la question de la communauté, laquelle vient après la question de l’altérité.
J.-L. N. : Nous ne nous entendons pas de la même manière. Parce que lorsque tu dis que je viens de dire « nous sommes toujours des autres », je dirais « nous » est par lui-même porteur de l’altérité. Nousdésigne d’un seul coup l’impossibilité d’assigner son locuteur. Evidemment c’est moi qui dit nous et je n’ai jamais le droit de dire nous, bien entendu. Donc si je dis nous je dis toujours entre nous. Et en disant entre je dis entre nous autres. Nous autres, la seule chose que je connaisse de la langue espagnole, c’est le nos ostros. L’espagnol dit nous autres à tout bout de champ. Et du coup c’est aussi l’altérité de l’autre parce que c’est seulement dans un rapport d’appel et de distance de l’autre que nous peut se dire.
G.B. : Nous autres c’est surtout nous-mêmes. Nous avons également parlé de l’altérité en parlant de la communauté, disait à l’instant Jean-Luc. Et je disais « nous n’avons pas parlé de l’altérité ». il y a donc là quelque chose comme un « entre » deux qui est une façon de répondre sur l’altérité, c’est-à-dire peut-être sur son impossible circonscription.
J.-L. N. : En même temps, il est vrai que l’ensemble des questions posées autour de la communauté et à l’aide du mot communauté ont toujours été la question de la fondation — dans l’Occident, dans la philosophie – sous le signe du régime du même, l’archiprimordial qui gouverne tout. En ce sens là, l’introduction de l’autre par Levinas, ce que Derrida en a repris et redéployé, c’est d’une très grande signification. Mais la question de la communauté est par elle-même constitutivement la question de ce qui ne permet pas de faire l’économie de l’autre. Ce qui permet de faire l’économie de l’autre c’est le capitalisme, ce qui est dans l’équivalence.
G.B. : L’altérité, quant à elle – je ne voudrais pas faire de fausses symétries – porte en raison de ce qu’elle est, de son altérité, la question de la communauté. On peut se demander aussi si tout ce que Levinas a essayé d’ouvrir à partir de ses questions sur la justice, sur le tiers, viendrait résonner ou ne pas consonner avec ce que Jean-Luc Nancy nous propose d’une pensée de la communauté. Il y a effectivement sous ce double titre, cette double requête, quelque chose entre communauté et altérité, quelque chose qui se joue de manière extraordinairement nouée et, je crois, compliquée.
***

Les Cahiers philosophiques de Strasbourg n°24 : « Que faire de la communauté ? » (Édité par Andrea Potestà, Presses universitaires de Strasbourg, déc. 2008)
J.-L. N. : Il n’y a aucune nécessité de maintenir le mot « communauté » comme index d’un non connu, d’un non connaissable : ce n’est pas le but. Il n’y a pas de but ni dans le rejet ni dans le maintien de l’usage du mot. Pas de but mais une poussée. Peut-être y a-t-il un conatus du cum. Il y a quelque chose qui pousse même quelqu’un qui veut mettre en question ou suspendre le mot de communauté – comme Gérard maintenant – à poser ses questions, faire ses mises en garde au nom quand même de la communauté. Je ne veux pas ramasser toutes les dépouilles à mon profit mais, Gérard, tu as quand même utilisé des formules dialectisantes comme « communauté sans communauté », « comment faire de l’avec avec du sans », des choses comme ça…
G.B. : Je veux bien les tenir à distance mais je ne peux pas parler de la communauté sans dire cum, le cum de la communauté elle-même, celui de la comparution –mais il y en aurait d’autres. Quelque chose comme une amphibologie de la communauté m’apparaît ici, où on pourrait au prix de multiples ambiguïtés se retrouver, entre-nous-deux. Mais peut-être pas autour de ce que tu appelles dialectisation, formules dialectisantes. C’est très exactement la question du sens qu’on recroiserait. Et de son dédire. Je dis communauté, je dis l’avec et le sans, leur rapport, mais c’est pour tenter de les dé-dire. Je le dis et je ne le dis pas. La communauté est peut-être au fond l’index de soi-même et de tous ses autres.
J.-L. N. : En même temps, puisqu’on parle de Spinoza, il y a quelque chose qui me frappe. Spinoza est peut-être l’exemple le plus frappant d’une pensée qui est de part en part gouvernée par le présupposé absolu qu’il y a une communauté qui est la communauté des modes de la substance. La substance spinozienne c’est la communauté. Il est d’ailleurs très remarquable qu’elle ne consiste pas ou guère par elle-même.
De ce lexique difficile à maintenir il s’agit simplement de ceci : notre être avec l’ensemble ne consiste pas mais c’est en lui que nous sommes. Au sens très fort. C’est bien ce que Heidegger a touché du doigt avec le mitsein et je me permettrai de dire que ce n’est pas un hasard si précisément dans le passage d’une insuffisance insuffisante analytique du Mitsein au § 25 dont on parlait tout à l’heure dans le passage – moment où on parvient à la communauté du peuple (§ 70) – on a véritablement perdu quelque chose de l’avec.
Et ce n’est pas par hasard si c’est exactement ça dont on pourrait dire tranquillement que ça a donné lieu au plus énorme accident ou à la plus énorme faute philosophique de tous les temps. Pourquoi est-ce qu’un philosophe a trempé dans ce qui est pour nous l’abomination du XXe siècle ? Il faudrait avoir le courage de dire que ce n’est pas parce que Martin Heidegger était ceci ou cela, révolutionnaire ou conservateur. Ce n’est pas pour toutes ces raisons mais parce que la philosophie était dans l’état de pouvoir faire ce pas là. Et c’est ça que nous a légué la question du mit, de l’avec. Est-ce qu’il y a une visée de maintenir malgré tout la communauté en même temps comme le non d’un inconnaissable ? Peut-être aimerais-je dire que ce n’est pas d’un inconnaissable dont il s’agit. C’est que ce qui est en jeu là n’est ni de l’ordre du connaissable, ni de l’ordre de l’inconnaissable. C’est – et peut-être que la première chose à faire est de se débarrasser de la tentation du connaître et peut-être que le mot de communauté prête pour cela trop à la tentation – de l’ordre de l’être.
[….]Que se passe-t-il quand l’avec entame l’unité souveraine du politique ? C’est ce qui est en train de se passer, mais de manière très ambiguë. Peut-être que le fantasme de l’unité de la souveraineté est entamé au nom de la contestation de son unité. Ce qui est mis en question à ce moment là c’est ce dont je parlais tout à l’heure à propos de la sécularisation. La sécularisation est un transfert du théologique comme principe d’unité, de complétude et de domination. La démocratie est le surgissement de l’avec comme entame irrépressible et irrévocable de l’unité. Mais en même temps, il faut être conscient que cela pose immédiatement la question de savoir comment l’unité entamée, défaite, comment la souveraineté peut-elle être souveraineté selon l’avec. Qu’est-ce que la souveraineté populaire ? De ce côté-là nous avons cette question. Mais de l’autre côté, l’unité de la souveraineté peut être aussi entamée par l’avec mais par la figure non de la comparution mais de la « co-existence », comme la pure et simple coexistence de toutes les parcelles de toutes les particules répandues dans un espace indifférencié. Et c’est aussi ce qu’il se passe en ce moment. Et en effet entre les deux se pose bel et bien la question du pouvoir.
*Nous remercions chaleureusement Gérard Bensussan qui nous a fait l’amitié de nous permettre de publier cet entretien pour l’édition de cet hommage à Jean-Luc Nancy.
[1] Ce texte est une version non révisée par les auteurs du dialogue qui a eu lieu le 4 mai 2006 à Strasbourg pendant la journée « Communauté », organisée par l’Equipe d’Accueil de l’Université Marc Bloch – Strasbourg II et le [Parlement des philosophes]. Il a été transcrit par Géraldine Roux.
[2] J.L. Nancy, La communauté désoeuvrée et La comparution, Christian Bourgois, 1990 et 1991
[3] Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Livre de poche, p. 241
[4] Ibid., p. 250
[5] Politiques de l’amitié, Paris, Galilée, 1994, p. 330
[6] Nous venons ensemble au monde (La comparution, éd. cit., p. 53) – mais pas au sens d’une juxtaposition, pas au sens où ‘ensemble’ serait un simple prédicat de ‘nous’.
[7] Être singulier pluriel, Galilée, 1996, p. 23sq., p. 40sq.
[8] Totalité et Infini, Livre de poche, p. 70
Pingback: Homenaje a Jean-Luc Nancy ¿Qué hemos hecho con la comunidad? ¿Qué tenemos que ver con la comunidad? - Reflexiones Marginales
Pingback: Dos orígenes del pensamiento de Jean-Luc Nancy: Marx y Hegel - Reflexiones Marginales