
« Le contrat de vente », Quentin Metsys (huile sur toile, © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais/Jörg P. Anders)
L’Étourdi de Molière : la science cartésienne contre l’incon-science moliéresque
Si le rire donne au sujet la chance, par ses traits d’esprit, de retrouver son latin, soit sa vérité (en tant que dévoilement de soi), c’est précisément parce que le rire est toujours déjà double. Une « convulsion », comme dit Baudelaire. En sorte que ce dernier écrit dans L’essence du rire : « Le rire est l’expression d’un sentiment double, ou contradictoire ; et c’est pour cela qu’il y a convulsion. » Cette convulsion nerveuse, c’est précisément la division, le split, la Spaltung du sujet. Dédoublé par son rire, le sujet qui éclate de rire se tient aussi dans la chance de se voir avec éclat. L’éclat de rire peut être ainsi éclairant. En quoi, je ne sais s’il est « satanique », comme le suggère Baudelaire, mais il est à tout le moins – et Baudelaire l’écrit aussi – « diabolique » (de diabollos : « ce qui désunit », « ce qui divise »). Diabolique, le rire l’est en ce qu’il cisaille l’humain par des humeurs qui l’excave, et l’exalte comme son propre feu-follet. La vérité du sujet affleure donc dans ce qui est ‘‘parlant’’ dans son rire. Car même s’il défait le langage – le rire est hors-langue –, il ne cesse pas pour autant de parler. Du reste, on sait tous que l’on dit beaucoup de soi en riant : d’où le champ lexical du rire qui trahit toujours une vérité subjective : rire d’effroi, rire jaune, rire sous cape, rire sardonique, rire de bon coeur, rire gêné, rire étouffé, rire retenu, etc., etc. Le rire est un mode de notre substance. Il est, en son fond, body language.
En cela, si le psychanalyste use des traits d’esprit (lesquels ne sont pas de simples jeux de mots), c’est afin de pointer que le sujet se trouve en retrait de lui-même. Sa vérité s’est retirée dans son inconscient. Ainsi, les traits véritables de sa personnalité peuvent être exhibés et dévoilés dans ses traits d’esprit. Retirée en lui, sa vérité doit être tirée et extirpée de lui. Si l’analysant ne comprend pas un traître mot de lui-même, le trait d’esprit est le mot traître trahissant sa vérité. Ses « humeurs peccantes » qui le rendent aphasique – pour parler comme Sganarelle dans Le médecin malgré lui – sont en fait liées au réel informalisable. Ce réel qui ne bouge pas, en nous, et qui fait qu’on se cogne toujours au même mur, jusqu’à en perdre son latin. Ce réel, donc, qui fait que les « humeurs peccantes » sont – tautologiquement – « des humeurs peccantes » qui ne cessent pas de ne pas s’expliquer, quand bien même elles conditionnent le fait que la langue – soit la vie de tous les jours ! – m’est inhabitable et insupportable. Ma vie se répète comme une succession d’échecs, pour autant que je ne sache pas formaliser ce qu’il en est réellement de mon symptôme. C’est ce désarroi, faisant l’envers même du discours psychanalyste, que Molière dépeint dans Le médecin malgré lui avec humour :
« GÉRONTE s’entête. – Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l’action de la langue ?
SGANARELLE. – Aristote là-dessus, dit… de fort belles choses.
GÉRONTE. – Je le crois.
SGANARELLE. – Ah ! C’était un grand homme !
GÉRONTE. – Sans doute !
SGANARELLE. – Grand homme tout à fait : un homme qui était plus grand que moi de tout cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l’action de sa langue est causé par certaines humeurs, qu’entre nous autres savants nous appelons humeurs peccantes ; peccantes, c’est-à-dire… humeurs peccantes ; d’autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s’élèvent dans la région des maladies, venant… pour ainsi dire… avec entendez-vous le latin ?
GÉRONTE. – En aucune façon.
SGANARELLE. – Vous n’entendez point le latin !
GÉRONTE. – Non.
SGANARELLE. – Cabricias arci thuram, catalamus, singulariter, nominativo haec Musa, « la Muse », bonus, bona, bonum, Deus sanctus, estne oratio latinas ? Etiam, « oui ». Quare, « pourquoi » ? Quia substantivo et adjectivum concordat in generi, numerum, et casus. »
Les humeurs peccantes qui font que la fille de Géronte ne parle plus, ce n’est rien de plus que ce que Lacan appelle : le symptôme qu’il s’agit de cerner afin de rendre compte de la vérité de l’analysant. Ainsi, Lacan (et personne ne l’a jamais souligné, curieusement) fait de la psychanalyse l’envers de ce discours médical de Sganarelle : puisque celle-ci doit apprendre à nommer l’humeur peccante pour la purger. En cela, dit-il, la psychanalyse est liée à « la catharsis ». Or,
« pour nous, poursuit Lacan, surtout pour nous médecins, ce terme prend, depuis les bancs de l’école dite secondaire par lesquels tous ici nous sommes plus ou moins passés, une résonance sémantique moliéresque, pour autant que le moliéresque ne fait ici que traduire l’écho d’un concept médical très ancien, celui qui, pour employer les termes de Molière même, comporte l’élimination des humeurs peccantes. »[1]
La purgation, de ces humeurs peccantes, ne se peut qu’à la condition de savoir, ce qui vient en lieu et place des points de suspension suspendant le « c’est-à-dire » du symptôme. Autrement dit : la catharsis n’advient qu’à ponctuer autrement la période de cette phrase. Tant et si bien que, la psychanalyse apprend au parlêtre à supplanter le « c’est-à-dire » par un « sait à dire ». Car c’est quand le sujet « sait à dire » pourquoi il pâtit de ses humeurs peccantes, qu’il trouve sa vérité depuis ce « gai sçavoir » du ça. (« Sçavoir » est l’ancienne orthographe de « savoir » qui était usité jusqu’au XVIII° siècle ; Lacan la reprend à son compte afin de souligner que le savoir vise le « ça », soit l’inconscient). En dépit de quoi, il aura beau tendre l’oreille à tout discours médical, ce ne sera pour lui qu’un latin tombé dans l’oreille d’un sourd. La psychanalyse est née pour que le sujet, souffrant de ce dialogue de sourds d’avec lui-même, puisse s’entendre à nouveau parler dans ses traits d’esprit, et en retrouve son latin et sa vérité.

Molière dans le rôle de César dans « La Mort de Pompée », Nicolas Mignard (1658), Collection Comédie-Française.
Je forme ici une hypothèse : « le retour à Descartes » – mot d’ordre de Lacan dès 1946 – est donc aussi un retour à Molière. Ce retour signifiait un retour au sujet, en tant que le sujet cartésien est un sujet divisé. Car le sujet cartésien n’est pas assuré de sa substance pensante par la seule évidence du cogito, mais en vertu des vérités éternelles créées par Dieu à chaque instant. Autrement dit : le cogito claque entre les doigts du sujet dès que Dieu – l’infini – lui vient à l’idée. Pourquoi ? Précisément parce que le sujet peut bien penser que toutes les idées qui sont en lui sont innées, il y en a une dont il ne peut être la source (en cela qu’elle est trop grande pour qu’il en soit le concepteur), c’est l’idée de l’infini, soit celle de Dieu. Le sujet cartésien, comme celui lacanien, est donc lui aussi divisé, et ce, par l’idée de l’infini qui rend la certitude de sa substance pensante dépendante des vérités éternelles créées par Dieu (Lettre à Mesland du 2 mai 1644).
Le sujet cartésien est par là même aussi sujet d’un in-conscient, c’est-à-dire d’une transcendance qui lui vient à l’idée, en mettant en doute son assurance et son assise subjective. Or ce sujet divisé est pour Descartes – comme pour Lacan – « sujet de la science » ! Ce sujet divisé n’a ainsi de certitude de sa vérité que dans l’Autre qui la garantit. A remplacer le Dieu cartésien par l’Autre, on comprend pourquoi Lacan se croyait cartésien à dire : « Je pense où je ne suis pas, donc je suis où je ne pense pas. » C’est sans doute en cogitant à cette idée de Dieu en moi, soit à cette idée de l’Autre en moi, que Lacan en est venu à penser un sujet en sujétion à la vérité du grand Autre – cette incon-science dans la science cartésienne.
En sorte que, si ce retour à Descartes est aussi un retour à Molière, c’est en cela que Molière est le premier qui, dans sa pièce intitulée L’Étourdi ou les contretemps, a pointé ce sujet en sujétion à ses étourderies, ses lapsus, et ses actes manqués. La première graphie de l’Étourdi, à l’époque de Molière, était d’ailleurs L’Estourdy. Ce qui, par un trait d’esprit, pourrait très bien s’écrire : l’Es-tour-dit, soit les tours que l’Es, le Ça, l’inconscient, jouent au sujet du dit. « L’Étourdit » étant, par ailleurs, le titre d’un célèbre texte de Lacan dans les Autres écrits. Le speech est simple : Lélie veut séduire celle pour qui son « cœur s’oupire », soit la belle Célie. Pour ce faire, il utilise les services de Mascarille, le « fourbum imperator », qui use de tous les stratagèmes pour que Lélie la conquiert. Mais voilà que Lélie, à chaque supercherie, à chaque fourberie pour convaincre son « cœur », commet « une bévue », un « lapsus », un « contretemps » qui fait tout rater. Ce raté, on le sait, est qu’on appelle le lapsus, ou « la bévue ». Cette dernière, comme le savait Lacan, traduit l’Unbewusstseinen tant que : l’Une-bévue-de-l’être. La portée de l’inconscient est toujours à portée de la bévue. Ainsi Mascarille s’en désespère-t-il et s’écrie :
« (…) vous serez toujours, quoi que l’on se propose,
Tout ce que vous avez été durant vos jours ;
C’est-à-dire, un esprit chaussé tout à rebours,
Une raison malade et toujours en débauche,
Un envers du bon sens,
un jugement à gauche,
Un brouillon, une bête, un brusque, un étourdi,
Que sais-je ? un… cent fois plus encor que je ne di. »
Cet « envers du bon sens », ou cet étourdissement de Lélie, qui fait de son esprit « un esprit chaussé tout à rebours », voilà la manière dont Molière dit l’inconscient. Les « écarts d’esprit » ou les « contretemps » sont ici évoqués pour signifier la flatulence des bévues, et l’épilepsie des lapsus du Ça. L’inconscient, c’est donc ce qui provoque des épilapsies à contretemps, si l’on peut dire. En quoi, Lélie est à l’image de l’inconscient. Il est celui qui dit de façon lacanienne : « je ne suis pas là où je suis le jouet de ma pensée, je pense à ce que je suis là où je ne pense pas penser. » Voilà en quoi il est l’Étourdi, tout étourdi qu’il est par les tours que lui joue ledit inconscient dont il est le jouet.
(Avant d’en venir à la scène Descartes-Molière, j’aimerais dire un mot sur le sous-titre de cette pièce : « les contretemps ». Cela a rapport naturellement aux lapsus, aux bévues, aux actes manqués de Lélie. Mais ces contretemps, précisément, ne sont tels, qu’à être tout contre le temps. Ils arrivent finalement à point nommé : car là où vient le contretemps, vient aussi le temps pour comprendre. Soit le « moment de conclure », dans la passe psychanalytique. On conclut sur un lapsus, par exemple, afin que l’analysant s’interroge sur celui-ci, et essaye d’en dégager quelque chose de déterminant pour se comprendre lui-même. Si bien que le trait d’esprit – et le rire et le comique en général – est une question de timing! Le mot d’esprit, pour être un bon mot (au sens psychanalytique ou comique), doit bien chuter dans le temps. Au sens le plus trivial, d’ailleurs, la chute d’une blague ne signifie rien de plus qu’un certain timing de l’effet escompté, du ton ou de la parole. Un mauvais timing, et la blague tombe à l’eau. Rien n’est plus dur que de bien raconter une blague ! Ainsi, tout contretemps – en psychanalyse – est en vérité cadencé par un timing caché, encrypté, inconscient. De même que toute blague répond d’un timing millimétré.)

Portrait de René Descartes, Frans Hals
Dans ce XVII° siècle français, une scène prend donc place. C’est une scène de couple, une scène de ménage, celle de deux contemporains, scène inouïe, scène que je mets en scène non sans humour ni malice, scène, donc, entre Descartes et Molière. Cette scène est celle d’une communication impossible. Molière raille Descartes, Descartes ne lira jamais Molière : et pour cause, quand celui-ci meurt, en 1650, ce dernier n’a écrit qu’une pièce, Le médecin volant, il n’est encore connu de personne, il tourne en province, jusqu’en 1658, où le Duc d’Orléans lui offre sa protection et le fait produire devant Louis XIV. Les deux, pourtant, l’un par la philosophie, l’autre par la comédie, ont pour projet d’étudier l’homme en son entier.
« La langue de Molière », celle que je parle et que j’écris, celle à qui j’espère, à chaque fois, rendre justice, cette langue, dis-je donc, fut celle du comique, mais encore celle de la critique (des mœurs). Ainsi, si pour Descartes, comme il le dit dans sa lettre « Préface » aux Principes de la philosophie, la « philosophie signifie l’étude de la sagesse, et que par la sagesse on n’entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l’homme peut savoir tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l’invention de tous les arts »(AT IX, 2)[2], c’est qu’alors la philosophie, pour lui, revient à une éthique ou à une morale. Et plus et mieux, « cette étude, ajoute-t-il, est plus nécessaire pour régler nos mœurs, et nous conduire en cette vie, que n’est l’usage de nos yeux pour guider nos pas. »[3]Dès lors, si Molière — selon Santeuil — veut « entrer comme il faut dans le ridicule des hommes », afin de les « peindre d’après nature », c’est aussi pour corriger les mœurs. La comédie « châtie les mœurs en riant ». Et ce, car comme l’écrivait encore Horace : ridendo dicere verum qui vetat – « qu’est-ce qui empêche de dire la vérité en riant ? » Autrement dit : si Descartes use de la philosophie pour « régler nos mœurs », et pour que nous puissions marcher avec assurance en cette vie ; Molière, quant à lui, use de la comédie et du ressort comique, pour « châtier nos mœurs » et les rectifier par là même. Or ce projet commun creuse paradoxalement entre eux, et malgré eux, comme le sillon d’un rire ou d’un sourire, un abîme infranchissable. Celui précisément de la comédie, ou de ce que Descartes appelle la joie dans une Lettre à Elisabeth du 6 octobre 1945. Je cite et souligne :
« Je me suis quelquefois proposé un doute : savoir, s’il est mieux d’être gai et content, en imaginant les biens qu’on possède être plus grands et plus estimables qu’ils ne sont, et ignorant ou ne s’arrêtant pas à considérer ceux qui manquent, que d’avoir plus de considération et de savoir, pour connaître la juste valeur des uns et des autres, et qu’on devienne plus triste. Si je pensais que le souverain bien fût la joie, je ne douterais point qu’on ne dût tâcher de se rendre joyeux, à quelque prix que ce pût être, et j’approuverais la brutalité de ceux qui noient leurs déplaisirs dans le vin ou les étourdissent avec du pétun. Mais (…) voyant que c’est une plus grande perfection de connaître la vérité, encore même qu’elle soit à notre désavantage, que l’ignorer, j’avoue qu’il vaut mieux être moins gai et avoir plus de connaissance. (…) Ainsi je n’approuve point qu’on tâche à se tromper, en se repaissant de fausses imaginations ; car tout le plaisir qui en revient, ne peut toucher que la superficie de l’âme, laquelle sent cependant une amertume intérieure en s’apercevant qu’ils sont faux. »
Ce qui se joue-là, c’est le théâtre ou la comédie qui sépare la science cartésienne de l’incon-science moliéresque. La première cherche à accumuler , en dépit de la gaieté, les connaissances pour marcher du bon pied en cette vie (encore que…, il y a bien cette fameuse Lettre à Chanut du 6 juin 1647, où Descartes dit que le jour où il a compris la cause de pourquoi il aimait les jeunes filles « un peu louche », il a cessé de les aimer – ce qui n’est rien de plus que le savoir du symptôme qui fait cesser la répétition) ; la seconde cherche à cerner, par un « gai sçavoir », ce qu’il en est de notre incon-science, laquelle fait que, dans notre étourdissement, on s’oublie, on se rate, et on répète toujours le même ratage.
Le comique de répétition de Molière est donc le comique même de la répétition inconsciente. Ce qui se répète, c’est ainsi toujours le même mur dans lequel on fonce, toujours le même réel dans lequel on se cogne. Ce comique de répétition, comme tout comique de répétition, dit par conséquent toujours : « je m’en cogne de sçavoir pourquoi je me cogne toujours au même mur ». Ce mur est, souvent chez Molière, le mur de l’amour, que Lacan nommait, avec espièglerie, « l’amur » ; et qui, séparant les amants, rend l’amour impossible. Or, ce à quoi hisse cet étourdissement, c’est à rien de moins qu’au sçavoir – pour l’étourdi – de ce que « ses humeurs peccantes » veulent dire. Soit le moment où ce que « nous appelons humeurs peccantes ; peccantes, c’est-à-dire… humeurs peccantes », sait ce qu’il en est inconsciemment de ces « humeurs » ; et donc « sait à dire » en quoi elles l’étourdissent et font de lui non pas un malade imaginaire mais un médecin (du) réel malgré lui. Ce « gai sçavoir » met donc fin à la répétition. Il ne s’agit donc pas d’accumuler, comme chez Descartes, des connaissances, en dépit de la gaieté, mais de se connaître gaiement. La gaieté ne s’oppose pas à la connaissance de soi ; la connaissance de soi est gaieté. Ainsi, si la science cartésienne n’est pas gaie ; l’incon-science moliéresque est bien un « gai sçavoir ».
On dira de mon hypothèse qu’elle est farfelue : à quoi je réponds que je la propose dans un texte sur le rire et l’humour, et qu’il faudrait en manquait pour me le reprocher ; ce qui n’empêche en rien, par ailleurs, son sérieux, pour peu qu’on prenne comme un symptôme les titres des pièces de Molière, lesquels multiplient les références au « malade » et au « médecin ». A ce propos, il n’y a qu’à faire une phrase avec ceux-ci pour le comprendre : L’Etourdi n’est pas un Malade imaginaire mais un Médecin malgré lui soignant sa Psyché non chez Le Tartuffe et l’Imposteur mais par L’Amour médecin qu’on appelle le transfert.
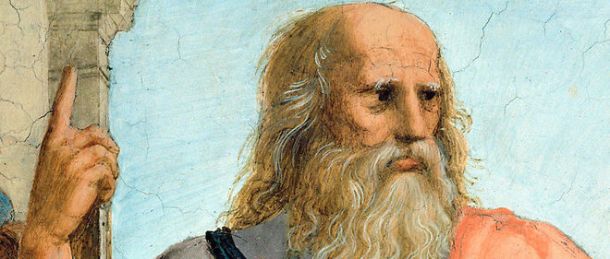
Platon (détail de L’Ecole d’Athènes, Raphaël)
En cela, on voit bien en quoi le comique, comme nous le disions plus haut de la scène entre Socrate et Platon, est toujours lié à un problème de communication. Or le XVII° siècle n’est-il pas le siècle par excellence de ce problème, et de la tentative de donner réponse à celui-ci ? Quatre réponses célèbres furent au moins proposées : 1) le dualisme cartésien (la res extensaet lares cogitanssont deux substances distinctes), 2) le monisme spinoziste (« l’esprit est idée du corps », puisque l’esprit et le corps sont deux attributs d’une même substance), 3) l’harmonie préétablie leibnizienne (la relation du corps et de l’esprit est préétablie par l’harmonie programmée par Dieu), 4) l’occasionnalisme malebranchiste (l’occasion du rapport corps/esprit est réglée par l’efficacité des lois universelles et immuables décrétées par Dieu). Celle qui va plus particulièrement nous intéresser est celle de Descartes. En effet, tout le problème cartésien est de penser le rapport ou la relation entre deux substances distinctes. Du reste, la glande pinéale ne suffit en rien à penser cette union. Dès lors, Descartes, dans la Lettre à Elisabeth du 28 juin 1643, entend montrer que si les pensées métaphysiques, exerçant l’entendement pur, nous permettent de penser distinctement l’âme ; si encore, l’étude des mathématiques, nous accoutumant aux figures géométriques, nous offre la possibilité de comprendre le corps ; c’est, dit-il, « en usant seulement de la vie et des conversations ordinaires (…), qu’on apprend à concevoir l’union de l’âme et du corps. » Ainsi, est-ce ceux « qui ne philosophent jamais, et qui ne se servent que de leurs sens » qui conçoivent le plus clairement « leur union ». Or, outre les conversations ordinaires, celles des bons sens ou des gros bon sens, quel discours sinon celui comique, quoi donc sinon l’humour, pour donner à sentir cette union ? Je cite le Dom Juan (Acte III, Scène 1) :
« SGANARELLE
Mon raisonnement est qu’il y a quelque chose d’admirable dans l’homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela n’est-il pas merveilleux que me voilà ici, et que j’aie quelque chose dans la tête qui pense cent choses différentes en un moment, et fait de mon corps tout ce qu’elle veut ? Je veux frapper des mains, hausser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner…
(Il se laisse tomber en tournant.)
DOM JUAN
Bon ! voilà ton raisonnement qui a le nez cassé.
SGANARELLE
Morbleu ! je suis bien sot de m’amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez : il m’importe bien que vous soyez damné !
DOM JUAN
Mais tout en raisonnant, je crois que nous sommes égarés. Appelle un peu cet homme que voilà là-bas, pour lui demander le chemin.
SGANARELLE
Holà, ho, l’homme ! ho, mon compère ! ho, l’ami ! un petit mot s’il vous plaît. »
Le mystère de l’union de l’âme et du corps est ici rendu par Sganarelle. Mais c’est Dom Juan qui a, pour le coup, le fin mot dans cette histoire. A s’enivrer de ses discours, le nouveau faux médecin zelé, Sganarelle, tombe à la renverse : il perdu la raison et le bon sens en s’écoutant parler. Et c’est d’ailleurs par le raisonnement, nous dit Dom Juan, que les deux se sont à tous les sens égarés. Pour marcher à nouveau avec assurance en cette vie, ce dernier demande à Sganaralle de faire appel au premier quidam venu, au gros sens, au tout-venant. La marche peut ainsi reprendre ; comme la bonne marche de l’union de l’âme et du corps. Une fois le raisonnement désavoué, la conversation ordinaire – ici celle du comique et de la parodie – peut nous faire sentir ou pressentir cette union.
Comme il en était déjà le cas dans L’Amour médecin, au moment où Sganarelle diagnostiquait la fille de Clitandre en prenant le pouls de ce dernier ! Pour s’en expliquer, il évoquait « la sympathie qu’il y a entre le père et la fille. » On imagine même la télépathie ! Cet art du paradoxe ou du contrepied, qui parodie la communication psycho-somatique, la rend sensible en creux, comme si elle affleurait en négatif dans la chute même de la blague. C’est en se bidonnant, que l’on sent comment l’âme touche au corps dans la convulsion, le gloussement, ou l’épilepsie. A ce propos, toute la comédie ou la tragicomédie de la communication impossible, du malentendu, du quiproquo, est encore parodie de la communication cartésienne des substances.
Molière, on le sait, était un ami de Cordemoy, un des grands cartésiens de cette période, et qui notamment avait publié deux traités : l’un intitulé, Discernement du corps et de l’âme, et l’autre, Discours physique de la parole, que Molière avait lu, et dont il s’était inspiré pour écrire la leçon donnée par le maître de philosophie à Monsieur Jourdain dans le Bourgeois gentilhomme (Acte II, Scène 4). Cette fameuse leçon où le philosophe commence par citer la formule latine, « Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago », à laquelle (une nouvelle fois!) l’auditeur ne comprend rien, et qui signifie : « sans la science, la vie serait presque une image de la mort. » Or, dernier gag éclatant la gangue de la science cartésienne, tout tend à laisser entendre à rebours, et par antiphrase : que la seule science qui puisse faire de la vie autre chose qu’une image de la mort, c’est l’incon-science, ou la science de l’incon-science, soit celle du Witzou du trait d’esprit. Laquelle ranime la vie la plus simple, celle des conversations ordinaires, seule pouvant toucher au vif ce qui nous rattache à notre corps.
© Valentin Husson
Retrouvez la première partie de ce cycle d’étude consacré au rire en cliquant ICI
Retrouvez la deuxième partie de ce cycle d’étude consacré au rire en cliquant ICI
Notes :
[1] Lacan, Le Séminaire VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986, p.287.
[2] Descartes, Principes de la philosophie, Paris, Vrin, 2009, p.25.
[3] Ibid., p.27.
Pingback: Surenchérir : pourquoi le rire est-il transgressif ? #2 | Un Philosophe
Pingback: Surenchérir : pourquoi le rire est-il transgressif ? #1 | Un Philosophe