
Laurent de Sutter © Géraldine Jacques
Laurent de Sutter est professeur de théorie du droit à la Vrije Universiteit Brussels. Il dirige la collection Perspectives critiques aux Presses universitaires de France et la collection Theory Redux chez Polity Press. Dernièrement, il a publié Poétique de la police (Rouge Profond, 2017) et Théorie du kamikaze (PUF, 2016) ou encore L’âge de l’anesthésie: La mise sous contrôle des affects (Les Liens qui Libèrent, 2017). En février 2018, il a publié Après la loi (Perspectives critiques, PUF), certainement une des grandes œuvres philosophiques de ce début de siècle. L’auteur y développe, à travers différentes conceptions juridiques, une recherche de la réponse à la question consistant à savoir ce qu’il y a après la loi, notamment dans son rapport confus et complexe avec le droit, avec pour trame de fond l’importance donnée à la question de l’être qui anime l’œuvre de Laurent de Sutter — l’occasion pour nous de cet entretien passionnant dans les méandres de la loi et du droit.
Ce qui frappe, dès la lecture de votre ouvrage, c’est la méthode employée, très soucieuse d’une généalogie de la langue et des mots à travers les époques. Difficile de ne pas penser à Foucault pour la dimension archéologique de votre étude du droit et de la loi et à Nietzsche pour l’aspect philologique et sémantique des concepts. Quelle est votre rapport à ces deux auteurs, notamment à leurs méthodes propres ?

« Après la loi », Laurent de Sutter (PUF, Perspectives critiques, 2018)
Laurent de Sutter : Placer la question de la loi sur le plan d’existence qui est le sien constitue un exercice périlleux, requérant de contresigner au moins un article de foi : qu’elle n’existe, la loi, qu’en tant qu’elle n’est que langage. Que je sache, personne n’a jamais rencontré la loi – de même que personne n’a jamais rencontré le droit, ou la personne morale, ou le patrimoine, ou même le sujet, cette catégorie évanescente née de l’imagination de juristes romains. Tout ce qui constitue l’univers complexe de la juridicité, comprise dans un sens souple, n’est que mot, idée ou concept, mais des mots, idées ou concepts dont l’épreuve, les conséquences pratiques, sont infinies. Je veux dire par là que la dimension absolument concrète, pragmatique, du droit et de la loi repose tout entier sur le fait, dont Giorgio Agamben a donné la version la plus théâtrale et la plus ample, que le langage est sa condition d’existence, son écologie, son lieu – son seullieu. Qu’en parler implique un recours massif à l’histoire du langage, à la linguistique ou à la philologie en est une conséquence nécessaire : on ne peut tout simplement rien dire ni penser du droit ou de la loi sans en passer par là. Sur ce point aussi, je crois, Agamben a montré (ou rappelé) la voie, se plaçant lui-même dans la continuité d’une immense tradition d’historiens du droit, surtout romain, allant de Theodor Mommsen au regretté Yan Thomas, un homme dont on n’a pas assez mesuré l’importance. C’est dans cette direction-là qu’il me paraît falloir regarder, davantage que dans celle, très prestigieuse, que vous mentionnez, pour la simple et bonne raison que cette dernière est avant tout philosophique, et que la philosophie constitue une grande partie du problème que la loi pose au droit aujourd’hui.
Dans le cas de Michael Foucault, le constat est évident : en tant que membre d’une génération ayant voulu en finir avec les grandes figures de l’Être héritées de l’histoire de la métaphysique, le droit lui posait un problème qu’il voulut régler par la critique de la logique des normes – au profit d’une nouvelle culture des corps. A ses yeux, c’était cette catégorie qui pouvait dire le tout du droit et de la loi, « norme », sans que la différence entre les deux ne lui apparaisse une seule fois, et sans, surtout, qu’elles soient pensées dans un propre qui les distinguerait des stratégies de savoir et de pouvoir supposées les déterminer. Ce sont ces stratégies qui, dans son esprit comme dans celui de Jacques Derrida ou d’autres, ont abouti à ce qui puisse être soutenue l’équation suivante : loi = Être, dès lors qu’il est entendu que l’Être n’est que le produit policier des stratégies de savoir et de pouvoir qui en ont besoin pour régner. Si je suis bien entendu d’accord avec cette mise en équation, il me manque, chez Foucault, la moitié du paysage, à savoir ce qui, dans l’histoire de l’équation loi = Être s’y soustrait sans pour autant être un corps étranger – je veux dire : s’y soustrait de l’intérieur, comme si l’équation était en réalité intenable. Or je tiens que cet élément auto-soustrait n’est autre que le droit. Chez Foucault, il n’y a pas de pensée du droit ; il n’y a qu’une pensée de la norme, incapable de déployer les virtualités opérationnelles de la juridicité, en tant qu’elles ne sont pas, et n’ont jamais, été codées par la loi, qui est en effet une invention de philosophes, ou, à tout le moins, un de leurs fétiches. De sorte que la méthode archéologique, qui est une des filles de la méthode critique (Foucault ne l’a jamais caché), finit très vite par se résumer en une tentative d’exhumation du caché ayant pour seul but la dénonciation, très distancée et très high-brow, de ce qui ne va pas et devrait aller autrement, plutôt qu’une description de ce qui va très bien, mais qu’on oublie. Pour ma part, je n’ai pas voulu que le long travail d’exploration de traditions juridiques oubliées du monde entier qui constitue l’essentiel de Après la loine constitue qu’une tentative d’explication de la merde dans laquelle nous nous trouvons – du reste, on ne la trouve pas dans mon livre. Ce que j’ai souhaité mettre en avant, c’est tout ce qui a été forclos par le triomphe progressif de la loi en Occident, quoique cela ait continué à travailler, à fonctionner et à inventer malgré elle – à le mettre en avant et à nous inviter à y prendre une inspiration nouvelle, dans un mouvement qu’on pourrait peut-être qualifier de rétro-futuriste.
Quant à l’importance de la philologie dans l’œuvre de Nietzsche, au moins au début, dont on sait qu’elle était surtout liée aux circonstances de son développement (la philologie était la science royale de son temps), je la reconnais volontiers, mais je dois avouer qu’elle n’a pas été une des mes préoccupations. Mon ami Dorian Astor, qui est ma boussole en matière de nietzschéisme, y trouverait sûrement à redire ; pour ma part, je me contenterai de souligner que Nietzsche fait partie des philosophes les moins soucieux de tout ce qui peut ressembler au juridique ou au légal, sans doute parce qu’il était de ceux qui possédaient les relations les plus ambivalentes à la tradition grecque. La philologie, chez lui, n’était pas requise par la condition d’existence d’être particuliers (comme les êtres du droit ou de la loi), mais par son inscription dans l’espace de la philosophie en tant que telle, qui est aussi un espace du langage, mais, cette fois, au sens le plus mondain du mot. Qu’il s’agisse de langage n’est pas une question ontologique, pour Nietzsche (je suis certain que Dorian trouverait des fragments pour me contredire), mais, si j’ose dire, une pure donnée factuelle avec laquelle l’enquêteur de l’avenir se doit de négocier – négociation qui se fait avec le langage. Dans mon cas, il ne s’agit pas d’une question de méthode, mais bien d’une question de fonds : l’ontologie et l’écologie du droit ne peuvent être que langagières, et la linguistique ou la philologie que la modalité d’apparition, disons, phénoménologique des êtres du droit dans leur lieu propre. Ni critique, ni méthode, donc, mais description de virtualités et medium phénoménologique.
Pourquoi avoir justement choisi cette étude mettant en parallèle les différentes trajectoires du droit vers la loi, des Grecs à l’Islam, en passant la Rome antique ou le Japon ?
Je crois que l’histoire de la modernité est l’histoire de l’aboutissement d’un processus bi-millénaire de confusion entre droit et loi, de recouvrement du droit par la loi, processus s’ouvrant en Grèce à l’époque des réformes de Clisthène, soit au 5èmesiècle avant notre ère. Il serait trop long de rentrer dans les détails, mais disons que le moment ayant marqué cet aboutissement n’est nul autre que celui de la codification napoléonienne, lui-même résultat d’un long travail de rationalisation réalisé par les juristes de la modernité, au premier rang desquels on trouve Jean Domat et Robert-Joseph Pothier. J’en dis quelques mots dans Magic. Plutôt que me concentrer sur cette longue histoire et sur les nombreuses stratégies mises en œuvre afin d’aboutir au triomphe du normativisme, j’ai voulu rappeler que le choix opéré par l’Occident, non sans nombreuses contestations internes par les juristes eux-mêmes, n’était qu’un possible au milieu d’un éventail très vaste. La mise en œuvre légale du droit à laquelle nous sommes confrontés chaque jour nous paraît la chose la plus naturelle du monde – mais, en réalité, elle n’est qu’une bizarrerie de plus dans un monde qui n’en manque pas, et une bizarrerie qui tient davantage de l’exception que de la règle.

« Magic. Une métaphysique du lien », Laurent de Sutter (PUF, 2015)
C’est pourquoi je suis allé voir à Babylone, dans la Chine ancienne, à Rome, dans le Japon médiéval, chez les docteurs de l’islam, dans l’Inde classique, dans la tradition rabbinique et même dans l’Egypte antique ce dont la loi formait le départ plus ou moins délibéré, plus ou moins volontaire et plus ou moins hostiles. Sur dix sujets au moins (ce sont ceux que j’ai choisis, mais il pourrait y en avoir bien davantage), quelque chose a été oublié par le triomphe de la loi, quelque chose qui, pourtant, faisait partie intégrante du monde du droit : l’idée de modèle, de cas, de savoir, de récit, et ainsi de suite. Il ne s’agit donc pas de mettre les différentes traditions juridiques que je décris en parallèle, mais plutôt de faire saillir, pour chacune d’elles, son point de plus haute singularité, et d’aboutir à définir ainsi une sorte de constellation des possibles pouvait constituer un système autre. Par exemple, la tolérance ontologique dont fait preuve le fiqh médiéval, qui méditait par exemple la question des conditions possibles d’un mariage entre un être humain et un djinn, se place en porte-à-faux avec la limitation légale, aussi fictive qu’incohérente, de l’empire du droit sur les sujets. En réalité, même là où triomphe la loi, l’inscription du droit dans le monde humain ne cesse de craquer, et de laisser apparaître une multitudes d’êtres différents, n’ayant rien à voir avec eux, des choses aux abstractions que sont les personnes morales, sans parler des opérations propres au droit, comme l’obligation par exemple.
Cependant, qu’on en soit encore à discuter de la question de savoir s’il pourrait être envisageable de donner des droits aux arbres témoigne de notre myopie à ce propos ; au Moyen-Âge, on n’avait pas peur d’intenter un procès à un banc d’anguille se soustrayant à la pêche, dans un étang où, d’habitude, il se laissait pêcher. Aussi saugrenu puisse-t-il paraître à nos yeux sur-rationalisés, on peut observer à l’œuvre dans un tel scénario la machinerie opérationnelle d’une juridicité absolument indifférente, dans son principe, à l’humanité – même si, à l’évidence, elle est le produit de son inventivité. De Platon à Kant en passant par Cicéron ou Erasme, on pourrait dessiner la généalogie de ceux que cela a toujours scandalisé, et qui n’ont vu dans cette inventivité que la preuve d’une absurdité fondamentale du droit, qu’il fallait à tout prix domestiquer par le recours aux principes de la loi, perçue, par une ironie piquante, comme expression de l’ordre de la nature. En réalité, la nature en question était aussi fine qu’une feuille de papier à cigarette : elle ne comprenait que les êtres humains, évoluant sous le regard de l’un ou l’autre dieu, sur la surface d’un monde réduit au rang de pur objet exploitable – tout autre description paraissant ridicule, voire même indécente.
Le droit, pour sa part, n’a jamais eu peur de l’émotion humaine, trop humaine, qu’est le ridicule ; au contraire, il n’a cessé d’explorer l’incroyable réservoir de bizarrerie qu’est la Création avec le regard naïf de celui qui accepte tout, tolère tout, et accepte toutes les invitations à venir faire joujou. Pour les grands esprits, il fallait que ce fût dénoncé comme « arguties », « bavardages », « absurdités », bref l’ensemble des qualificatifs dont on affuble d’ordinaire les enculeurs de mouche, accusations dont Cicéron ou Erasme, par exemple, n’ont pas hésité à affubler les juristes de leur temps. Mais derrière ces accusations, c’était toute une police du possible qui était à l’œuvre, police dont on commence seulement à découvrir tout ce qu’elle a rendu, précisément, impossible, alors même qu’il faisait partie, si j’ose dire, de la « nature » du droit de le prendre en compte – car seul le réel relève de l’impossible, et le droit est l’art du réel. Ce que j’ai voulu faire, dans Après la loi, c’est donc lever le voile sur cette dimension de l’impossible, et en restituer, par le biais d’une traversée cursive d’une série de grandes juridiques traditions oubliées (du moins, par l’Occident moderne), la force de production de possibles nouveaux. Si le réel, c’est l’impossible, comme le disait Jacques Lacan, alors il est l’impossible de tout ce qui se présente comme possible dans le moment même où cette possibilité s’avère inadmissible, insupportable, inacceptable au moins de s’ouvrir à l’effondrement – ce qui est mon but.
Par son souci de proposer des voies alternatives aux « énoncés prescriptifs » de la loi, votre livre se rapproche par moments des réflexions de Lyotard (telles qu’on les trouve notamment exposées dans Au juste). S’agit-il d’un auteur important dans votre propre travail ?
Absolument. Lorsque j’ai découvert l’œuvre de Jean-François Lyotard, au début de mes études de droit, j’ai été frappé par la présentation qu’il faisait de ce qui m’apparaissait neuf à l’époque, mais est entretemps devenu un cliché fatigué : la fin des « grands récits » issus de l’histoire de la pensée occidentale. Je n’ai plus cessé de lire Lyotard depuis, allant même jusqu’à éditer, il y a quelques années, un inédit capital : ses leçons données à Propédeutique en 1964, au milieu de la grande période de silence séparant son « Que sais-je ? » sur la phénoménologie de la publication de Discours, figure. J’ai été très fier de recevoir la confiance de Dolorès Lyotard et de Corinne Enaudeau à ce propos, car, pour moi, Pourquoi philosopher ?(c’est le nom de ces leçons) témoigne d’une hésitation profonde, dont il ne restera plus de trace dans l’œuvre ultérieure : ce que j’appellerais celle de la tentation sensible. Il y a une dureté conceptuelle dans le travail de Lyotard à partir de Discours, figure, qui est homogène à son choix de privilégier le langage comme seul espace possible du concept, en ce compris lorsque le concept en question est celui du désir – devenu, chez lui, machine logique, ou, plus précisément, alogique. Mais soit.
Pour répondre à votre question, je dirais que le livre de Lyotard qui m’a le plus marqué est Le différend, que j’ai découvert lorsque je faisais mon DEA en théorie du droit : un livre prodigieusement difficile, mais dont l’idée centrale, celle du « tort » et de son irréductible inscrit dans la fuite du langage, m’est restée. Pour moi, l’idée ranciérienne de la « mésentente » ou du « dissensus » est impossible sans l’invention lyotardienne du « tort » et du « différend », quoi qu’il en soit par ailleurs des différences d’orientation entre les deux registres, le premier, précisément, inscrit dans le sensible, et le second dans la logique pure du langage (Jacques Rancière le reconnaît, d’ailleurs). Par contraste, Au juste, qui me paraît davantage concerner la problématique kantienne du jugement que le point d’impossible forclos par la pensée de Kant (qui est toute entière une pensée de la loi, comme on sait), est un texte dont j’ai eu moins d’usage, quoique je m’en sois servi dans Post-tribunal. La question du jugement sans critère, c’est-à-dire soustrait de tout l’appareillage législatif de la critique, en tant qu’il n’y a de critique qu’inscrite dans le savoir d’une législation préalable du savoir, éloigne profondément de la question du tort, en tant que ce qui pose problème à tout jugement. Pour en arriver à une reformulation de la question du jugement, il faut partir du problème, et non l’inverse – de sorte que, pour moi, Au justene constitue qu’une annexe, capitale bien entendu, mais une annexe tout de même, au Différendet à ce qu’il pose du lien entre tort et langage, tort et dicibilité. Je crois d’ailleurs que c’est ce que Lyotard lui-même laisse sous-entendre dans « Judicieux dans le différend », le texte conclusif du recueil qu’il avait assemblé sous le titre de La faculté de juger, et qui rassemblait des personnalités aussi importances que Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe ou Vincent Descombes.

Jean-François Lyotard
Ses comparses ne l’ont guère entendu, qui ont préféré s’orienter vers une reformulation radicale de la question du jugement (c’est vrai en particulier pour Nancy et Derrida), plutôt qu’affronter le problème du tort, qui les aurait obligés à se poser la question de la continuité : comment continuer, comment « enchaîner » lorsqu’il y a tort ? Lyotard était parfaitement conscient que le tort relevait de l’irruption, de l’événement, de l’inconsistant, de la déconstruction, etc. ; mais ce qui l’intéressant n’était pas la manière dont il interrompait une continuité, mais celle dont il requérait au contraire la possibilité d’une continuité autre. Au milieu de la description des innombrables apories de la logique de la règle (et donc de celle du jugement), Lyotard n’a jamais cédé sur le fait que toute déconstruction de ces apories ne pouvait avoir un sens que si elle permettait d’imaginer une nouvelle manière d’enchaîner, dont le tort serait en quelque sorte la cheville. Lorsqu’il parle, par exemple, de l’ « obligation », en tant qu’elle force à un certain type d’enchaînement oublieux du tort, je crois qu’il met le doigt sur la différence qui m’occupe dans Après la loi, et qui est précisément celle qui distingue la loi du droit : il croyait que le tort devait permettre d’imaginer un régime de « règle » distinct de l’ « obligation ».
Dans son vocabulaire, les « règles » n’étaient bien entendu pas celle du droit, mais celle du langage, et il en allait de même de l’ « obligation » ; mais il était néanmoins possible d’en tirer, par analogie, une leçon applicable au domaine juridique – il suffisait de remplacer « règle » par « droit » et « obligation » par « loi ». De ce point de vue, on peut en effet considérer que mon travail, même s’il se situe en un lieu infiniment éloigné du domaine de préoccupations de Lyotard, constitue une sorte d’hommage, ou, en tout cas, une méditation indirecte sur les pistes dessinées dans Le différendet ses satellites. Ce n’est bien entendu pas le seul, dans la mesure où la figure de Gilles Deleuze, en particulier le Deleuze de Présentation de Sacher-Masoch, joue un rôle très important dans Après la loi, puisque c’est à partir de la reconstruction de la pensée du droit qu’on pouvait y trouver, et que j’ai proposée dans Deleuze, la pratique du droit, que je suis arrivé à formaliser mes propres idées en la matière. Cependant, il n’y a là nulle incompatibilité ; après tout, Lyotard et Deleuze pensaient tout deux qu’il n’y a de relation possible à la loi que sous la forme de l’humour, dans la mesure où son auto-affirmation est toujours-déjà son auto-effondrement, thèse absolument capitale pour moi.
Vous montrez au début du livre que la loi circonscrit un « univers de pensée » : la loi ne peut statuer que sur le réel qu’elle a forclos, elle ne peut penser que dans les limites de « sonréel »… Cette définition de la loi fait étrangement écho au criticisme kantien. En effet, on sait depuis Kant que le philosophe est un « Juge » chargé d’investir le « tribunal de la raison » afin de délimiter le territoire d’une connaissance possible. Vous insistez par ailleurs sur les rapports étroits que la philosophie entretient avec la loi : Platon et Aristote, par exemple, élaborent leurs philosophies respectives dans l’horizon du nomosthéorisé par Clisthène… Après la loi, n’est-ce pas une façon de se demander comment dépasser la philosophie ? Qu’y a-t-il après la philosophie ?
C’est une très belle manière de poser les choses. Je formule en effet, dans Après la loi, un acte d’accusation très fort : l’invention de la loi est une invention qui a trouvé dans la philosophie son medium privilégié – du moins, dans une des options majeures de la philosophe, allant de Platon et Aristote au criticisme kantien, marxien ou nietzschéen, en passant par l’humanisme et les Lumières. Que la philosophie se soit posée en championne de la loi ne signifie pas qu’elle a été la seule : à une certaine époque, la psychanalyse, par exemple, a aussi voulu se faire la championne du « loi » symbolique dont il était difficile de voir en quoi elle se différenciait du nomosstructural des Grecs. Il est vrai qu’il s’agit d’un concept commode – surtout pour tous ceux qui souhaiteraient imposer leur pouvoir sur le monde, qu’on le considère du point de vue des corps plus ou moins pulsionnels, des psychés plus ou moins malades ou des sociétés plus ou moins rebelles.
Dans la modernité, il s’est équipé d’un supplément épistémologique capital, dont les ramifications dans le domaine de l’esthétique, l’éthique et la politique sont bien connues : la critique, et son véhicule, le jugement – critique et jugement qui sont en effet les plus grands dons d’Emmanuel Kant à la pensée occidentale. Outre de nous avoir rendus très bêtes, parce que très sûrs de nous (quoique Kant en ait dit quant à la finitude de notre savoir), le criticisme a déroulé un véritable tapis rouge théorique pour le triomphe mondain de la loi, en lui conférant une nécessité interne, n’ayant plus besoin de Dieu, du Roi ou de la Polis pour en garantir le bien-fondé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’y a de critique que législative, comme je l’ai suggéré plus haut. C’est-à-dire qu’il n’y a de critique, c’est-à-dire de jugement formulé de manière conforme aux critères de son application, et qui préexistent, par définition, aux cas qu’il s’agit de juger, qu’en tant qu’elle aboutit à un verdict fondé quelque chose qui est de l’ordre de l’ordre. Que le jugement soit déterminant ou réfléchissant, chez Kant, il n’existe que pour autant que deux conditions soient remplies : qu’il existe un sujet et un objet ; et qu’il existe un loi pour que l’un puisse établir un rapport avec l’autre – que cette loi soit donnée, ou bien qu’elle soit à supposer.
Même si Marx et Nietzsche, plus tard, n’auront pas de mots assez durs pour condamner ce qu’ils considéraient comme les impasses du kantisme, il n’en reste pas moins que, pour eux, ces deux conditions, et l’activité qu’elles conditionnent, demeurent valides. Seul change le contexte, disons, de l’exercice du conditionnement législatif de la critique : chez Marx, ce serait celui d’une forme économique de domination (la critique est toujours biaisée par la domination) ; chez Nietzsche, il serait celui de l’éventail des conséquences à en attendre (la critique est d’abord élaboration de valeurs). De sorte que, pour moi, critique, loi et jugement appartiennent à un même continuum, que l’on peut rattacher à la même histoire, laquelle trouve sa source dans le conflit fondamental opposant le droit à la loi, ou plutôt l’inverse, conflit qui traverse l’histoire de l’Occident. Lorsqu’Héraclite, pour la première fois, utilise le mot de nomospour nommer l’activité humaine de décision (là où les Grecs parlaient, jusque là, de thesmos, c’est-à-dire, pour caricaturer, de « caprice »), il inaugure à la fois une description du monde et un mouvement de pensée. Cette description du monde, qu’Eschyle formula presqu’en même temps que lui, était celle d’un univers ordonné par un nomos, en tant qu’adéquat, analogue, à celui qui était supposé gouverner le monde des dieux ; quant au mouvement de pensée, incarné, là aussi en même temps, par les réformes de Clisthène, il était celui de la mise en ordre du chaos. La cité d’Athènes ayant été secouée par des graves dissensions (disons : un différend), Clisthène les sutura par l’adoptions de nomoiayant pour vocation d’en redessiner l’ordre de manière à ce que celui-ci définisse un juste partage des parts à l’intérieur d’elle-même – ce que les Grecs nommèrent isonomia. Là où les anciens thesmoi, comme ceux de Solon, ne reposaient que sur eux-mêmes, sans autre justification que leur effet immédiat, les nomoiinscrivirent à l’intérieur de l’espace politique, comme de celui de la pensée, la nécessité d’une justification extérieure, toujours préalable et toujours supérieure, nécessité que Platon et Aristote défendirent plus tard avec acharnement.

Giorgio Agamben
Aujourd’hui, nous en sommes toujours là : nous sommes les enfants de la naissance de la philosophie, qui repose tout autant sur l’invention du logosque sur l’invention du nomos, comme si la philosophie ne pouvait apparaître que sous la forme que prend le langage quand, ainsi que l’a soutenu Agamben, il est considéré comme inséparable de sa dimension juridique – je dirais : légale. Sur ce point, Agamben (comme Deleuze, du reste) a inversé les problèmes : ce avec quoi nous avons à nous débrouiller n’est pas la colonisation du langage par le droit, mais bien par la loi, c’est-à-dire par un des enfants les plus prospères et les plus gras de la philosophie, quoique, bien entendu, elle soit loin d’être la seule responsable de son triomphe. Il se fait que le concept de loi présentait trop d’avantages, et trop puissants, trop forts, pour être laissé aux philosophes, qui se contentèrent de lui conférer les prestiges de la justification ou de la cohérence – du moins, je le répète, une certaine frange, dominante, de la philosophie, toujours active aujourd’hui, et dans tous les domaines. La défense du juste, du vrai, du beau ou du bien, la volonté de sélectionner, à l’intérieur du sensible, ce qui est désirable de ce qui ne l’est pas, constituent autant de manières, progressives comme réactionnaires, d’approfondir le travail de domination de la loi, fût-ce sous la forme, en apparence rebelle, de la critique.
Nietzsche parlait de « législateurs de l’avenir » comme catégorie de philosophes de l’avenir, défendant une philosophie qui dépasse les modalités de la philosophie. Sa quête de justice est inlassable : « Il arriva tardivement — j’avais déjà plus de vingt ans — que je découvris ce qui me faisait totalement défaut : à savoir, la connaissance de ce qu’est la justice. « Qu’est-ce que la justice ? Et est-elle possible ? Et si elle ne devait pas être réalisable, comment la vie serait-elle alors supportable ? » — voilà les questions que je retournais inlassablement. J’étais profondément angoissé de ne rencontrer partout où je cherchais, et en moi-même aussi, que passions, vues obtuses, désinvolture de celui à qui manquaient ne seraient-ce que les prémisses de la justice (Fragments posthumes 1884-1885). Est-ce que l’existence de la loi n’est pas la preuve de cette incapacité de la philosophie en particulier, à répondre à la question concernant l’être de la justice ?
Mais la question de la justice et de son être est précisément une question philosophique ! Les juristes ne se sont jamais demandés si une opération juridique devait être juste ; la seule préoccupation qui a gouverné leurs inventions était de savoir si elles pouvaient porter à conséquences, c’est-à-dire si elles pouvaient permettre de continuer à enchaîner, comme disait Lyotard. Quelle que soit la tradition vers laquelle vous vous tourniez, la « justice » n’est jamais considérée comme un facteur, ni même comme un horizon, de l’activité juridique : si on prend le fiqh islamique, par exemple, la question est réglée du fait que l’équilibre du monde est celui de la création. Dans le cas de la pensée brahmanique, elle l’est par la participation à la balance des forces de construction et de destruction qui écartèlent l’univers et menacent de l’anéantir ; dans celui de la pensée confucéenne, par l’insistance sur les gestes par lesquels le tissage formel des relations peut se poursuivre ; et ainsi de suite.
La justice, si on voulait aller très vite, n’existe que là où s’invente l’isonomia– mot que certains, précisément, ont traduit par « justice », dès lors que la justice n’existe que comme un certain état d’égalité réglé, dont on peut mesurer la perfection grâce à l’application des critères du jugement moral ou politique. De fait, parler de justice, c’est toujours regarder en arrière : ne peut être décrété juste (ou injuste) que ce qui est mesuré à l’aune d’une justice, réelle ou possible, transitoire ou éternelle, dont la définition précède ce qui arrive ; il n’y a de justice que rétrograde. Or ce que propose le droit est tout l’inverse : il propose un enchaînement antérograde, une technique, une logistique, même, de la continuité ou de la fuite en avant, excédant toujours les déterminations légales qui prétendraient l’inscrire dans l’écologie de la justice – de sorte qu’il n’a rien à voir avec elle. Au contraire, vouloir créer une relation, quelle qu’elle soit, entre droit et justice revient à tenter d’arraisonner celui-ci au nom de celle-là – de le mettre littéralement au pas, un pas qui n’est pas le sien mais celui d’autre chose que lui, à savoir le rythme de ceux qui souhaitent s’en servir à leurs propres fins.
De ce point de vue, il faut bien avouer que Nietzsche ne fait guère mieux que ses prédécesseurs ; à certains égards, sa volonté d’appropriation de ce qui est peut être considérée comme encore plus gloutonne, encore plus désireuse d’annexer le monde à sa propre volonté – celle d’un nouveau législateur succédant au juge kantien pour pouvoir lui donner ses ordres. Car il faut bien dire ce qui est : l’ambition philosophique de la critique nietzschéenne (là encore, je sais que Dorian Astor conçoit les choses d’une manière très différente de moi) n’est nulle autre que prendre le pouvoir sur toutes les autres formes de philosophie pour leur imposer la loi d’une critique supérieure. Chez Nietzsche, il faut que la philosophie prime – une philosophie purifiée, rénovée et reconstruite, une philosophie enfin nettoyée des scories du christianisme et d’un certain socratisme, et dont, bien entendu, seul lui serait en mesure de définir le cahier des charges. Quelle appétissante justice, vraiment, que celle du « législateur de l’avenir ». Dans Nietzsche et la philosophie, Deleuze a essayé de la sauver en la tirant du côté de la création de valeurs et de l’assomption de la puissance d’auto-dépassement et d’auto-péremption du sujet devant surhomme – la figure nietzschéenne du législateur s’opposant à la figure kantienne du juge. Mais si, de fait, s’y trouve à l’œuvre une perspective antérograde, celle-ci ne se déploie que sur le fonds rétrograde de la puissance comme condition nécessaire à son effectuation, une puissance permettant de mesurer le succès de la création comme l’échec de ce dont elle se détache, et pour lequel on ne pourrait avoir de mots assez durs.
A mes yeux, ça a toujours sonné comme un fantastique appauvrissement : l’appel à la création me semble n’y être guère autre chose qu’une sorte de rodomontade saturée de testostérone, qui peine à opérer quoi que ce soit dans ce qui nous tient lieu de réel – une manière de se replier sur une souveraineté un peu pathétique. Les vraies inventions ne sont pas des « valeurs » ; elles sont des trucs, des bidules, des choses et des machins – des petits bricolages de matière, sans gloire et sans grandeur, sans beauté et sans prestige, par lesquels des tâches insignifiantes peuvent continuer à donner lieu à d’autres tâches insignifiantes. C’est ce réseau de l’insignifiance, pourtant, qui nous procure un monde, ou plutôt qui fait en sorte qu’il y a, sur cette terre, quelque chose qui puisse être nommé « monde », et qui nous permette de négocier avec elle un compromis plus ou moins vivable et plus ou moins branlant – réseau qui se nomme « logistique ». En somme, pour moi, il n’y a de création que du minable ; là où, chez Nietzsche, le minable doit toujours être rédimé par sa participation à un récit de la réinvention du tout, dont l’insurpassable horizon critique demeure celui de la grandeur, rendue possible par le déploiement de la puissance. Il n’est donc pas surprenant que Nietzsche, en bon législateur, se soucie de justice : il n’y a de justice que de la grandeur de la loi ; l’injustice, elle, est le lot quotidien du droit, et du réseau médiocre des calculs et des opérations qui en composent tout l’attirail – un attirail à jamais soustrait à la grandeur. Lorsque je parle de « logistique de l’excès » à propos du droit, dans Après la loi, c’est donc en tant que l’excès dont il est question est un excès négatif, un décès, un coin enfoncé dans le flan des prétentions législatrices et des désirs de grandeur de ceux qui rêvent encore de puissance et de valeurs.
Dans le chapitre « Ordre et désordre » de Quand l’Inspecteur s’emmêle de Balke Edwards, vous montriez que l’ordre se définit avant tout sur le mode de la géométrie cartésienne, avant de conclure, à partir de la figure de l’Inspecteur Clouseau, de la manière suivante : « Le désordre n’existe pas ; il n’existe que la plus ou moins grande folie de ceux qui prétendent se comporter comme si le monde n’était pas un gigantesque cartoon, et la pantomime plus ou moins ridicule qui sert de déguisement à leur délire ». Est-ce qu’en ce sens vous entendez désigner le « moment de la loi » que nous vivons comme un lieu caricatural, dont la police, comme maintien de l’ordre, serait la grande illusion ?
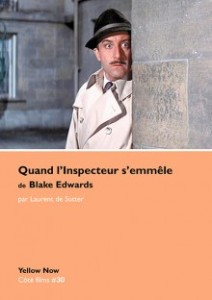
« Quand l’inspecteur s’emmêle de Blake Edwards », Laurent de Sutter (Yellow Now, 2016)
Il s’agit en réalité d’une thèse plus large que ça. Je crois que le long moment de la loi qui se déploie en Occident depuis le Vème siècle avant notre ère n’est qu’une manifestation parmi d’autres d’une expérience générale du comique dont, précisément, la prétention à la grandeur, et aux valeurs qui l’accompagnent, fournit l’argument. La proposition que je souhaite soumettre à l’attention générale est en effet celle voulant que tout affirmation d’une consistance soit la ridiculisation de cette consistance – c’est-à-dire la moment d’exposition de ce qu’il n’y a de consistance que de l’inconsistance, de l’effondré, du ruiné, du raté, de l’échoué. Il est vrai que la loi et l’ordre sont deux candidats particulièrement gratinés à ce qui est avant tout une scène de slapstick : celle où un homme sûr de son importance se retrouve soudain les quatre fers en l’air après avoir glissé sur une peau de banane, présente sur son chemin comme un signe du destin.
Comme l’a expliqué Alenka Zupancic dans The Odd One In, le moment comique essentiel de cette scène n’est pas la chute elle-même, mais bien l’assurance qu’affichait le personnage la seconde avant, la chute ne servant qu’à créer la distance, l’écart, le contraste nécessaire pour pouvoir relire celle-ci après coup. Je crois qu’il en va ainsi de toute chose, dans sa prétention à être quelque chose plutôt que rien (ou mieux : presque rien) : cette affirmation finit toujours par s’abîmer dans son propre grotesque – dans sa propre prétention à consister, c’est-à-dire à s’ordonner suivant un principe qui lui serait extérieur. Il se fait que cette prétention est très fréquente du côté des représentants de l’ordre, en ce compris la plupart des juristes d’aujourd’hui, devenus des simples notables apeurés, qui, tous, ne craignent, et veulent que les autres ne craignent, que le risque du « chaos », le danger du désordre. Je crois que c’est cette crainte qui constitue le cœur comique de leur prétention à consister : en affirmant craindre le désordre, et travailler à ce qu’il ne se produise pas, ils affirment l’inconsistance de leur propre être, en tant qu’il croirait pouvoir l’excepter du chaos qu’ils fantasment. De sorte qu’en effet, assumer ce comique reviendrait à assumer que l’ordre est tout aussi impossible que le désordre, et que c’est cette partition du monde qui est à la source de tous les problèmes qu’elle prétend résoudre en distinguant le bon du mauvais, le désirable du non-désirable.
Je crois que, de ce point de vue, la scène d’ouverture de A Shot in the Dark, qui montre le manège amoureux voyant changer de lit à peu près tous les occupants (et ils sont nombreux) d’un château, incarne assez bien l’espèce de tartuferie qu’il y a à vouloir s’accrocher à un ordre qui n’est que pure façade. S’il devait y avoir un ordre véritable, ce serait celui de sa négation perpétuelle – de la petite négociation plus ou moins merdique avec elle, des arrangements flous, des mensonges lamentables, et des rodomontades aussitôt suivies de taloches, comme celle que l’inspecteur Clouseau ne cesse de se prendre dans la figure. En ce sens, Clouseau n’est bien sûr pas l’exception, le grain de sable comique dans une machinerie sérieuse ; il est au contraire la réalisation la plus parfaite de cette machine, son incarnation même, sa manifestation la plus claire, dans la mesure où les autres personnages parviennent plus ou moins à cacher leur jeu. Bien entendu, en fin de compte, la vérité éclate, et donc la généralité de la crapulerie, de sorte que le caractère d’apparente exception de Clouseau se trouve restitué à sa régularité – le héros n’est jamais un héros, le bon policier est toujours un mauvais policier, le bon mari toujours un mari trompeur (et inversement). De sorte que la police, pour reprendre le mot que vous avez utilisé, n’est rien d’autre, dans notre monde, que la tentative de forclore le comique, de faire croire que la loi peut en effet garantir l’ordre social, pourvu qu’elle soit elle-même fondée sur des plus grands principes renvoyant à des valeurs supérieures.
La police, c’est le sérieux – la police, c’est l’affirmation de la consistance de ce qui est inconsistant, du fondement de ce qui est sans fondement, de l’être de ce qui est sans être, de la vérité de ce qui est sans vérité, et ainsi de suite, dans l’oubli total de ce que la consistance, le fondement, l’être ou la vérité ne sont pas les solutions mais les problèmes. Pour le droit, en revanche, tout ça n’a pas beaucoup d’importance : seule compte la petite fabrique opérationnelle de la continuité – une continuité qui ne prétend jamais à rien, si ce n’est à rendre possible autre chose qu’elle-même, une opération autre, dont elle ne sait encore rien, ni même si elle aura le moindre intérêt. Je tiens en effet que la technique juridique tient avant tout de l’opérationnalisation locale de l’indétermination, et donc de la possibilisation de chacun de ses moments, de chacune des branches d’enchaînements qu’elle a construites avec le temps, mais qu’il lui est loisible de reparcourir et de réarticuler à loisir d’une autre manière, pourvu qu’elle donne lieu à des conséquences inédites. Cela n’a rien d’extraordinaire. Aucun salut n’est à en attendre, pas plus qu’une plus grande sophistication politique ou existentielle de la vie humaine ; en revanche, elle constitue une des incarnations les plus vivaces de ce qui s’oppose, et s’opposera toujours, aux stratégies critiques d’impossibilisation policière, à savoir, précisément, la possibilité matérielle de la continuité. Comme le disait le bon vieux Samuel Beckett dans L’innommable : « il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer » ; ou comme le répétait William Shatner dans chaque épisode de Star Trek : « explorer d’étranges nouveaux mondes. Partir à la recherche de nouvelles formes de vie et de nouvelles civilisations. Oser aller là où aucun homme n’a jamais été avant. » Par exemple, à la boulangerie.
Entretien préparé par Mickaël Perre et Jonathan Daudey
Propos recueillis par Mickaël Perre et Jonathan Daudey
A LIRE | La recension d’Après la loi par Mickaël Perre en cliquant ICI
Pingback: Entretien avec Laurent de Sutter : « Je dois bien reconnaître que je m’en fiche pas mal, de la philosophie » | Un Philosophe
Pingback: Entretien avec Laurent de Sutter : « La raison n’est raison que parce qu’elle est délire » | Un Philosophe
Pingback: Entretien avec Laurent de Sutter : « La critique était une manière de gagner sur tout ; je cherche une pensée qui accepte de perdre sur tout – face à elle-même pour commencer » | Un Philosophe