
Portrait d’Albert Camus en 1946 (Flickr / Ur Cameras)
Les lecteurs de Camus se souviennent toujours de la première phrase du Mythe de Sisyphe. La violence avec laquelle l’auteur y rejette comme « futile » tout un ensemble d’interrogations philosophiques est presque grotesque. Camus semble vouloir choquer son lecteur. L’on peut, pour expliquer la brutalité de cette ouverture, invoquer des raisons personnelles. Roger Quilliot, dans la présentation qu’il consacre au Mythe songe surtout aux événements auxquels, en 1942, la France est confrontée. L’auteur du Mythe de Sisyphe, tuberculeux, a, de plus, rompu avec Simone Hié, qui le trompait pour se procurer de la morphine ! Il faut également penser aux études de philosophie qu’il vient d’achever : non seulement elles ne lui ont pas apporté les réponses qu’il cherchait, mais elles ont intensifié ses doutes. Il n’est donc pas étonnant que Camus, lui-même frôlé par la tentation du suicide, ait voulu, dans Le Mythe de Sisyphe, prendre à bras-le-corps le problème philosophique posé par la mort volontaire. Mais ces motifs, psychologiques, n’expliquent que partiellement le tempérament philosophique que révèlent les premières lignes de son premier grand « essai idéologique » :
Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a trois dimensions, si l’esprit a neuf ou douze catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux ; il faut d’abord répondre. (II 99)[1]
Le style est incisif, l’affirmation lapidaire : comment est- il possible d’affirmer que ce problème est non seulement digne d’intérêt, mais bien « le seul problème philosophique vraiment sérieux ? » La prémisse, implicite, est celle-ci : Camus remarque que, pour s’interroger sur les « catégories de l’entendement », « les dimensions du monde », etc., le philosophe doit bien exister, donc affirmer ou avoir affirmé la valeur de l’existence. Si l’on veut respecter l’ordre des questions, il faut donc partir de celle du suicide, plus « fondamentale» que toutes les autres, puisqu’elles la présupposent toutes. Sartre soulignait qu’au début de L’Etranger, Camus cherche à faire sentir le « choc » de l’absurde. C’est ici la violence de la question qu’il pose que le lecteur est, brusquement, amené à considérer. Philosophant dans l’urgence, Camus brutalise ainsi son lecteur pour l’amener à faire retour sur sa propre vie.
Penser, pour Camus, c’est donc être embarqué, ne plus pouvoir se réfugier, si l’on peut dire, dans la neutralité : étant à la « question », dirait Camus, l’homme ne peut reculer ni rester sur place : « il faut répondre » (II 99). Ce qui exige, dirait-il, utilisant volontiers un vocabulaire sportif, de ne pas « tricher ». Se réclamant de Nietzsche, Camus soutient que, si une question est importante à proportion des « actions qu’elle engage », le philosophe, lui,est « estimable » seulement s’il « prêche d’exemple » (II 99), seulement s’il agit, pour le dire autrement, en conformité avec ce qu’il sait ou croit savoir. Aussi refuse-t-il, au nom de la valeur, à la fois extra-théorique et infra-morale, de « conséquence », de probité dirait Nietzsche, de prendre en compte les subtilités de la psychologie.
Il est, d’abord, presque impossible de fixer « la démarche subtile où l’esprit a parié pour la mort » (II 100). Les journaux évoquent les « chagrins intimes » (II 100). Peut-être un « ami du désespéré » lui a-t-il parlé sur un ton indifférent. Camus refuse ce type d’enquête, le suicide lui apparaissant toujours comme imprévisible, « incontrôlable » et revient à l’acte lui-même. Ce faisant, il lui trouve, un peu rapidement, un lien direct avec l’absurde : « Mourir volontairement suppose qu’on a reconnu, même instinctivement, (…) l’absence de toute raison profonde de vivre (…) » (II 101). Puisqu’une véritable raison de vivre lui donnerait le courage d’exister malgré les coups infligés par la vie, le suicidé serait toujours un Hamlet qui s’ignore ou s’ignorait.
D’autre part il convient, dit tranquillement Camus, sans craindre le ridicule, de se conduire de façon « injuste, c’est-à-dire logique » (II 103), en d’autres termes, de se suicider si l’absurde le commande. Camus prend, concernant les subtilités de la psychologie, deux exemples. Le premier est celui de l’habitude : l’esprit, dans l’habitude, selon une formule de Joseph Hermet, s’identifie à ce qui n’est pas lui[2], ne pense plus à ses angoisses, s’assoupit, existe moins qu’il ne vit : l’on peut penser que l’existence n’a aucun sens, mais « le corps recule devant l’anéantissement » et la voix de la vie, que l’habitude fait entendre, vaut bien celle de l’esprit. Pascal, avant Camus, remarquait également que les hommes se divertissent, s’occupent, s’agitent pour occulter une inquiétude d’ordre ontologique. Pour celui qui désire fuir son néant, la valeur d’une activité tient seulement à sa violence. Camus, lui, parle « d’esquive », « concept » sportif, et nous dit qu’elle est à la fois plus et moins que le divertissement. En réalité, elle en est l’exact symétrique : à l’inverse de Pascal, selon qui le divertissement consiste toujours dans une diversion, sinon de Dieu, en tout cas de la considération du péché qui devrait nous y ramener, Camus considère que l’esquive consiste toujours à croire sinon en Dieu, aux ersatz de Dieu constitués par les différentes idéologies .L’homme du divertissement fuit la question du Sens ; l’homme de l’esquive l’a affrontée, mais a évité le coup qui allait lui être décoché en agissant comme si la vie avait un sens.
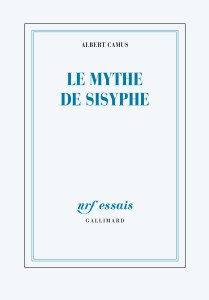
Albert Camus, « Le mythe de Sisyphe » (Gallimard, 1990[1990]
Le sentiment de l’absurde est d’autant plus mystérieux qu’en amont de la condition humaine, il n’y pas d’état prélapsaire ; qu’en aval de notre misère, il n’y aura pas de rachat par la grâce. La nostalgie camusienne est donc sans objet ; son étonnement, sans élément de comparaison ; sa misère, sans grandeur perdue. En effet, Camus décrira le sentiment de l’absurde comme une révélation à la fois brutale, imprévisible et incontrôlable. Partons d’une phrase du Mythe : de l’absurde, Camus dit qu’il peut frapper, au détour de n’importe quelle rue à la face de n’importe quel homme (II 105).
L’absurde n’est donc pas, selon Camus, un sentiment réservé à « quelques élus ». Les quelques « vérités » découvertes par celui qui en fait l’épreuve n’exigent pas, pour être comprises, une intelligence rare : à se fier aux discussions entendues dans le métro ou dans la rue, la philosophie de l’absurde est même peut- être, sinon celle de l’homme du commun, du moins la seule qu’il pourrait faire sienne. Que l’homme s’ignore et ignore le monde, que la mort soit imprévisible et prive l’existence de toute signification, ce sont là des idées plus facilement audibles pour celui-ci que celles enseignées par les grands systèmes philosophiques. Il y a donc une « pré-compréhension » de l’absurde, « pré-compréhension » qui n’est pas réservée, tant s’en faut, aux philosophes, mais qui s’actualise seulement lorsqu’un événement déclencheur bouleverse la vie d’un homme.
Cette compréhension anéantit pour ainsi dire celui qui en fait l’épreuve. Camus a insisté sur le caractère destructeur de l’absurde. Il s’agit, dans l’absurde, d’un choc, d’un ébranlement, d’un mal atteignant l’homme dans sa chair : « Oh ! Caesonia, dit Caligula, je savais qu’on pouvait être désespéré, mais j’ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais comme tout le monde que c’était une maladie de l’âme. Mais non, c’est le corps qui souffre. » (I 26). Non seulement l’idée que se faisait du futur l’homme frappé par l’absurde est transformée, mais l’idée qu’il se faisait du passé l’est également. L’absurde agit, en quelque sorte, de façon rétroactive sur le passé, sur ce que l’on croyait être le passé. Caligula, devenu monstrueux, savait pourtant que la vie n’est pas bonne, mais qu’il y a la religion, l’art, l’amour. Meursault apparaît, en quelque sorte, comme un être impersonnel, sans histoire, apparu depuis on ne sait quand à l’intérieur d’un monde dont il ne déchiffre pas les symboles. Dans Le Malentendu, les personnages ne se reconnaissent plus les uns autres – « Quel dur visage est le tien, dit par exemple la mère à Martha » (I 117). La perspective de la mort irréalise l’existence de celui qui vit encore.
A la façon de la négation cartésienne, à laquelle l’auteur se réfère à plusieurs reprises, l’absurde irréalise ce qu’était l’homme, et tout ce à quoi il s’identifiait, avant qu’il ne soit frappé. Ne reste, pour reprendre le titre que Camus voulait donner à La Chute, qu’un cri, qu’une chair consciente et souffrante, qui, naguère détournée d’elle- même dans l’habitude, le divertissement, se découvre non comme ego substantiel, mais comme « appétit de sens » insatisfait. Ainsi Hélicon dit-il, insistant sur la passivité de l’homme (« L’on est choisi ») face à l’absurde, sur son caractère destructeur, pour ainsi dire désubjectivant (« L’on est choisi »), la rupture (« et puis ») inexplicable (« C’est comme ça ») en laquelle il consiste, dit-il : « Notez bien, le malheur, c’est comme le mariage. On croit qu’on choisit et puis on est choisi de personne. C’est comme ça (…) » (I 11). L’expérience de l’absurde est donc expérience négative, expérience sans objet – l’on est choisi, « mais de personne ou de rien » (I 1758) – expérience d’une absence, du rien en personne, de l’absence de sens, de signification d’un monde désormais hostile.
Aussi, lorsqu’il décrit cette rupture, Camus insiste-t-il sur le fait que, pas plus qu’il n’y a d’individu privilégié (« n’importe quel homme… »), il n’y a d’événement privilégié (« n’importe quelle rue… ») pour éprouver l’absurde : « Quand toutes les explications, dit Hélicon à ceux qui invoquent celle de la mort de Drusilla, sont possibles, il n’y a vraiment pas de raison de choisir la plus banale ou la plus bête » (I 1758). Non que certaines circonstances ne s’y prêtent plus que d’autres. Camus a, dès dix- sept ans, souffert de la maladie et il est probable que la tuberculose, chez un esprit amoureux de la vie, passionné tant par le football et les plaisirs du corps que par les études et ceux de l’esprit, ait influencé sa conception de l’existence comme manifestant une contradiction entre le dur désir de durer et la brièveté de la vie. De même, le voyage peut favoriser l’éveil. Ainsi, à Palma, après avoir vu danser dans un café une jeune femme « gluante de sueur » dont l’obscénité choque le jeune Albert Camus et lui semble être une allégorie de la vie, celui-ci sent se briser en lui « une sorte de décor intérieur » (II 42). Le « prix du voyage », savoir la peur, serait plus grand encore s’il n’y avait « les journaux » que lit l’étranger, qui lui rappellent l’homme qu’il était, chez lui, lorsqu’il pouvait « se masquer derrières des heures de bureau et de chantier » ou, du moins, était proche des siens (II 42). Ainsi encore, l’expérience de la monotonie pourra, paradoxalement, favoriser « l’éveil » (II 107), le rythme, mécanique, d’une vie insensée, permettant au travailleur d’entrapercevoir l’absence de sens du temps du monde. La lassitude, en elle-même considérée comme quelque chose d’« écœurant » (II 107), peut ainsi être considérée comme bonne dans la mesure où, à force de répéter les mêmes gestes, il arrive que l’on prenne conscience de leur absurdité et que l’on s’aperçoive par surcroît d’une absurdité plus générale : celle qui nous lie en même temps qu’elle nous oppose au monde. Se renversant en son contraire, l’habitude laisse place, dans la lassitude, à l’étonnement.
Pourtant, Camus insiste sur le fait qu’en droit, chacun peut éprouver l’absurde, n’importe quand. Car, le faire dépendre de conditions telles que l’intelligence conduirait à nier que l’absurde est, en droit, universel, en rendre raison par des causes telles que la perte d’un être cher, à en supprimer la composante épistémique. S’il consiste, semble-t-il, dans une forme de traumatisme, ce traumatisme ne peut s’expliquer par des raisons d’ordre psychologique, mais a pour objet une vérité d’ordre existentiel appréhendée par le sujet. Aussi toutes les causes pouvant être invoquées pour expliquer ce sentiment soudain, subit, imprévisible, ne seront-elles finalement que des prétextes, des occasions qui, en d’autres circonstances, ne l’auraient pas suscité. En effet, les événements sont particuliers et la croyance qui s’impose dans le sentiment de l’absurde est universelle : elle porte sur le monde et non sur tel fait isolé. Caligula emploie, pour décrire l’événement déclencheur, le terme de signe : ce n’est pas la mort de son aimée qui l’attriste, mais ce que cette mort révèle (I 16). Camus, par-là, insiste sur ce que l’effet dépasse la cause l’ayant provoqué : peut-être l’absurdité de l’existence est-elle apparue à Meursault, dans L’Etranger, lorsque sa mère est morte ; peut-être Caligula l’a-t-il éprouvé après la mort de sa sœur ; peut-être l’éprouvera-t-on sans aucune raison. Mais le lecteur n’en saura pas davantage : l’absurde introduit une telle rupture à l’intérieur de l’existence que Camus s’abstiendra de la mettre en scène dans L’Etranger et Caligula. Tout au plus verrons-nous, dans Le Malentendu, cette découverte faite par une personne que l’on n’aura presque pas vu durant la pièce. S’il est vrai que l’événement est, selon une formule de Jean-Luc Marion, sauf erreur de notre part, l’impossible qui se réalise, son introduction dans une pièce de théâtre ou dans un roman constituerait un manquement au principe de vraisemblance. Ainsi, si l’absurde peut conduire au suicide et si, inversement, tout suicide présuppose la reconnaissance de l’absurde, « Ce qui déclenche la crise est presque toujours incontrôlable. » (II 100) Cette crise qui n’a rien, pour reprendre un mot de l’auteur « d’expérimental », devant laquelle le sujet est donc passif, correspond à l’émergence d’un « pourquoi » qui « s’élève » et bouleverse son existence (II 107). Elle marque une rupture irréversible. L’alternative que présente Camus – « l’éveil définitif » ou « le retour inconscient dans la chaîne » (II 107) – ne le dément pas : le fait même qu’il y ait « retour » suggère un changement de perspective. Après que le décor s’est écroulé, un nouvel acte « commence » ; « la lassitude inaugure » le règne de l’absurde ;il s’agit de la « fin des actes d’une vie machinale » ; et, comme dans un roman tenant le lecteur en haleine, il y aura, aussi bien qu’un commencement, une « suite » (II 107) à la découverte existentielle, suite que l’écrivain pourra seulement décrire.
En somme, la véritable intuition de l’absurde se caractérise par son imprévisibilité. D’où l’étrangeté du Mythe qui s’adresse, en quelque sorte, aux initiés : l’écrivain peut écrire deux pièces de théâtre, un essai et un roman, l’écrivain peut écrire un cycle à son propos ; la lecture de ces ouvrages ne remplacera pas l’expérience qui est à l’origine de leur création.

Albert Camus, « L’Etranger » (Gallimard, 1942)
De l’appréhension de l’absurde résultent trois principes. La révolte correspond à la ferme résolution du sujet de ne pas « oublier » son pari, de « retenir » ce que la « négation absurde » lui a fait entrevoir. Ainsi est-elle moins action que conscience. Il s’agit que « l’homme absurde », conséquent avec lui-même, n’« esquive » pas, de nouveau, sa condition. Pour ce faire, il doit s’en tenir à ce qui lui est donné, à ce qui a résisté au travail de sape du doute. Camus, de nouveau, « fait l’idiot » : Dieu, la foi, les valeurs, les idéologies, la vie éternelle sont des notions que l’homme absurde n’admet ni même ne comprend, or « Il ne veut faire justement que ce qu’il comprend bien » (II 137). A ce refus obstiné tient l’allure « don quichottesque » de l’homme absurde, cet orgueil cavalier dont Camus parle avec affection et un brin d’ironie. Mais il faut bien voir la radicalité de la négation absurde : non seulement les « croyances » portant sur le suprasensible, sont éliminées, mais ce qui excède ce qui lui est présentement donné, au « toucher », est tenu, par l’homme absurde, pour inexistant. A la façon d’Epictète, que Camus lisait sur son lit d’hôpital, il tient le pire pour certain et pour actuel : la mort pouvant lui ôter, à tout moment, sa vie, il désespère, réduit son horizon temporel à l’instant.
Ce faisant, dépassant l’angoisse première, l’homme absurde devient plus « disponible ». Sur le plan de sa conduite d’abord, il n’est plus contraint par les règles morales, ici assimilées aux préjugés, d’agir de telle ou telle façon : la seule morale admise est celle de la « sympathie » et de « l’antipathie » (II 154). Ce qui l’affecte de façon positive, ce qui lui convient, lui plaît, il le fait ; ce qui l’affecte de façon négative, lui déplaît, il l’évite. Mais le sens de cette disponibilité est, surtout, relatif à la façon dont il s’éprouve et éprouve le monde : l’homme absurde perçoit le réel avec le désespoir, l’hyperesthésie du tuberculeux, porte sur lui un regard désespéré, désengagé, et découvre ainsi la fascinante inhumanité de la nature.
Camus insiste, bien plus que dans L’Envers et l’Endroit, sur l’aspect positif, pour lui, de la temporalité absurde : ne restent plus, pour l’homme absurde, que le « présent, et la succession des présents, devant une âme sans cesse consciente » (II 145). L’homme absurde fixe son attention sur un devenir dont chaque moment apparaît comme un événement radical, imprévisible, qui aurait pu ne pas advenir. Que le monde continue d’exister étonne, à plusieurs reprises, Camus : il pourrait aussi bien disparaître avec lui.
La pensée de la mort a un autre effet. La nostalgie, « indissociable de l’absurde », peut bizarrement porter sur ce qui affecte actuellement le sujet. Pour Camus, il semble qu’il faille les considérer dans leur peu de réalité pour percevoir la beauté des êtres. Le malin génie de l’absurde a, comme dans une fiction kantienne, irréalisé le monde : pour l’homme absurde, qui ne croit plus aux enjeux de la vie humaine, qui ne croit plus à sa propre durée ni à celle des choses, ne reste plus qu’un jeu d’apparences offertes à son regard désengagé, désintéressé. Ce regard esthétique a donc quelque chose de bizarrement onirique : bien qu’il lise, dans L’Etranger, l’histoire du plus prosaïque des hommes, le lecteur a l’impression, l’ayant achevée, de sortir d’un rêve : tout y est, en raison de la mort, à la fois plus lourd et plus léger.
L’homme absurde libère sa perception. De même que, cessant de comprendre un mot, se l’étant répété plusieurs fois, l’on perçoit soudain ce que sa sonorité a d’étrange, de bizarre, de même, purifiant son regard, l’homme absurde redécouvre l’inhumanité du monde, « le lyrisme des formes et des couleurs » (II 137). La perte du sens, pour le dire autrement, s’accompagne d’une augmentation de la perceptibilité du monde : silencieux en ce sens qu’il ne répond pas à nos questions, le monde n’en est pas moins, ou plutôt n’en est que plus sonore du fait de sa luxuriance, de sa richesse, de sa diversité. Camus ne considère de beauté que naturelle : « gît au fond de toute beauté gît quelque chose d’inhumain » (II 107), c’est-à-dire quelque chose d’insignifiant, d’insensé. Aussi affirmera-t-il, à Francis Ponge, de manière certes ironique, qu’il rêverait d’une philosophie du minéral. La pierre est, en effet, l’objet du monde le moins signifiant, le plus brut, donc peut-être aussi, pour Camus, le plus beau, le plus intéressant.
La passion constitue la réponse positive à la question du suicide : sans l’affirmation originaire du caractère désirable de la vie, la mort n’aurait rien d’absurde. Tel est l’argument de bon sens que Camus oppose à Hamlet : l’on ne met pas fin à sa vie parce que l’on craint de mourir. L’homme absurde ne se suicide donc pas. Bien au contraire, il considère le monde comme un terrain de jeu : puisqu’il n’y a, pour Camus, pas de choix qui ne soit arbitraire, puisqu’il n’y a pas de choix qui puisse s’appuyer sur une valeur ni même sur ce « moi » qu’on peine à définir, il faut multiplier les expériences. La passion, pure passion de vivre, est donc rejet des « passions » : selon la définition classique, le désir de l’homme absurde n’est plus polarisé sur des objets idéalisés dont il ferait dépendre son bonheur. Comme Don Juan, il considère qu’il n’y a d’amour que « singulier et passager », qu’il n’y a pas, pour le dire autrement, d’amour en soi, mais seulement différents composés « d’intelligence, de désir, de tendresse » (II 155). Comme Meursault, il répond à celle qui lui demande de l’épouser qu’au fond, ç’aurait pu être une autre, mais que l’idée lui plaît, ou en tant cas ne lui déplaît pas. Aussi bien renonce-t-il à l’amour-propre, amour d’un « moi » idéalisé et, pour cela, mensonger. Ce qu’illustre l’acteur qui, faute de savoir qui il est, multiplie les visages. Ce que désire l’homme absurde, c’est en somme être tout, c’est-à-dire vivre le plus, et n’être rien, c’est-à-dire ne pas se laisser prendre au jeu. Il est généreux, au sens quasi nietzschéen que Camus donne à ce terme : il cherche moins à se conserver, à être, qu’à s’épuiser, à ne garder en soi aucune virtualité : il s’agit pour lui de brûler la vie par les deux bouts.
© Gabriel Arzounian
Vous pouvez retrouver la seconde partie de ce cycle d’études en cliquant ICI.
Notes :
[1] Nous citons les deux tomes de la Pléiade, le premier comprenant les œuvres littéraires de Camus, le second ses œuvres philosophiques. Albert Camus, Théâtre, récits, nouvelles, Roger Quilliot (éd.) Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1962 Albert Camus, Essais, Roger Quilliot, Louis Faucon, (éd.), Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1965
[2] Hermet, J. Albert Camus et le christianisme l’espérance en procès, Paris, Beauchesne essais, p.45
[3] Nous citons ainsi les trois tomes des Carnets de Camus : Carnets, Gallimard, 2013, édition Kindle.
Pingback: La philosophie d’Albert Camus | « L’Homme révolté » et la morale absurde (2) | Un Philosophe