
Portrait d’Albert Camus en 1943 (©RENE SAINT P)
La question de la nature des valeurs est surtout développée dans Remarque sur la Révolte et L’Homme Révolté. Ce que ces textes ont d’obscur, malgré leur clarté apparente, ne tient nullement à une négligence conceptuelle de l’auteur. Passant de l’introduction au premier chapitre, le lecteur est étonné par la rupture entre le style argumentatif de celle-là et celui, descriptif, dont use Camus lorsqu’il décrit la révolte de l’esclave contre le maître. Camus argumentait pour démontrer que la question morale est indécidable à partir du point de vue de l’absurde : d’un côté, l’absurde, disait-il, autorise le meurtre. Non qu’il l’encourage : l’attitude absurde est amorale, plutôt qu’immorale ; mais, si rien n’a de sens, l’on peut se comporter comme Caligula ou Rieux, c’est équivalent ; l’on voudrait alors ne pas agir mais, en politique comme en métaphysique, la neutralité est impossible puisque l’absence de choix est elle- même un choix ; à la rigueur, ne disposant pas d’une valeur supérieure pouvant orienter l’action, l’on comprendrait même qu’on agisse en valorisant la force. De l’autre, pourtant, il l’interdit, puisqu’à la fin du Mythe, l’on concluait que la vie est bonne, or, sauf par goût du confort, dit Camus, l’on ne voit pas pourquoi elle ne le serait pour autrui aussi bien que pour soi- même. Camus argumentait, donc, pour montrer que le meurtre est, si l’on prend sur lui la perspective de l’attitude absurde, à la fois possible et impossible, légitime et illégitime. Il décrit l’événement de la révolte pour montrer que celle-ci lui fournit une réponse. Loin qu’il s’agisse seulement d’une question stylistique, cette rupture tient au fait que la conception camusienne de la morale est événementielle.
Camus souligne cette dimension en montrant que, si le révolté affirme que son maître a dépassé un seuil d’injustice qui l’amène à se dresser contre lui, d’un autre côté, l’esclave avait « reçu sans réagir des ordres plus révoltants » (II 424). Il n’y a donc pas de corrélation entre le taux d’injustice subi et la réaction du révolté. Mais il la souligne surtout en montrant que ce qui l’amène à combattre, ce n’est pas une valeur antérieure à la révolte, par exemple une idée théorique de ce qu’est l’homme, de ce qu’il doit être. Ce n’est pas, sur le plan psychologique, la valeur qui précède la révolte, c’est au contraire la révolte qui invoque une valeur. Ce ne sont pas ses « convictions » qui amènent le révolté à se battre : dans ses pièces, Camus décrit des hommes de principe n’agissant guère et des hommes de « peu de morale » soudain amenés à lutter. Enfin la signification de l’existence du révolté est redéterminée par l’événement qu’il vient d’affronter : « Cet élan, dit Camus, est presque toujours rétroactif » (II 424). Sa condition lui semblait normale ; elle lui semble intolérable. Ainsi l’événement de la révolte, dont l’événementialité même atteste l’authenticité, partage-t-il les mêmes caractéristiques que l’absurde. Le sujet est dans un premier temps passif lors de sa découverte et ne peut donc pas le prévoir. Bouleversant pour ainsi dire son existence, la révolte l’amène à s’élever, de la perception d’une injustice qui est seulement l’occasion de sa découverte, à l’universalité « soupçonnée » de la nature humaine. En somme, on entre en morale comme on entre en religion ou en absurde, par un saut que rien ne laissait prévoir.
C’est toujours l’ordre de la valeur et de la réalité qui rend compte des choix de Camus. Tandis que le jugement de l’homme révolté est réfléchissant, partant d’une injustice perçue pour remonter à l’idée d’une nature humaine dont la valeur découverte par l’homme révolté est comme le signe, le jugement du révolutionnaire part d’une idée abstraite de l’homme pour l’insérer de force dans le monde. Camus s’oppose d’abord à la morale abstraite : pour être à la base pétrie de bons sentiments, elle n’en conduit pas moins à la terreur. L’humanitarisme est à l’humanisme ce que l’idolâtrie est à la religion. Au lieu d’aimer l’humanité, l’on s’en forge une image qui ne renvoie qu’à soi-même, à un rêve et à une idée de l’homme érigés en valeurs suprêmes. Cette idée est non seulement fausse, puisqu’elle méconnaît la nature humaine, toujours faillible, mais dangereuse, puisqu’elle condamne ses imperfections. Ainsi Rousseau divinise-t-il la personne politique née du contrat social : « Si l’homme est naturellement bon, si la nature en lui s’identifie avec la raison, il exprimera l’excellence de la raison, à la seule condition qu’il s’exprime librement et naturellement » (II 525). Mais, cela étant posé, l’irrationalité de l’homme apparaît à la fois comme un accident et comme un vice que l’on pourra corriger, s’il le faut, par le châtiment qui n’est rien d’autre « qu’une manière de le “forcer à être libre” » (II 524). Il faut distinguer l’homme et le peuple réels, la volonté de tous, et l’homme et le peuple idéaux, la volonté générale. Thèses qui amèneront, selon Camus, à Saint-Just et à la Révolution Française, mais aussi, semble-t-il, à la « morale » marxiste, « morale » qui n’est pas tant, selon Camus, en rupture qu’en continuité avec celle de Rousseau, Saint-Just, etc. De la même manière que Rousseau, Marx part d’une idée abstraite, fantasmée, du prolétariat et de l’histoire qui amènera au réalisme historique, le prolétariat apparaissant comme « le Christ humain qui rachète le péché de l’aliénation » (II 610). Aussi la terreur qu’exerceront les communistes, dans l’U.R.S.S., sera-t-elle, au même titre que le nazisme, nihiliste. Ce qui distingue le meurtre commis par le révolté et le meurtre nihiliste, c’est précisément la justification antérieure du second à l’intérieur d’un système idéologique. Non que le crime du révolté n’en soit pas un, mais, précisément, il apparaît comme une horreur qu’il doit commettre pour affirmer sa liberté ou celle d’autres hommes, tandis que le crime de raison apparaît au nihiliste comme le résultat, implacable, d’un syllogisme.
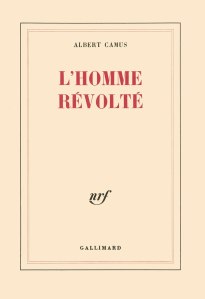
Albert Camus, « L’homme révolté » (Gallimard, 1951)
Mais cette événementialité de la découverte morale comporte une contrepartie négative : la valeur découverte est « confuse ». Son évidence est inversement proportionnelle à la précision de son contenu. Ce qui explique l’association de prime abord étonnante de l’évidence et de la confusion de cette valeur, mais qui ne l’est nullement si l’on distingue l’évidence de ce qui est mal et la confusion de ce qui serait bon. Non seulement l’homme révolté sait ce qui est mal, mais, à l’instar d’Ivan Karamazov qui accepte d’être damné si un seul enfant n’est pas gracié, il tient le caractère injustifiable de ce mal pour indépassable. C’est un mal qui exclut toute théodicée, chrétienne ou communiste : seul, le saut en Dieu (deuxième prêche de Paneloux) ou en l’Histoire, suicide philosophique, suicide de la raison, peuvent permettre au sujet de l’accepter. Pourtant, le révolte serait bien en peine de préciser, si on le lui demandait, ce qui est bien. Ce qu’on pourrait illustrer par la phrase : « je ne sais nullement ce qui est bien quoique je sache certainement ce qui est mal » ; ou, plus précisément encore : « je sais que ceci est mal, bien que je ne sache nullement pourquoi ça l’est ».
Camus sera amené, en raison de ce paradoxe, de cette dissymétrie entre la connaissance du mal et celle du bien, à rencontrer une aporie. Nous suivrons donc ici, très brièvement, l’évolution de sa pensée. Lorsqu’un individu se révolte, donc, il découvre une forme de « transcendance horizontale » qui le lie aux autres hommes (l’expression, curieuse, se situe dans Remarque sur la révolte) et soupçonne une « nature humaine » (l’expression est dans L’Homme révolté). Le critère rendant compte du fait qu’il ne s’agit pas d’une illusion, mais bel et bien d’une valeur authentique, est le sacrifice. Si le révolté transcende sa propre individualité au point de pouvoir se suicider en son nom, s’il la transcende à tel point qu’il se sent solidaire non seulement des êtres oppressés, mais du maître qu’il va tuer puisqu’il a nié leur dignité en les asservissant, c’est qu’il doit y avoir entre eux quelque chose comme une « complicité » métaphysique, que doit exister quelque chose comme une « nature humaine ». Aussi Camus est-il forcé d’admettre que, de quelque manière, cette valeur transcende l’histoire : « cette valeur n’est pas relative » (II 1687). Il s’en faut que le respect accordé à l’individu et l’égalité de principe constituent une donnée universelle. Et Scheler a raison de dire que « l’esprit de révolte s’exprime difficilement dans les sociétés où les inégalités sont très grandes (castes hindoues) ou, au contraire, dans celles où l’égalité est absolue (certaines sociétés primitives) » (II 429). La révolte semble donc liée à une situation historique précise. Mais cela n’implique pas que la valeur découverte dans la révolte soit tributaire d’une situation historique : « Cela prouve que, même sur le plan de l’histoire, le problème est métaphysique ». (II 1688) Autrement dit, la révolte n’a pu apparaître que dans un monde sorti du sacré et où l’homme « possède une conscience élargie de ses droits » (II 1687). Ainsi, si Camus insiste, d’un côté, sur l’aspect éminemment positif, concret de la révolte, d’un autre côté, il montre que l’étude de la révolte ne relève pas de la psychologie. C’est pourquoi il la distingue de la pitié, « subterfuge psychologique » par quoi le sujet croit souffrir en l’autre. Si l’injustice subie est l’occasion de la découverte du révolté, cette découverte la transcende dans celle, plus fondamentale, de la nature humaine et d’une valeur à laquelle le sujet s’identifie.
Deux problèmes apparaissent alors manifestement. D’une part, est-il possible d’affirmer l’existence d’une nature humaine, même en partant d’une situation concrète, sans tomber dans l’écueil que Camus voulait, précisément, éviter : l’abstraction ? A cette question, il semble que la position de Camus à propos de l’Algérie, son erreur, suffise à donner une réponse. Camus mettait en regard, d’un côté, l’humanisme, purement théorique, de Rousseau et Bentham, de l’autre, la révolte de Heathcliff, dans les Hauts de Hurlevents qui « demande l’enfer pour être réuni à celle qu’il aime » (II 429) et celle de maître Eckhart qui affirme, « dans un accès surprenant d’hérésie, qu’il préfère l’enfer avec Jésus que le ciel sans lui » (II 429). Les exemples en disent moins sur le caractère concret de la valeur découverte que sur les difficultés posées par l’admission d’une curieuse transcendance horizontale. Car Maître Eckhart aime Jésus, Heathcliff est prêt à se damner pour une femme et non pour l’humanité. Peut-on aimer celle-ci de la même manière ? L’on comprend, ayant posé cette question, cette remarque des Carnets : Camus, qui distinguait une morale abstraite d’une morale concrète, pourra finalement affirmer :
J’ai abandonné le point de vue moral. La morale mène à l’abstraction et à l’injustice. Elle est mère de fanatisme et d’aveuglement. Qui est vertueux doit couper les têtes. Mais que dire de qui professe la morale, sans pouvoir vivre à sa hauteur. Les têtes tombent et il légifère, infidèle. La morale coupe en deux, sépare, décharne. Il faut la fuir, accepter d’être jugé et ne plus juger, dire oui, faire l’unité – et en attendant, souffrir d’agonie. (C3 304[3])
Mais, d’autre part, au nom de quoi le révolté peut-il s’assurer de la validité de son expérience ? D’un côté Camus voit bien que la solidarité humaine doit être fondée sur autre chose qu’une simple communauté d’intérêts d’ordres social ou politique. Mais, d’un autre côté, il ne voit pas en quoi consiste cet absolu qu’il pense alors découvrir, écrivant dans ses Carnets : « Mais s’il y a une nature humaine, d’où vient-elle ? » Deux autres points nous amènent à conclure que Camus a, ici, été face à une aporie. Premièrement, nous pensons à une autre remarque. Camus écrit : « Deux erreurs vulgaires : l’existence précède l’essence ou l’essence l’existence. L’une et l’autre marchent et s’élèvent du même pas » (C3 92). Or, s’il est vrai que les deux positions sont, plutôt que des erreurs vulgaires, des positions difficiles à soutenir dans toute leur radicalité, dire que l’essence et l’existence de l’homme avancent du même pas, c’est tomber sous le coup de la critique que Camus lui-même adressait à l’historicisme. Deuxièmement, il faut remarquer qu’à la question de savoir quelle est la valeur découverte la révolte, l’auteur n’a pas répondu. Dans Remarque sur la Révolte – mais non, fait significatif, dans le premier chapitre de L’Homme Révolté – Camus affirmait qu’une étude approfondie de la révolte amènerait à définir cette valeur. Or, à notre connaissance, Camus ne l’a pas fait, du moins explicitement. Affirmer qu’il s’agirait de l’humanité, de la solidarité, de la justice ou de la liberté, ce serait oublier la remarque de Camus sur la révolte :
Si l’on se bornait à dire que le contenu de la valeur affirmée est, à en juger par l’histoire, justice et liberté, on ne dirait pas grand’chose. Car on trouvait déjà dans le mouvement de révolte, en même temps que la notion confuse d’un droit les idées connexes de justice et de liberté. (II 1690)
Néanmoins, cette aporie n’est pas inintéressante puisqu’elle amène à la position, plus modeste, soutenue par Camus dans les Réflexions sur la guillotine. Si Camus écrit, dans L’Été, « Les valeurs pour les Grecs étaient préexistantes à toute action dont elles marquaient précisément les limites » (II, 855), l’on comprend qu’il éprouve une nostalgie tragique. A la fois on ne peut vivre sans valeurs supérieures, à la fois on ne peut ni ne doit être certain de leur universalité. La nature humaine, Camus la définira, dans les Lettres à un ami allemand, comme « force qui renverse les tyrans » : c’est dire, la force désignant le « mystère » même, qu’il récuse toute définition précise de l’humanité. Plus souvent, il la considérera comme confusion d’une aspiration au bien et d’une tendance au mal : c’est dire, de façon toute pascalienne, que l’homme est défini par son caractère paradoxal, par son indéfinissabilité. Comme l’indique Ricœur, tout passage à l’absolu est dangereux, toute définition trop précise de l’homme, pourrait-on ajouter, meurtrière : c’est au nom d’une idée de l’homme que les nazis ont tué les Juifs, que les révolutionnaires l’ont terrorisé. En sorte que la valeur-homme, pourrait-on dire, doit rester à jamais confuse.
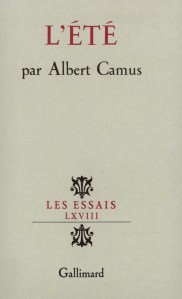
Albert Camus, « L’Eté » (Gallimard, 1954)
C’est pourquoi c’est bien moins la connaissance d’une valeur absolue qu’une même aspiration à cette connaissance, qui constitue non seulement la solidarité humaine, mais le seul sens que l’on puisse attribuer à la justice. Aussi le cercle qu’on a pu déceler dans le premier chapitre de L’Homme Révolté, cercle résidant dans l’opposition entre la première proposition – la révolte est fondée sur une valeur – et la dernière proposition du texte – la valeur est fondée par la révolte – n’est pas purement formel, mais tragique. Sans la valeur, la révolte ne serait qu’un mouvement privilégié, aussi cette valeur doit-elle la précéder ; mais l’affirmer, affirmer que les valeurs préexistent à toute action, c’est-à-dire aussi à la révolte, ce serait sortir du champ du certain.
La pensée des limites, la valorisation de la mesure résultent de cette ignorance. La première apparaît lorsque Camus écrit les Lettres à un ami allemand. L’auteur cite cette phrase de Pascal : « On ne montre pas sa grandeur pour être à une extrémité, mais bien en touchant les deux à la fois ». Si le milieu pascalien et la mesure camusienne ne peuvent en aucun cas être assimilés à un juste milieu tiède, c’est que ce milieu est tragique.
On pourrait le représenter, plutôt que par le milieu d’un segment, par le point d’intersection où se rencontrent plusieurs droites. Camus définira l’introduction du langage de la morale dans l’exercice de la politique en disant qu’il consiste, simplement, à « dire oui et non en même temps et à le dire avec le même sérieux et la même objectivité ». (II 274).
C’est cette instabilité nécessaire entre une affirmation et une négation qui expliquera les positions politiques de Camus. Parce que, reprenant à plusieurs reprises une citation pascalienne, celui-ci affirme que « l’erreur vient de l’exclusion », il rejette les deux formes de nihilisme constituées par l’individualisme bourgeois et le socialisme tel que le conçoivent Lénine, Staline et, avant eux, Marx. Reprenant peut-être à Goldmann, l’idée de l’application du pari pascalien à l’histoire, Camus écrit : « En régime capitaliste, l’homme qui se dit neutre est réputé favorable, objectivement, au régime. En régime d’Empire, l’homme qui est neutre est réputé hostile, objectivement, au régime. Si le sujet de l’Empire ne croit pas à l’Empire, il n’est rien historiquement, de son propre choix ; il choisit donc contre l’histoire » (II 646-647). Si l’histoire se dirige vers une fin idéale, tout est bon, même les meurtres de masse, qui dirige vers cette fin. Le communisme, selon Camus, aboutit donc à la tyrannie, d’abord en ceci qu’il légitime, comme nous l’avons vu, le meurtre, mais aussi parce qu’il abolit les divers ordres de réalité au profit d’un seul. Aussi Camus écrit-il, définissant la tyrannie à la manière de Pascal, c’est-à-dire non comme une forme de gouvernement, mais comme la domination, au sein de ce gouvernement, d’un ordre sur tous les autres :
Il serait injuste, et d’ailleurs utopique, que Shakespeare dirigeât la société des cordonniers. Mais il serait tout aussi désastreux que la société des cordonniers prétendît se passer de Shakespeare. Shakespeare sans le cordonnier sert d’alibi à la tyrannie. Le cordonnier sans Shakespeare est absorbé par la tyrannie quand il ne contribue pas à l’étendre (II 677).
La justice absolue, et l’on pense au communisme, coïncide avec la suppression de la liberté, la liberté absolue, et l’on pense au capitalisme, avec la suppression de la justice. S’il n’est pas question de développer de façon approfondie la pensée morale de Camus, l’on voit en tout cas que le problème se pose de savoir ce que le tragique implique pour l’action. L’auteur emploie parfois le terme d’« ordre » : or, à la fois catégories ontologiques et exigences leur correspondant, les ordres sont, chez Pascal, « disjoints », autonomes, disproportionnés : c’est bien parce que la politique est partiellement indépendante de la morale, c’est bien parce que leurs fins ne sont pas les mêmes, que leur rencontre suscite du tragique. Aussi est-il inévitable qu’en situation, l’agent se confronte àce qu’on pourrait appeler indécidabilité morale. Car, paraphrasant, pastichant l’auteur, l’on pourrait dire que la logique d’entendement est, pour lui, vaine, mais qu’au-dessus d’elle, il n’y a rien. Dans la mesure, donc, où manque, pour Camus, un principe hiérarchique définitif, dans la mesure, d’autre part, où il refuse la tentation hégélienne, le tragique, pour lui, est de prime abord indépassable. Au mieux peut-on agir en dépit de l’indécidabilité qui en constitue l’essence. Ce qui amènera l’auteur à réintroduire, dans sa morale, les notions, éthiques, de vertu et de dialogue.
Camus se réfère aux Grecs. Puisque manque une valeur supérieure, claire et univoque, qui permettrait de déterminer la conduite à tenir, il faut repenser la vertu de mesure et valoriser le dialogue : la conception d’une morale tragique conduit inévitablement à celle d’une éthique des vertus et d’une philosophie de la démocratie. La mesure est la vertu camusienne, vertu tragique qui consiste dans la disposition à rester prudent, à ne jamais simplifier l’adversaire, à ne jamais le tenir pour absolument fautif. Aussi la considère-t-il comme exténuante dans la mesure où elle va contre, pourrait-on dire, la pente de l’homme, celle-ci l’amenant, le plus souvent, à juger de façon absolu et péremptoire, à considérer son point de vue comme le bon, celui de l’adversaire, comme le mauvais. Elle exige, dirait-il, le sens de la nuance, la capacité à percevoir comment, lorsqu’on prend en compte les différentes valeurs qui leur sont indissociables, lorsqu’on essaie de surmonter leurs oppositions, les notions deviennent fécondes, la capacité, par exemple, à distinguer le courage au combat, supposant le goût de la justice, de la folie meurtrière.
Cette notion, en elle-même dialogique, est indissociable de celle du dialogue. Camus n’admet, en morale, qu’une vérité probable, celle qui en est issue. Si, « Ce n’est pas l’ordre qui renforce la justice, c’est la justice qui donne sa certitude à l’ordre » (II 276), cette justice supérieure, qui consiste dans la mise en ordre des ordres, dirait Camus en un langage pascalien, sera toujours approximative et pourra seulement être obtenue par un dialogue libre et franc entre les hommes. Aussi l’unité, qui non seulement n’exclut pas les différences, mais tend à équilibrer les contraires, est-elle une construction fragile, difficile, par opposition à la totalité tyrannique qui les efface. Elle suppose un certain type de dialogue où l’on ne simplifie pas l’adversaire, comme dans la polémique décrite dans la Crise de l’homme, et où l’on n’édulcore pas ses propres positions, ce que Camus entend éviter dans la conférence L’incroyant et le chrétien.
Si la référence à l’éthique s’explique par la nature tragique de la morale, d’un autre côté, elle rend impossible l’élaboration d’un code de conduite rigoureux. La vertu de mesure dit le mystère du jugement, la capacité du sujet à se conduire de façon morale sans disposer d’une règle, en l’occurrence supérieure, lui permettant de trancher entre différentes exigences. Elle désigne sa capacité à inventer, dans le relatif de l’expérience humaine, à créer, plutôt qu’à concevoir, la synthèse, toujours approximative, entre les différents ordres de réalités, les différentes valeurs. Pour Pascal, par exemple, le tragique se résorbait dans la foi puisqu’il trouvait dans l’ordre de la charité un principe hiérarchique définitif : l’on obéit aux lois injustes (ordre des corps) car l’ignorance est une conséquence du péché (ordre de la charité) à quoi il faut consentir. Pour Camus, il faut que l’individu use de sa capacité de juger, s’adapte aux circonstances : il ne peut, pour lui, y avoir de manuel de morale. Comme la philosophie de l’absurde, la philosophie de la révolte est une philosophie du risque et de l’ignorance calculée.
Dans sa Conférence sur l’avenir de la tragédie, Camus poursuit sa réflexion sur le nihilisme, approfondit sa conception du sacré. A présent, le tragique n’est plus seulement étudié d’un point de vue moral, mais, de façon indissociable, sur les plans de la littérature, de la métaphysique et de la civilisation. Du premier point de vue, moral et, pourrait-on dire, dynamique, le tragique, comme nous l’avons vu, tient au conflit d’exigences, ou de forces, à la fois légitimes et inconciliables. Comme l’absurde, le tragique n’« est » donc pas à proprement parler, mais désigne un certain type de relation, plus précisément de « contradiction », entre plusieurs termes. L’absurde était proportionnel à l’intensité de l’opposition entre l’appétit de clarté de l’homme et le silence du monde. Aussi bien le taux de tragique contenu dans une relation est-il en proportion, à la fois, de la légitimité des forces opposées et de leur inconciliabilité. Aussi peut-il se dissoudre de deux manières dans le mélodrame : si l’une des forces en présence perd sa légitimité ou au contraire surpasse l’autre en sorte que sa supériorité ne fasse aucun doute, si leur contradiction est, d’une façon ou d’une autre, résolue. Si Kaliayev avait tort de croire à la vie, si Stephan avait tort de croire à l’histoire, si l’une de ces deux forces primait l’autre, Les Justes ne serait pas une pièce tragique ; pas davantage ne le serait-elle si quelque hégélien venait les convaincre de la partialité de leurs points de vue.

Albert Camus, « Le Malentendu », suivi de « Caligula » (Gallimard, 1994)
Mais les œuvres tragiques, ici, sont considérées comme symptomatiques d’un rapport au sacré. Aussi suscitent-elles l’intérêt non seulement de l’homme de théâtre, mais du philosophe : les grands personnages tragiques, selon Camus, symbolisent certaines valeurs, presque au sens économique du terme, certaines forces. Celles-ci sont, d’une part, le « sacré », le « mystère » auxquels les hommes croyaient, de l’autre « l’individu » et ses capacités de réflexion rationnelle. Le moment tragique est donc, semble-t-il, transitoire : la contradiction opposant l’individu et le sacré est en tant que telle irrésoluble, mais l’une des forces va détruire l’autre.
Il y a eu, selon Camus, seulement deux grandes époques tragiques : la première, qui va d’Eschyle à Euripide, symbolise, « en gros », le mouvement qui va des « présocratiques à Socrate » (I 1700), de la pensée quasi mystique de ceux-là, pourrait-on dire, au rationalisme de celui-ci. La seconde, qui va de Shakespeare à Racine, celui « des théologies passionnées du Moyen-âge à Descartes » (I 1700-1701) qui fonde la Modernité. L’intervalle séparant les deux périodes est d’environ vingt-siècles. Or, écrit Camus, « Pendant ces vingt-siècles, rien » (I 1700). La valeur-sacré, pourrait-on dire, prime à tel point celle de l’individu, de la raison, qu’il n’y a plus de conflits que relevant du mélodrame. Ceux-ci, simplistes, opposent, pourrait- on dire de façon non moins simpliste, la foi à l’orgueil de la raison.
Descartes instaure ensuite le règne de la raison, conçoit, dirait Heidegger, l’étant comme objet, ce que l’on tient pour existant, pour le dire autrement, comme ce que l’esprit conçoit et constitue selon les normes (ordre et mesure) de la Mathesis universalis. Peu à peu, le champ du rationnel s’élargit au point que la raison, dira Camus dans un langage pascalien, devient tyrannique : le réel, tout entier, est, dirait encore Heidegger, représentation. Non seulement le projet d’une science universelle s’étend à des réalités dont on considérait qu’elles échappent par principe à la rationalité : ainsi avons-nous vu comment pour Camus naissait, avec Rousseau, le rêve d’une substitution du citoyen à l’homme naturel, mais dont la nature, parce qu’elle est traversée par des pulsions, n’est pas la vraie nature, rationnelle, et d’une organisation politique entièrement fondée en raison ; ainsi Camus écrit-il du christianisme, voyant en lui l’origine du marxisme et, pourrait-on dire, de la conception moderne de la nature : « Par la notion d’historicité, il est judaïque et se retrouvera dans l’idéalisme allemand. On aperçoit mieux cette coupure en soulignant l’hostilité des pensées historiques à l’égard de la nature considérée par elles comme un objet, non de contemplation, mais de transformation » (II 595) ; mais il modifie la face du monde, par la technicisation de la nature, l’empire bureaucratique, les idéologies meurtrières dont les partisans, révolutionnaires, insèrent, de force, une idée dans le monde, et la réalité humaine. La croyance dans la raison rationaliste coïncide ainsi avec un rétrécissement de la sensibilité humaine : l’homme, la nature sont objectivés ; l’homme, la nature sont pour l’homme un objet à maîtriser. L’on songe évidemment, lisant ces considérations, lisant aussi que la politique n’a point à nous fournir un catéchisme de morale, à Pascal soulignant les deux tyrannies, celle du dévot, celle de l’homme d’esprit : « Exclure la raison. N’admettre que la raison » (P 183) et à ses considérations sur la valeur relative de la politique, dans les Discours sur la condition des grands.
L’on comprend, dès lors, que l’interprétation que donne Camus de cette période, moderne, puisse paraître, de même que son concept de nihilisme, contradictoire. Dans L’Homme Révolté, il la décrit comme nihiliste, mais, le lisant, l’on comprend qu’elle l’est tantôt parce que des valeurs absolues sont affirmées au détriment de la vie, et l’on pense à Nietzsche, tantôt parce que ces valeurs absolues sont niées au nom de la vie. De même, ici, le lecteur peut se demander « où l’on en est » : si l’époque moderne est celle la rationalité, si le tragique tient au conflit entre un sacré qui disparaît et un individu et une puissance de réflexion rationnelle qui s’affirment, comment l’âge où écrit Camus peut-il être tragique ? Ce paradoxe tient, on le voit, à la nature de la rationalité moderne. La raison, générant une nouvelle forme de tyrannie, niant ce qui n’est pas elle, n’est plus raisonnable, mais délirante.
Dans La Chute, que l’on peut lire à la fois comme l’histoire de tel homme moderne et comme celle de la modernité elle-même, Camus décrit l’ambition moderne comme un véritable péché d’orgueil. Camus se réfère au récit biblique de la faute originelle : alors qu’il passe sur le Pont-Royal, Clamence voit une jeune femme se suicider ; il ne fait rien. Plus tard, il revient sur ce pont et entend un « bon rire, naturel, presque amical, qui remettait les choses en place » (I 1493), dit Camus. Passage qui, peut renvoyer, selon nous, pour Camus, grand lecteur d’Augustin, de Pascal, à certaines interprétations du texte de la Genèse. Dans le passage très mystérieux où, après le péché originel, Dieu dit aux pécheurs, désormais mortels, que, conformément à la promesse de Satan, ils sont désormais leur égaux, Saint Chrysostome, dans sa dix-huitième homélie, décèle ainsi quelque chose comme une pique. Camus, qui n’a cessé de s’interroger sur le silence et sur l’indifférence de Dieu a peut-être été sensible, lisant la onzième lettre des Provinciales, à la justification donnée par Pascal de l’usage de qu’il fait de l’ironie touchant des questions aussi importantes que celle de la grâce et du péché.
Camus décrit ainsi, reprenant un modèle théologique, la faute de la modernité, le péché originel du penseur s’étant isolé à Amsterdam pour y concevoir le projet de la mathesis universalis. Ce péché est bien, pour Camus, un péché d’orgueil. « La nature, dit-il quelque part, c’est ce qui ne se maîtrise pas », ce qui, à la façon de la sexualité qui la symbolise ici échappe à la représentation et aux mensonges de Clamence. C’est le réel, événementiel, irréversible, immaîtrisable, qui, seul, permet de quitter cette perspective ludique sur le monde qui, selon Camus, caractérise Clamence, mais aussi, dès Le Mythe, la raison, lorsqu’elle se détache du réel. Si l’on considère l’état de la civilisation européenne, au moment où Camus écrit, il semble que la nature, ce sont surtout les deux événements historiques qui ont détruit l’Europe. L’orgueil européen a conduit aux deux guerres mondiales, comme l’orgueil de Clamence l’a conduit à ses deux chutes.
© Gabriel Arzounian
Vous pouvez retrouver la première partie de ce cycle d’études en cliquant ICI.
Bibliographie sur Albert Camus :
Laurent Bove, Albert Camus. De la transfiguration – Pour une expérimentation vitale de l’immanence, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014
Arnaud Cobric, Camus et l’homme sans Dieu, Paris, Cerf, 2007
François Chavanes, Albert Camus: «il faut vivre maintenant», Paris, Éditions du cerf, 1990
André Comte Sponville, « L’Absurde dans Le Mythe de Sisyphe», in Albert Camus et la philosophie, études recueillies et présentées par Anne-Marie Amiot et Jean-François Mattéi, Paris, Presse Universitaire de France, 1997, pp. 159-171.
Bernard East, Albert Camus ou l’homme à la recherche d’une morale, Paris, Éditions du Cerf, 1984
Roger Grenier, Albert Camus, soleil et ombre, Folio, 1991
Joseph Hermet, Albert Camus et le christianisme l’espérance en procès, Paris, Beauchesne essais,
Jacqueline Levi-Valensi, La Peste d’Albert Camus, Paris, Foliothèque, 2008
Jacqueline Levi-Valensi, La Chute d’Albert Camus, Paris, Foliothèque, 2008
Olivier Massé, « Albert Camus et l’art de philosopher », Mémoire de philosophie, sous la direction de Louis-André Dorion, Université de Montréal, 2016
Marcel Mélançon, Albert Camus, analyse de sa pensée, Fribourg, Éditions Universitaires de Fribourg, 1976
Michel Onfray, L’Ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus, Flammarion, 2012
Jean-François Payette et Lawrence Olivier (dir.) Camus – Nouveaux regards sur sa vie et son oeuvres, Québec, Presses de l’université du Québec, 2007
Bernard Pingaud, L’Étranger d’Albert Camus, Paris, Foliothèque, 2005
Paul Ricoeur, « L’homme révolté », in Lectures 2, La contrée des philosophes (La couleur des idées), Paris, éd. du Seuil, 1992
Denis Salas, Albert Camus. La juste révolte, Paris, éditions Michalon, Coll. Le bien commun, 2002
Jean-Paul Sartre, Situations I, Paris, Gallimard, 1947
Olivier Todd, Albert Camus, Folio, 1999
Pingback: La philosophie d’Albert Camus | « Le mythe de Sisyphe » et l’éthique de l’absurde (1) | Un Philosophe