
Paul Nadar, Stéphane Mallarmé au châle, photographie, 1895
© YVAN BOURHIS
Introduction
Pour introduire très largement mon propos*, je dirais qu’il s’agit de contribuer à la question de savoir quels sont la situation et le rôle de la poésie, voire de la littérature, à notre époque. A notre époque, c’est-à-dire à « l’époque de la technique », si on veut le dire avec Heidegger, du « capitalisme industriel et financiarisé », si l’on préfère la tradition marxiste, ou encore, époque du « culturel », si on le dit avec Michel Deguy. Très succinctement : notre époque (est-ce encore une « époque » à proprement parler ?) serait l’époque qui voit se confondre l’être et la valeur. Or, qu’en est-il de la poésie à cette époque ? Qu’en est-il de la poésie à l’époque du culturel ? Qu’en est-il de la poésie à cette époque où les peuples mêmes sont sommés de se produire eux-mêmes comme entités et valeurs culturelles ? Cette question est si vieille aujourd’hui qu’elle peut paraître complètement désuète et dénuée d’intérêt. Ce n’est pourtant pas le genre de « question » que l’on règle une fois pour toutes, comme on règle, justement, un problème technique ou administrativo-culturel. Mon propos consistera moins à y répondre (ce qui est toujours une autre manière de régler l’affaire) qu’à renouer avec elle, elle qui exige moins une résolution qu’une élaboration répétée et aussi singulière et responsable que possible.
Il faut partir de ce fait que la poésie s’est retirée il y a longtemps du débat contemporain sur l’état général du monde. On ne la convoque plus dans l’espace public. Elle n’aurait plus son mot à dire, le dernier mot étant attendu de la techno-science (qui comprend la politique faite « science-po. ») et de l’économie, qu’on ne qualifie même plus de politique. Ce retrait de la poésie est en somme contemporain de ce que Deguy appellait le « déluge culturel ». La question se poserait alors de savoir comment remettre la poésie dans l’espace public, comment la rendre à l’espace public1. Sans bien sûr trancher la question de savoir si cela est possible, je chercherai à montrer ici, à travers une lecture de Mallarmé essentiellement informée par « La Double séance » de Derrida2, que le retrait de la poésie est contemporain de l’ouverture même de ce qu’on appelle l’espace public, et qu’en ce sens la détermination de ce retrait met en jeu la démocratie elle-même ou, pour le dire par ce qui en est peut-être, symptomatiquement, une métonymie : la « laïcité ».
C’est dans l’horizon de cette question que je parlerai aujourd’hui de Mallarmé, qui me semble en effet être l’un des premiers poètes à prendre acte du nécessaire retrait de la poésie à « l’ère de la technique ». Ce qui m’intéresse ultimement, ce sont les conséquences qu’il tire, pour la poésie elle-même, de ce retrait de la poésie, retrait qui annonce, dans les ruines du Livre, un étrange Texte général et sans auteur, qui ressemble à ce qu’on nomme aujourd’hui, en français, par ce nom propre d’Internet3. Mais cela m’oblige à un long parcours dans un certain nombre de textes de Mallarmé, bien que, malheureusement, je n’aurai pas le temps aujourd’hui d’arriver au terme de ce parcours.
Cette époque de retrait de la poésie s’inscrit dans son œuvre sous le nom, par exemple, d’« interrègne ». Le mot se trouve dans la lettre autobiographique envoyée à Verlaine en 1885 :
« Au fond je considère l’époque contemporaine comme un interrègne pour le poète, qui n’a point à s’y mêler : elle est trop en désuétude et en effervescence préparatoire, pour qu’il ait autre chose à faire qu’à travailler avec mystère en vue de plus tard ou de jamais et de temps en temps à envoyer aux vivants sa carte de visite, stances ou sonnet, pour n’être point lapidé d’eux, s’ils le soupçonnaient de savoir qu’ils n’ont pas lieu. »
Retrait ne signifie pas abdication de la poésie, mais tout au moins la recherche d’un autre rôle pour le poète que celui de donner forme sensible à l’idée ou de fonder un peuple par le mythos (ce que Mallarmé nomme « la Légende »). Ni réduplication sensible d’un orthos logos, d’un discours droit et vrai, ni mythos, la poésie concernera « ce milieu, pur, de fiction ». Si la tâche du poète n’est plus de présenter sensiblement l’Idée insensible (et à ce titre il faudra se demander ce qu’est l’idée parfois majusculée chez Mallarmé), ni de fonder mythologiquement un peuple (ce que nous verrons avec la réponse mallarméenne au « défi » wagnérien), cette tâche consisterait-elle à dissimuler le lien privilégié du poète à l’absolu, pour le conserver en le soustrayant à l’époque qui le nie ? La tâche du poète revient-elle en somme, comme semblent le penser chacun à leur manière Rancière et Meillassoux4, de dissimuler pour la transmettre à une foule à venir la possibilité de présenter l’absolu ? Ou est-ce autre chose ? Cette tâche est-elle définitivement perdue ? Mais la présentation de l’absolu a-t-elle jamais eu lieu ? L’« interrègne » dont parle Mallarmé signifie-t-il que le poète se situe entre deux règnes, l’un passé et l’autre futur, ou signifie-t-il que l’époque situe le règne du poète entre, précisément dans l’entre ? Et qu’est-ce que le « règne » du poète ? Là où il se situe en tous cas, il n’a rien d’autre à faire qu’à « travailler avec mystère en vue de plus tard ou de jamais ». Et lui qui sait que les vivants n’ont pas lieu, il doit leur envoyer de temps en temps des poèmes qui sont comme sa carte de visite. Il le doit pour survivre, car les vivants le lapideraient s’ils le soupçonnaient seulement de savoir qu’ils n’ont pas lieu. Autrement dit, le poète écrit des poèmes et les envoie aux vivants pour leur donner le change, pour les inviter à lui rendre visite, et ainsi leur permettre de le situer5, lui qui n’est en fait pas vivant et qui sait depuis cette non-vie que les vivants n’ont pas lieu. S’il y a un règne du poète, c’est parce que le poète se situe au lieu de l’avoir lieu en général. Et si ce règne est un interrègne, on peut penser que c’est parce que le poète, non-vivant mais pas mort non plus, se situe entre les vivants. Entre les vivants, et non au-dessus d’eux, ce qui reste à comprendre et à déterminer.
*
1) Divaguer – dans les ruines du Livre :
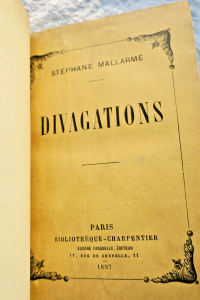
Stéphane Mallarmé, « Divagations » (Ed. Fasquelle, 1897. n°5)
Comme je vais essentiellement m’intéresser à présent aux Divagations, ce livre publié en 1897, c’est-à-dire un an avant la mort de Mallarmé, et réunissant divers textes écrits en l’espace de presque 40 ans, la question se pose de savoir quel est le statut de ces textes. S’agit-il à proprement parler de poèmes ? Peut-on alors parler de poèmes en prose ? Ou s’agit-il de textes critiques ? Poèmes ou critiques, prose ou vers ? Est-ce que ce sont, comme Mallarmé le disait à Verlaine, de simples « cartes de visite » envoyées aux vivants pour leur donner le change ? On le verra rapidement, ces termes, comme celui de « livre », sont mis en abîme dans le livre lui-même.
Voyons d’abord ce que dit l’avertissement : « Un livre comme je ne les aime pas, ceux épars et privés d’architecture. » La question se pose pourtant de savoir ce qui permet l’assemblage à « travers tout ce hasard » : « L’excuse, à travers tout ce hasard, que l’assemblage s’aida, seul, par une vertu commune ». On pourrait déjà voir s’annoncer ici les motifs du Livre (L majuscule) et de la foule. Ce livre, les Divagations, accusé par l’auteur lui-même de « journalisme » en ce qu’il est privé d’architecture, trouve une excuse, se défait de l’accusation du fait que son assemblage aurait lieu « par une vertu commune ». Quelle est cette « vertu commune » qui payerait la dette du livre au Livre ? Si l’assemblage « s’aida, seul », cela signifie que cette vertu commune aux différents textes ne provient pas de l’auteur. Elle ne trouve pas sa source en l’auteur qui, justement, ne propose pas ici un livre à proprement parler, un livre avec une architecture clairement définie. Cette « vertu commune » aux différents textes doit provenir des textes eux-mêmes, de leur textualité, ou tout au moins d’une certaine vertu de cette textualité6. Après quoi les Divagations sont qualifiées d’« apparentes », et Mallarmé indique qu’elles « traitent un sujet, de pensée, unique ». Quel est donc ce sujet unique ? Quel est donc ce sujet qui peut tout aussi bien être unique en tant qu’il est « de pensée » ? Peut-on se contenter de dire que le sujet du livre est la place du poète dans la cité (ce qu’indique Bertrand Marchal dans sa présentation des Divagations) ? Ce ne serait pas faux, mais on manquerait la profondeur de ces Divagations en ne voyant pas que cette place du poète dans la cité engage des questions aussi difficiles que celles du rapport entre le poète et le langage, le langage et la langue, le livre et la foule ou l’histoire, le poète et le livre, etc… Ce sujet est-il factuel, est-il exposable comme tel, suffit-il de le reporter dans un livre ? Le sujet du livre, de ce livre que sont tout de même finalement les Divagations, ne serait-il pas la place du livre même dans l’espace de la cité ? Mais le livre a-t-il un espace ? Et le texte, et le langage ? Et, dès lors, où est l’auteur ? Après un tiret (et il faut toujours porter attention aux tirets chez Mallarmé), il écrit : « si je les revois en étranger [ces divagations], comme un cloître quoique brisé, exhalerait au promeneur, sa doctrine. »
Ces divagations traitent donc d’un sujet, de pensée, unique, mais seulement pour celui qui les voit en étranger, pour le lecteur qui s’y trouve comme il se promène dans des ruines ou pour l’auteur qui, les recueillant, les relit et les réécrit après coup. Le sujet est unique en tant qu’il est « de pensée ». Reste à savoir ce que cela veut dire. On verra qu’il ne s’agit pas d’un sujet simplement localisable en dehors du livre ou du texte, ni d’un sujet qu’il s’agirait de présenter négativement, comme si l’ensemble des textes en dessinaient les contours externes. Le sujet unique des Divagations est en quelque sorte le livre lui-même. Mais plus précisément, ce que Mallarmé appelle « l’écrit ». Dès lors ce sujet, bien qu’il soit « de pensée », est aussi bien là, sous nos yeux, comme ce support plié en son dedans. On ne peut certainement pas nommer le sujet des Divagations, unique pourtant et « de pensée ». En effet, même si ce sujet unique pourrait être en creux ce que Mallarmé a appelé le Livre, on peut faire l’hypothèse que la publication des Divagations, ce livre comme l’auteur ne les aime pas, correspond à son abandon. Du moins les textes réunis ici sont-ils écrits dans ces moments où le poète, ou plutôt le « littérateur » est « oublieux qu’entre lui et l’époque dure une incompatibilité » (Crayonné au théâtre). Ce qui vaut ici pour le théâtre vaut pour le reste, car si les Divagationstournent autour du livre ou de l’écrit, elles concernent tout autant un certain théâtre. Pourquoi le poète qui projette le Livre perd-il son temps à lire les faits divers ou à aller au théâtre ? Si l’essentiel est le Livre, pourquoi perd-il son temps dans la ville, dans la rue, hors de chez lui et loin de la page ?
Voici ce qu’écrit Mallarmé dans Crayonné au théâtre :
« Pourquoi ! Autrement qu’à l’instigation du pas réductible démon de la Perversité que je résume ainsi ‘faire ce qu’il ne faut, sans avantage à tirer, que la gêne vis-à-vis de produits (à quoi l’on est, par nature, étranger) en feignant y porter un jugement : alors qu’un joint quant à l’appréciation échappe ou que s’oppose une pudeur à l’exposition, sous un jour faux, de suprêmes et intempestifs principes’ ».
Je reviendrai à la Perversité de ce démon, en lequel j’aimerais qu’on entende d’emblée le vers, voire le verse anglais, et à ce « joint quant à l’appréciation », qui échappe. Mais d’abord, quel est ce Livre (avec un L majuscule) que projette Mallarmé ?
Entre parenthèses : le Livre
En 1885, Verlaine demande à Mallarmé des renseignements autobiographiques pour une notice à paraître intitulée Les Hommes d’aujourd’hui, ainsi que pour la seconde série des Poètes Maudits. Je reviens à cette lettre que j’ai déjà mentionné en introduction. Mallarmé envoie donc une Lettre autobiographique à Verlaine, qui sera publiée quasiment telle quelle. Cette lettre est restée célèbre parce que Mallarmé y mentionne « le Livre » justement. Après avoir donné très rapidement les raisons pour lesquelles il lui a fallu devenir professeur d’Anglais, cette langue dont on aura à reparler et qu’il n’aurait d’abord appris que pour « mieux lire Poe », Mallarmé en vient à dire pourquoi il ne regrette pas cette profession (entre les lignes, il dit aussi pourquoi il ne regrette pas son mariage, ce mariage, cet hymen qui l’aurait obligé à gagner son pain). En quoi donc Mallarmé croit-il avoir « bien fait » de devenir un simple professeur d’Anglais, de province qui plus est ? La question se pose, d’autant que s’il croit certes avoir bien fait, il ajoute qu’il le croit « avec tristesse ». Pourquoi, vingt ans après s’être engagé dans la carrière de professeur d’Anglais « et malgré la perte de tant d’heures » comme il le dit, reste-t-il sans regrets ? C’est alors que Mallarmé mentionne « le Livre ». S’il croit avoir bien fait de devenir simple professeur d’Anglais, c’est parce qu’il a, dit-il, « toujours rêvé et tenté autre chose, avec une patience d’alchimiste, prêt à y sacrifier toute vanité et toute satisfaction ». Ainsi, c’est à ce « rêve d’autre chose » (nous ne laisserons pas trop longtemps dans le vague ce mot de rêve) que Mallarmé aurait sacrifié les satisfactions de la vie, et c’est grâce à ce rêve qu’il peut croire avoir bien fait de se contenter d’une vie modeste. Mais quelle est cette autre chose qu’il dit avoir toujours rêvé et tenté ? « C’est difficile à dire, écrit-il : un livre, tout bonnement, en maints tomes, un livre qui soit un livre, architectural et prémédité, et non un recueil des inspirations de hazard, fussent-elles merveilleuses… » Cette autre chose à laquelle il aurait sacrifié toute vanité et toute satisfaction, ce serait « tout bonnement » un livre. Un livre cependant et non un album, c’est-à-dire un livre architectural et dont l’assemblage soit prémédité. Mais Mallarmé va plus loin. Ce qu’il a toujours tenté, c’est « le Livre persuadé qu’au fond il n’y en a qu’un, tenté à son insu par quiconque a écrit, même les Génies. » Je tiens ici à prendre le temps de clarifier ce qui, pour tant de commentateurs, semble aller de soi. Tout d’abord, le Livre, qui doit bien être un livre, doit être plus qu’un livre. Il doit être le livre des livres, non pas au sens où il devrait recueillir et systématiser l’ensemble des livres publiés, le « catalogue des catalogues » comme dirait Borges, mais au sens où il devrait être le livre « tenté à son insu par quiconque a écrit », livre à l’horizon duquel, pourrait-on dire, tous les livres ont été écrit, à l’insu même de leur auteur. Autrement dit, l’écriture d’un livre est toujours, « avant » ou en-deçà de la conscience de l’auteur qui écrit, tentative du Livre. Dès lors, Mallarmé avoue seulement dans cette lettre qu’il a toujours tenté ce que les autres ont également tenté ; la différence est qu’il tente de manière « préméditée » ce que d’autres ont tenté de manière « insue ».
Cette différence est importante car c’est en elle que se marque l’impossibilité radicale du Livre. Ce Livre étant unique et tenté par tout écrivain, fût-ce à son insu, il doit être tenté, comme je l’ai dit, depuis un « avant » ou un en-deçà de la conscience, voire un en-deçà de l’Ego de l’auteur. Plus loin dans la lettre, Mallarmé indique que son « travail personnel » sur le Livre « sera anonyme, le Texte y parlant de lui-même et sans voix d’auteur ». C’est dire que le nom même de « Mallarmé » apparaît comme le lieu d’un paradoxe : être l’auteur qui tente consciemment l’écriture du Livre, de ce livre unique tenté par tous inconsciemment, c’est travailler à un livre anonyme qui laisserait le Texte parler de lui-même. La conscience de la tentative exige l’anonymat, l’inconscience de la tentative permet le nom d’auteur, adjoint au Texte une voix d’auteur qui passe pour son origine, détache un livre particulier du Livre unique tenté et en signe l’échec. Paradoxe : moi Mallarmé, je rêve et je tente d’accomplir consciemment ce que d’autres ont tenté inconsciemment ; ainsi j’ai conscience que c’est inconsciemment, donc que ce n’est pas moi Mallarmé, qui rêve et tente d’accomplir le Livre. Voilà pourquoi réussir à « faire cet ouvrage dans son ensemble » est impossible. Voilà pourquoi le Livre est un rêve. Mallarmé le dit : « il faudrait être je ne sais qui pour cela ! » Pour le dire avec Lacoue-Labarthe, il ne s’agit de rien de moins, avec le Livre, que de parvenir à présenter purement le langage lui-même comme condition de toute présentation7. A cette remarque de Lacoue-Labarthe, il faut ajouter, cette fois avec Derrida, que le langage en tant que conditon de toute présentation est essentiellement débordement du syntaxique sur le sémantique8. Voilà pourquoi le Livre mallarméen devrait, en toute rigueur, présenter le Type universel vide, l’inscription, la frappe ou l’Acte pur articulant aucun sens mais ouvrant la possibilité même d’exposer les conditions de possibilité9.
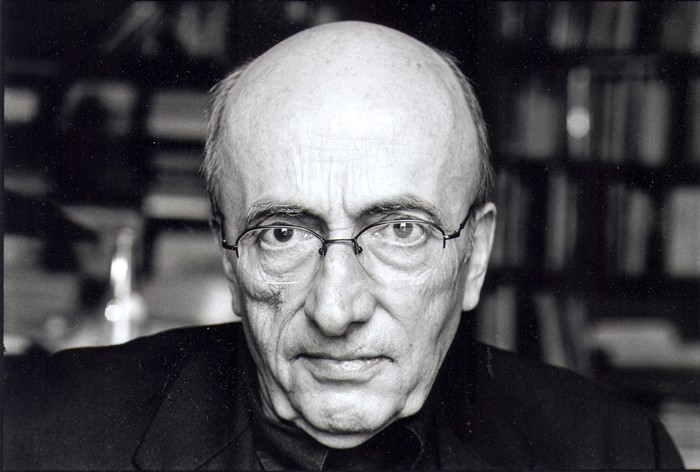
Philippe Lacoue-Labarthe (Crédits : Mathieu-Bourgois)
Si le Livre dans son ensemble est impossible, Mallarmé se propose du moins, en 1885, d’« en montrer un fragment d’exécuté », d’« en faire scintiller par une place l’authenticité glorieuse, en indiquant le reste auquel ne suffit pas une vie ». Mallarmé explique ainsi son but : « Prouver par les portions faites que ce livre existe, et que j’ai connu ce que je n’aurai pu accomplir. » Indiquer le reste. Autrement dit, qu’il a connu ce rêve ou cette tentative inconsciente de tout écrivain. Il s’agit donc, par l’accomplissement d’un fragment et semble-t-il de manière négative, de « prouver » que le Livre existe, même s’il n’est pas accompli. Cela est écrit en 1885, et toute la question est de savoir si Mallarmé, ce « non-vivant » alors au plus proche de sa mort, a abandonné ou non ce projet du Livre : pour certains, comme Meillassoux, Mallarmé n’a jamais abandonné ce projet, et le Coup de dés apparaît dès lors comme le « fragment d’éxécuté » qui prouverait que le Livre existe, tandis que pour d’autres, comme Milner, Mallarmé aurait pris acte de l’impossibilité radicale du Livre, ce dont témoignerait les Notes pour le Livre10. Ce qui est en jeu avec cette question, c’est la possibilité ou l’impossibilité de présenter l’absolu, le Livre étant le nom mallarméen de l’absolu littéraire, la présentation du pur Acte ou du Type universel, la production du principe même de toute production, la poiesis du poiein. Il y va ainsi du rôle et de l’importance de la littérature. L’ambition de Mallarmé est clairement de proposer un nouveau culte, fondé sur le Livre et capable de pallier l’insuffisance du « culte laïque ». Rien ici ne va cependant de soi, et tout se passe au plus proche du romantisme, ou plutôt entre deux romantismes, voire entre le romantisme et lui-même.
La Poésie, l’hymen
Que pour Mallarmé ce soit aux Lettres, et plus précisément à la Poésie, que revienne la tâche de présenter le langage lui-même comme condition de toute présentation, cela ne fait aucun doute. Mais de ce fait, tout le problème, qui ouvrira notamment l’agôn avec Wagner, sera de comprendre si et comment la poésie peut « présenter » le Type universel alors qu’elle a lieu dans une langue nationale (ou plutôt, pour utiliser le terme de Mallarmé, dans les mots d’une « tribu »). Pourquoi en effet est-ce à la Poésie, et non par exemple à la Musique, à la Prose philosophique ou au langage formel mathématique, que revient la tâche de présenter la condition de toute présentation ? Pourquoi revient-il à la Poésie de présenter le langage lui-même comme condition de l’apparaître ? En un mot : d’abord parce que la Poésie n’est rien, ou est entre. Entre la Musique et la Prose, la Poésie se retire pour marquer les intervalles, pour faire et défaire le lien entre l’une et l’autre. La Poésie, en retrait, toujours entre, serait tympan ou hymen : à la fois membrane séparant les deux termes, page blanche protégeant la Musique de la Prose et la Prose de la Musique, et leur mélange, l’inscription espaçante de leur mise en rapport, ou leur « théâtre ». Elle a lieu dans l’excès du syntaxique sur le sémantique, pour ainsi dire entre le syntaxique et le sémantique. Mais alors, en quoi la Poésie, si elle est retirée, entre, en quoi peut-elle prétendre présenter le langage même ou le Type pur ?
Il faut certainement penser, ici, que la Poésie n’est pas entre comme le serait un troisième terme. Pas simplement. Elle est entre en tant que retrait espaçant, en tant que milieu ou medium. C’est le sens de l’hymen, du tympan, de la page blanche, et s’il y a une angoisse qui apparaît en face de ces membranes, c’est parce que, n’ayant pas de lieu propre, on ne se trouve jamais en fait en face d’elles. Et pourtant, la poésie n’ouvre pas tant un pur espace vide qu’elle n’espace en inscrivant l’un des termes en l’autre aussi bien qu’en elle, et aussi bien en elle comme autre terme. Sauf qu’elle s’inscrit elle-même en elle-même, comme le mime. La poésie a lieu comme re-marque, ce qui signifie que si elle se « retire » comme je l’ai dit, c’est du fait de sa re-marque, par surcroît. Débordant ce qu’elle re-marque, elle ne devient pourtant pas un troisième terme. Elle déborde sans indétermination, sans se déliter dans la confusion de l’infini, mais en re-marquant ce qu’elle déborde, c’est-à-dire en en soulignant exactement les bords. Comme interface pleine, et y faisant le rien qui produit des vagues et sur lesquelles on surfe (« Cette écume, vierge vers, à ne désigner que la coupe… »).
Ce qui m’intéresse donc ici, c’est la manière dont la re-marque mallarméenne se détermine en déterminant ce qu’elle re-marque. Comment la Poésie sépare-t-elle Musique et Prose tout en les inscrivant en elle pour les rapporter l’une à l’autre ? Comment, à partir de là, fait-elle de même avec l’Esthétique et l’Economie politique ? Et si cette position de la « Poésie » ne se limite pas à une pétition de principe, en quoi son opération est-elle non seulement théorique, mais pratique ? (Ici, il faudrait relire ce que dit Mallarmé du commerce des livres). Représente-t-elle encore quelque chose ? Que fait-elle ? Et ainsi, peut-elle encore prétendre à l’universalité ? En quel sens ? Tout cela suppose sans doute, sinon l’abandon du rêve du Livre, du moins l’impossibilité de son accomplissement comme culte et sa dissémination comme Texte. C’est-à-dire son accomplissement comme rêve même. La dissémination du « rêve » du Livre, qui est la dissémination du désir même en tant que désir de lier le jeu du langage ou de le river à la présentation de sa loi, fait d’emblée des livres tels que les Divagations, « ceux épars et privés d’architecture », des ruines du Livre. Ces ruines seraient ainsi les ruines d’un édifice jamais construit, d’un édifice rêvé qui présenterait la loi du langage. Mon hypothèse est qu’en publiant les Divagations, Mallarmé reconnaîtrait que l’édifice du Livre est impossible, ruiné d’avance par la loi de toute présentation ou de toute production. C’est reconnaître que la présentation du langage lui-même ou de sa loi est elle-même soumise, en acte, à la loi du langage comme de l’avoir lieu. Autrement dit, on ne peut présenter le langage que comme ruines du « rêve » ou du désir d’en lier le jeu, et on ne peut en présenter la loi qu’en en laissant s’inscrire l’opération ruineuse, comme divagations ou recueil et remarque des « inspirations de hazard ». Il faut donc relire Mallarmé.
*
2) Mallarmé contre Wagner
Le 8 août 1885, près de quatre mois avant l’envoi de la lettre autobiographique à Verlaine, Mallarmé publie dans la Revue wagnérienne un texte intitulé Richard Wagner, rêverie d’un poète français. Mallarmé présente ce texte au fondateur de la revue comme une « étude », « moitié article, moitié poème en prose », précisant que le travail est difficile dans la mesure où il n’a « jamais rien vu » de Wagner. Mallarmé n’a rien vude Wagner, mais il l’a lu, et donc entendu. Mallarmé lit la musique. Comme dans la plupart des textes publiés dans les Divagations, la version originale est relue et réécrite. Dans ce texte, Mallarmé s’explique avec Wagner, et à travers Wagner commence à exposer le rapport de la Poésie et de la Musique.

Richard Wagner (photographie : Franz Hanfstaengl, Munich, 1871)
Wagner en effet « inflige » un « singulier défi aux poètes dont il usurpe le devoir avec la plus candide et splendide bravoure. » Mallarmé se présente comme « un poète français contemporain » ou un « amateur » « exclu de toute participation aux déploiements de beauté officiels ». S’il est exclu, c’est parce que sa pratique est « l’affinement mystérieux du vers pour de solitaires Fêtes », et c’est cette pratique qui lui permet d’aimer à réfléchir au « pompes souveraines de la Poésie ». Ces pompes souveraines de la Poésie, ces déploiements de beauté officiels que le poète à l’écart peut « réfléchir », c’est-à-dire re-marquer et écarter d’elles-mêmes par l’affinement du vers, sont des « cérémonies d’un jour qui gît au sein, inconscient, de la foule : presque un Culte ! » Essayons de condenser toutes les possibilités ouvertes par la syntaxe de cette phrase : ces cérémonies, dont on peut entendre qu’elles sont passagères (des « cérémonies d’un jour »), surgissent d’un jour qui peut être lui-même inconscient, mais qui peut tout aussi bien être conscient et déterminable, réductible à une époque, en tant qu’il trouve son lieu dans le sein inconscient de la foule. On peut comprendre que c’est l’inconscient de la foule qui donne lieu au jour, fugace, déterminé, fini, de ces cérémonies auxquelles chacun prend part. Ainsi, chacun prendrait part à ces déploiements de beauté officiels depuis l’ouverture de ce jour en lequel elles ont lieu, depuis l’inconscient de la foule. C’est depuis l’inconscient de la foule et comme son rêve qu’auraient lieu ces cérémonies de beauté officielles, ces pompes souveraines de la Poésie, qui sont « presque un Culte ! ». Si l’on fait droit à l’ironie de Mallarmé, il faut entendre que ces pompes souveraines, provenant de la foule, sont presque incultes ! Mais c’est aussi parce qu’elles proviennent du sein inconscient de la foule qu’elles sont, « presque », un Culte. Presque.
Le poète a la certitude que « lui ni personne de ce temps » n’est impliqué dans ce quasi-culte. Que ces cérémonies aient lieu depuis l’inconscient de la foule, mais que personne de ce temps n’y soit impliqué, voilà ce qui fait qu’elles ne sont pas tout à fait un culte, mais presque. Tout se jouerait dans l’écart entre l’inconscient de la foule et l’implication de chacun, entre tous et personne. Personne de ce temps n’est impliqué dans ce qui dès lors n’est qu’un quasi-culte, mais le poète, lui, en a la certitude. C’est cette certitude qui « l’affranchit de toute restriction apportée à son rêve par le sentiment d’une impéritie ou par l’écart des faits ». Le poète à l’écart du quasi-culte, ayant la certitude que personne pas plus que lui n’y est impliqué, mais que tous inconsciemment le rendent possible, voit son « rêve » (et il s’agit là d’une « rêverie ») affranchit des restrictions que lui impose l’exigence de représentation exacte ou la vérité comme adéquation. La rêverie du poète est libre en ceci que le poète se situe en-deçà de l’expérience, entre l’inconscient de tous et l’implication de personne, entre un certain désir de religion et l’inefficacité de son institution. Que la rêverie du poète soit libre, cela veut-il dire qu’elle est irresponsable ou arbitraire ? Non, car « sa vue d’une droiture introublée se jette au loin », passant les cérémonies d’un jour, excédant les déploiements de beauté officiels. N’oublions pas que le poète pratique l’affinement mystérieux du vers pour de solitaires Fêtes, ce qui ne signifie pas nécessairement, sur le mode psycho-biographique, ses seules fêtes à lui, intérieures. Entre le rêve inconscient de la foule et l’exclusion de chacun de la Fête officielle, le poète peut rêver librement, c’est-à-dire jeter au loin sa vue d’une droiture introublée. C’est que la rêverie du poète n’est pas hasardeuse, arbitraire. Elle a lieu dans, avec et selon le mouvement ou la loi du langage, selon l’espacement de l’écriture. (Pour le dire avec Blanchot et entre parenthèses, Mallarmé reconnaît au moment d’Igitur – dont le projet date de 1869 – que le seul acte littéraire serait, à la limite, le suicide ; en se suicidant littérairement avec Igitur, c’est-à-dire en se tuant dans un mime de suicide, tuant son Ego qui est aussi le démon de son impuissance, Mallarmé s’ouvre alors à « la pure passivité du langage »11. C’est ainsi qu’il faut comprendre chez Mallarmé tous ces mots qui assument une connotation de vague, de distraction, de laisser-aller voire de lassitude.) Rêvant selon la loi du langage, le poète « accepte pour exploit de considérer, seul, dans l’orgueilleux repli des conséquences, le Monstre-Qui ne peut Être ! » Qu’est-ce que ce Monstre qui ne peut être, et qui par conséquent ne peut être simplement désigné ? Encore une fois, la syntaxe rend la phrase indécidable : le poète se mêle sans se confondre à ce « Monstre-Qui ne peut Être ». Il s’y mêle dans l’orgueilleux repli des conséquences. En effet, est-ce le Monstre qui se loge dans ce repli, ou est-ce le poète ? Le poète qui n’est plus tout à fait son Ego, le poète-mime suicidé, et le Monstre-Qui ne peut Être, se mêlent sans se confondre entre la fatalité et le hasard, dans l’antre creusée par un surcroît de détermination où les conséquences pourtant deviennent hasardeuses, incalculables. Le poète est libre par surcroît de détermination : toute pensée est un coup de dés qui abouti à un chiffre déterminé, qui fixe l’infini, mais qui pourtant jamais n’abolira le hasard, qui trouve lieu dans le mouvement précipité de la détermination. Sa rêverie s’affranchit en remarquant, en inscrivant ce mouvement de surcroît, d’une écriture déterminée incalculablement. « Attachant au flanc la blessure d’un regard affirmatif et pur. » Le poète, de son hymen dans le repli des conséquences avec le Monstre-Qui ne peut Être (Mallarmé n’écrit pas seulement : le néant), renaît, attache au flanc la blessure d’un regard « affirmatif et pur ». Ce Monstre pourrait bien correspondre au Dieu trompeur de Descartes, ce Deceptor qui est la figure imaginaire et hyperbolique du réel en tant qu’il déçoit toute certitude, sauf celle de l’affirmation en moi du langage, plus profonde et plus solide, plus pure que la sensibilité, la raison ou le sentiment même, réfléxif, de mon existence, qu’elle noue. C’est en tant qu’affirmation supplémentaire, déterminée mais libre par surcroît, c’est-à-dire dans le repli des conséquences où se loge le hasard, que le langage attache au flanc (au flanc du poète autant qu’au Monstre, au flanc du poète monstrueusement mêlé au Monstre, poète non-vivant, hanté, fantôme) une blessure.
Il faut donc que le poète puisse « rêver », c’est-à-dire jeter son regard droit par-delà le quasi-culte officiel ouvert par l’inconscient de la foule et auquel aucun ne participe, c’est-à-dire aussi affirmer, laisser s’affirmer en soi la pure passivité du langage entre nécessité et hasard, entre la passivité et l’activité, au creux du repli des conséquences. (Problème : ce « laisser s’affirmer » la passivité est-il encore une acte ?) Or, c’est ici que la Musique et le « défi » wagnérien interviennent : le poète, « cet amateur, s’il envisage l’apport de la Musique au Théâtre faite pour en mobiliser la merveille, ne songe pas longtemps à part soi… » Envisageant l’apport de la Musique au Théâtre, c’est-à-dire à un certain régime de la représentation (j’y reviendrai), le poète ne peut songer longtemps à part soi. En somme, il se voit privé de sa « rêverie ». Pourquoi ? Parce que « déjà, de quels bonds que parte sa pensée, elle ressent la colossale approche d’une Initiation ». La pensée rêveuse du poète, cette pensée qui n’est plus la sienne mais l’affirmation en lui de la pure passivité du langage, cette pensée qui n’est même pas un acte ou un principe mais qui procède par « bonds », ressent dans la Musique la colossale approche d’une Initiation. La Musique fond sur la pensée, elle semble l’englober au point que, de quelques bonds qu’elle parte, elle se trouve déjà dans la Musique. La pensée sent s’approcher la Musique comme ce qui la précède, comme ce qui en rend possible les bonds ou la danse. Ainsi l’approche colossale de la Musique est ressentie par la pensée (Mallarmé, soigneusement, ne dit pas le poète, qui est hors-jeu) comme l’approche d’une Initiation : la Musique initierait la pensée à son propre fond. S’ensuit une phrase mystérieuse, un étrange tutoiement, comme un bond de plus « à part soi » : « Ton souhait, plutôt, vois s’il n’est pas rendu. » Tout se passe comme si, ici, Mallarmé s’adressait à lui-même, ce qui ne peut plus s’entendre au sein d’une pure intériorité. Tout se passe comme s’il s’adressait à lui-même aussi bien qu’au lecteur, et au lecteur qu’il est, nous l’avons vu. Le souhait du poète n’est-il pas, plutôt avec la Musique et plus tôt, avant l’affirmation en lui du langage, déjà « rendu » ? Que signifie rendre un souhait ? Le souhait du poète est-il rendu, comme vomi, par la Musique ? Le souhait du poète, son désir d’exposer le mouvement même du langage comme condition de toute présentation, n’est-il pas rendu au musicien ? Autrement dit, est-ce la Musique plutôt que la Poésie, qui ouvre l’espace et le temps nécessaire à l’exposition du transcendantal ? Est-ce la Musique, plutôt que la Poésie, qui est l’Art général ? La Musique est-elle l’Idée de l’art, et de la poésie, ou est-ce l’inverse ? Et par ailleurs, qu’advient-il selon ces possibilités du quasi-culte officiel ouvert par le désir de tous (« l’ouverture de gueule de la Chimère » dit aussi Mallarmé) mais vécu par personne ? C’est au moment où toutes ces questions se posent que Mallarmé évoque, non sans ironie, le défi qu’inflige Wagner aux poètes (au pluriel, la différence se marque dans le texte et c’est important) : « Singulier défi qu’aux poètes dont il usurpe le devoir avec la plus candide et splendide bravoure, inflige Richard Wagner ! »
Je voudrais à présent, faute de temps, précipiter le commentaire de ce texte. Le sentiment est complexe, dit Mallarmé, « envers cet étranger ». Wagner est nommé « étranger », et nous verrons je l’espère qu’il y va également d’une différence nationale, mais en un sens qui implique la traduction. Il faut dire ici qu’en 1869, alors que certains nationalistes tentaient d’empêcher la représentation de Lohengrin à l’opéra de Paris, Mallarmé s’est engagé publiquement pour qu’elle ait lieu. J’espère qu’à présent, déjà, on entend tout autrement une aussi simple phrase : Mallarmé s’est engagé publiquement pour que la représentation ait lieu. Mais par ailleurs, dans cette rêverie d’un poète français contemporain, la différence nationale est nettement soulignée, dès le titre, en même temps que la différence entre le nom de Richard Wagner, singulier, et l’impersonnalité plurielle des poètes auxquels il « inflige » un « singulier défi ».
Quel est le « défi » que lance Wagner aux poètes ? Et quel est ce « devoir » qu’il leur usurpe ? Pour le dire en un mot, il s’agit de remotiver la Représentation, ce qui exige de redonner vie au Théâtre. En novembre 1886, Mallarmé répond à une enquête sur le Théâtre et la littérature :
« Je crois que la Littérature, reprise à sa source qui est l’Art et la Science, nous fournira un Théâtre, dont les représentations seront le vrai culte moderne ; un Livre, explication de l’homme, suffisante à nos plus beaux rêves. Je crois tout cela écrit dans la nature de façon à ne laisser fermer les yeux qu’aux intéressés à ne rien voir. Cette œuvre existe, tout le monde l’a tentée sans le savoir ; il n’est pas un génie ou un pitre ayant prononcé une parole, qui n’en ait retrouvé un trait sans le savoir. »
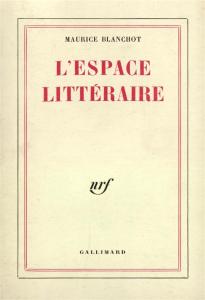
Maurice Blanchot, « L’espace littéraire » (Gallimard, juillet 1955)
Or le malaise envers Wagner vient de ceci que, certes, tout est fait pour fonder « le vrai culte moderne », mais « autrement qu’en irradiant, par un jeu direct, du principe littéraire même ». Le problème de Wagner, selon Mallarmé, est qu’il tente de fonder la religion de la modernité autrement qu’en partant du principe littéraire, c’est-à-dire du langage. Wagner surgit au temps du théâtre bourgeois, du vaudeville, théâtre de simple mimesis en lequel la Fiction « s’impose à même et tout d’un coup, commandant de croire à l’existence du personnage et de l’aventure – de croire, simplement, rien de plus. » Ce théâtre ne violente pas la raison du spectateur « aux prises avec un simulacre » ; la foule y reste « maîtresse de sa créance » (Le Genre ou les Modernes). C’est donc au temps de ce théâtre, caduc dit Mallarmé, théâtre qui ne parvient pas à se substituer à la Messe, qu’apparaît Wagner. Le théâtre bourgeois laisse vacante la place ouverte par le désir d’autre chose, ouverture de gueule de la Chimère, désir de la foule moderne qui attend son accomplissement, mais de personne ni d’aucun art en particulier. La foule moderne attend l’accomplissement de son désir sans l’imaginer elle-même, et elle se sert des arts, les consomme, attendant d’eux des effets aptes à l’entraîner. « Le Moderne dédaigne d’imaginer ; mais expert à se servir des arts, il attend que chaque l’entraîne jusqu’où éclate une puissance spéciale d’illusion, puis consent. » Traduisons : l’homme moderne, consommateur des arts, attend de chacun d’eux des effets qui l’entraîne pour consentir, sans qu’il s’y investisse, sans qu’il imagine. Les conditions étaient donc réunies pour que surgisse Wagner et le projet d’œuvre d’art totale, c’est-à-dire d’une œuvre concentrant tous les arts en tant qu’effets.
L’opération de Wagner, selon Mallarmé, consiste en une « simple adjonction orchestrale » au théâtre bourgeois : c’est l’opéra, qui « change du tout au tout, annulant son principe même, l’ancien théâtre. » En ajoutant simplement un orchestre à la scène de ce théâtre bourgeois, Wagner annule d’abord le rapport de reconnaissance immédiate qui permet au public de s’identifier à l’action. L’acte scénique, à présent « strictement allégorique », « vide et abstrait en soi, impersonnel, a besoin, pour s’ébranler avec vraisemblance, de l’emploi du vivifiant effluve qu’épand la Musique. » Ne s’offrant plus à la reconnaissance immédiate des spectateurs, composée à présent de purs types vides et abstraits en soi (c’est dire si Mallarmé prend ses distances avec la prétendue originarité ou authenticité de ces mythes !), l’acte scénique ne s’ébranle plus de soi-même avec vraisemblance, et ainsi a besoin des vertus vivifiantes de la Musique pour en quelque sorte aller chercher le public… On ne peut plus demander au spectateur de croire, simplement, que l’action a lieu, puisqu’il ne se reconnaît plus dans cette action : il faut donc que la Musique l’inonde et le rapproche par reflux de l’action scènique, que l’orchestre avait d’abord séparé, mis à distance, l’allégorisant. La Musique permet de violenter la raison du spectateur qui ne croirait pas en l’action scénique, elle ne laisse pas la foule maîtresse de sa créance. Mallarmé ajoute que la seule présence de la Musique est un triomphe, à la condition, ambigüe dans sa formulation, qu’elle « éclate la génératrice de toute vitalité ». Doit-elle être éclatante en tant que génératrice de toute vitalité ? Ou doit-elle faire éclater cette génératrice ? Et dès lors quelle est celle-ci ? Il reste que la présence de la Musique, pour être un triomphe, ne doit pas s’appliquer seulement à d’antiques conditions. La Musique est un triomphe si et seulement si elle donne l’impression d’animer, d’insuffler ou de souffler le comédien, et non si elle apparaît comme une simple adjonction à d’« antiques conditions », fût-ce comme « leur élargissement sublime ».
Or, selon Mallarmé, Wagner a bien effectué l’hymen du Drame et de la Musique, ces « deux éléments de beauté qui s’excluent et, tout au moins, l’un l’autre, s’ignorent. » Wagner a bien effectué l’hymen de ces deux éléments de beauté pourtant exclusifs l’un de l’autre, mais ce mariage reste l’union de deux notions hétérogènes, « philosophiquement » juxtaposés écrit Mallarmé. Autrement dit, si la Musique en effet « pénètre et enveloppe le Drame », ce n’est pas en accord avec son principe, qu’elle partage avec le Drame, mais « de par l’éblouissante volonté ». On pourrait dire que chez Wagner, la Musique pénètre et enveloppe le Drame sans se porter sur son bord, sur ce bord où elle se trouve en contact avec le Drame, et qui n’est autre que la Poésie ou le Texte. Wagner, par son éblouissante volonté, qu’il identifie et amplifie par la Musique, effectue certes l’hymen de la Musique et du Drame, c’est-à-dire leur confusion, mais il n’atteint pas, il ne touche pas à l’hymen qui les distingue, à l’élément de leur virginité réciproque, ou à leur principe. L’hymen de la Musique est du Drame aurait lieu chez Wagner, « sauf que son principe, à la Musique, échappe. » Wagner tente de fondre la Musique au Drame pour opérer une œuvre d’art totale rassemblant tous les arts, mais en fait n’en atteint pas le principe. Ainsi, comme le remarque Lacoue-Labarthe, le problème est qu’avec l’opéra wagnérien, il ne s’agit plus ni de Musique ni de Théâtre. Effectuant leur hymen par un harmonieux compromis, par son éblouissante volonté ou par son « génie »12, Wagner ne touche pas à leur hymen, l’hymen de l’Art. Comment dès lors ne pas entendre l’ironie de cette phrase, en laquelle Mallarmé semble doubler Wagner : « Le tact est prodige qui, sans totalement en transformer aucune, opère, sur la scène et dans la symphonie, la fusion de ces formes de plaisir disparates. »
© Jordan Wilocq
Pour retrouver la seconde partie de l’article, cliquez ICI.
Notes :
* Ce texte a été prononcé à l’ENS de Lyon en mai 2017, à l’occasion du séminaire « Vers et Prose », organisé par la revue Le Verbier
1 Deguy, La fin dans le monde, XXI « Y a t-il un poéticien dans la cabine ? »
2Voir J. Derrida, « La Double séance », in La dissémination, Editions du seuil, 1972
3En anglais comme on sait, on ne dit pas Internet, mais l’internet (the internet). On désigne ainsi un élément, un medium, plus qu’une entité. En français cependant, l’usage est double : on parle d’Internet dans l’usage familier de la langue, mais « de l’internet » dès qu’il s’agit d’un usage plus soutenu, dans des articles scientifiques, voire dans la presse.
4Voir Jacques Rancière, Mallarmé, la politique de la sirène, Hachette Littérature, « Coup double », Paris 1997, et Quentin Meillassoux, Le Nombre et la sirène, Un déchiffrage du Coup de dés de Mallarmé, Fayard, « Ouvertures », 2011.
5Qu’en est-il du rapport entre – inter – le latin et la rue de Rome ? Rue de Rome où Mallarmé s’installe en 1875 et où il invitera à lui rendre visite chaque mardi, à partir de 1883, des artistes comme Paul Claudel, André Gide, Debussy, Oscar Wilde, Paul Valéry, ou Alfred Jarry (pour ne citer que les plus célèbres) ?
6Il ne faut certainement pas perdre de vue l’étymologie latine. Rappelons que la virtus désigne l’énergie, la force « mentale » ou « morale », en un sens qui n’est pas d’abord chrétien. Rappelons également, pour annoncer la suite, que le mot provient de vir, l’homme.
7Voir P. Lacoue-Labarthe, musica ficta (figures de Wagner), Christian Bourgois éditeur, 1991
8Voir J. Derrida, « La Double séance », in La dissémination, Editions du seuil, 1972
9On pourrait montrer que cet Acte pur ou ce Type universel prend la figure, dans les Divagations, de la Finance et/ou de l’Economie (c’est Mallarmé qui met des majuscules). Il faudrait faire apparaître ce qui est en jeu dans cette « figuration », si l’on peut encore le dire ainsi. En quoi l’économie et/ou la finance ont essentiellmement partie liée avec le projet, mallarméen mais théologique en son fond, du Livre ? Comment ce qui est ici déclaré impossible (le Livre) se relève-t-il là (dans l’économie ou la finance) ? Et pourquoi ?
10Voir « Trans Europe Eclairs », revue Po&sie, 2017/2, N°160-161
11Voir Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Folio essai, Gallimard, Paris, 1955
12Dès le Guignon, au moins, c’est-à-dire dès 1862, Mallarmé se distingue de ces poètes « majestueux » qui, « rythmant des pleurs voluptueux » et « mordant au citron d’or de l’idéal amer », font s’agenouiller le peuple. Toujours chez Mallarmé se marque une distance, admirative mais également ironique et irréductible, par rapport au Génie. Ceci, dans « La cour » publié en 1895 : « La noblesse, désormais, se passera du nom. »
Pingback: Mallarmé, la Poésie inter-dite, ou un penseur d’Internet avant la lettre (2) | Un Philosophe