
Portrait de Blaise Pascal (gravure)
L’objet de cet article est d’analyser la philosophie, religieuse, de Blaise Pascal en s’interrogeant sur la question, classique, de savoir comment Pascal, philosophe janséniste, n’admettant pas de liberté de l’homme face à Dieu, a pu concevoir une apologétique.
Le pari de Pascal
Tout le monde connaît les critiques qui ont été faites à propos du pari de Pascal : la foi ne naîtra jamais d’un jeu aussi puéril, Pascal est spéculatif mais au sens économique du terme, le jeu se fait dans le vide, etc. A croire que ce fragment ne serait pas devenu aussi célèbre s’il ne permettait à chacun de déceler une ombre au tableau de l’effrayant génie qu’était, selon Chateaubriand, Pascal, et de montrer par une salubre indignation que l’on ne marchande pas avec Dieu. La question qui se pose est celle desavoir quel est intérêt que nous pouvons y trouver.
Rappelons d’abord l’essentiel de l’argument de Pascal. Le fragment repose sur la disproportion entre l’infini et le fini, qui permet à Pascal de démontrer à la fois que l’on ne peut prouverl’existence de Dieu ni comprendre sa nature et qu’il faut néanmoins parier qu’il existe. Voyons d’abord le premier point. Ayant quelques rudiments de philosophie, le libertin acceptera d’en donner cette définition minimale : Dieu est un être indivisible, infini et enfin non-étendu. Ce qui suffit selon Pascal à évincer toute prétention à la connaissance non seulement de la nature de Dieu, mais aussi de sonexistence. En effet, si l’on peut connaître l’existence d’un infini d’ordre mathématique sans le comprendre, l’embrasser du regard de l’esprit, en revanche, en vertu de la double dissemblance qui réside entre nous et Dieu, il nous est radicalement impossible de l’appréhender par la raison. En premier lieu, nous éprouvons notre finitude sans qu’il y ait besoin de la prouver. En second lieu, s’il est pour Pascal certain que l’esprit est immatériel, néanmoins :
Notre âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, temps, dimensions, elle raisonne là-dessus et appelle cela nature, nécessité, et ne peut croire autre chose (Pensées, 418)[1].
Si bien que, finis et jetés dans un corps, nous ne pouvons connaître Dieu, qui est infini et immatériel. Dans une forme de pythagorisme négatif, tout au plus Pascal figure-t-il la distance qui nous en sépare par des considérations mathématiques sur l’infini. Par exemple en nous invitant à imaginer un point se déplaçant selon une vitesse infinie, qui serait donc à la fois partout et nulle part, infini et indivisible ; ou encore en nous invitant à penser aux « merveilleuses infinités » que la nature a « proposées aux hommes », non pour les « concevoir », mais « les admirer ». Mais ces expériences de pensée (« Je veux vous faire voir… »), ces raisonnements sur l’infini ne seront qu’analogiques ou figuratifs (« Ainsi notre esprit devant Dieu. Ainsi notre justice devant la justice divine », P 418), Dieu étant bien sûr d’un ordre supérieur à celui de l’espace physique ou mathématique.
La question de la croyance, dont il s’agira dans le pari, est donc bien moins une question théorique qu’une question pratique. Il s’agit de savoir quelle option existentielle nous devons raisonnablement choisir. En quoi consiste le coup de théâtre de Pascal qui lui permettra, à partir de cette même disproportion du fini et de l’infini, de nous mener à parier que Dieu existe ? Il faut ici préciser les conditions du jeu. Le pari a d’abord ceci de particulier que, si nous ne voulions pas y jouer, nous le ferions tout de même. Autrement dit, Pascal ne nous invite pas tant à parier qu’à nous faire prendre conscience que, d’une certaine manière, nous travaillons déjà « pour l’incertain » (P 577). Il est en effet admis que si Dieu existe, celui qui parie pour Dieu connaîtra une infinité de vies infiniment heureuses, alors que celui qui ne le fera pas sera, pour le dire brutalement, damné. La question de la vérité de la religion étant, pour un temps, éludée, il s’agit de savoir où se situe notre intérêt. Le libertin admet ce principe, mais il en tire une fausse conclusion. Il faut donc déterminer, en des termes qui ne sont pas ceux de Pascal, l’espérance mathématique qui permettra de définir quel parti est le plus avantageux. Elle peut être définie simplement comme le produit du gain par la chance. L’on considère que le jeu est équitable lorsque la mise est égale à l’enjeu, avantageux lorsqu’elle lui est supérieure. Pascal ne peine donc pas à démontrer au libertin qu’il vaut mieux qu’il parie, non seulement s’il y a une égale probabilité que Dieu existe ou n’existe pas mais à la seule condition que les chances du gain soient supérieures à zéro. Pourvu qu’il y ait ne serait-ce qu’une chance pour que Dieu soit, il faut tout donner.
Deux points doivent être également soulignés. Selon Pascal, le pari est un choix raisonnable pour être heureux non seulement dans une vie future possible, mais également « en cette vie ». Pascal devance l’objection que pourrait lui opposer le libertin : il est difficile de renoncer aux plaisirs terrestres. Or Pascal soutient que la vie du croyant est beaucoup plus heureuse que celle de l’incroyant en raison à la fois de l’espoir qui donnera une autre saveur à sa vie, mais aussi des plaisirs de la vie chrétienne :
Or quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti ? Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, ami sincère, véritable… A la vérité vous ne serez point dans les plaisirs empestés, dans la gloire, dans les délices, mais n’en aurez-vous point d’autres? Je vous dis que vous y gagnerez en cette vie (…) (P 418).
D’autre part, le premier à avoir objecté à cet argument son insuffisance c’est bien Pascal qui met en scène le libertin acculé et néanmoins incapable de croire.
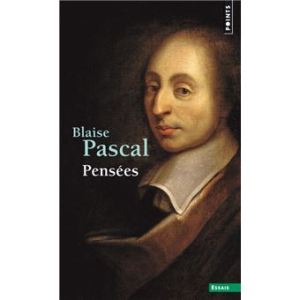
« Pensées », Blaise Pascal (Points, éd. Lafuma)
Ce qui doit donc être interrogé, c’est la raison de cet échec, non plus d’un point de vue théologique, mais sur le plan de l’expérience. Pourquoi le parieur reste-t-il au pied du mur ? C’est, dira-t-on, parce qu’il n’a pas la grâce ; mais que caractérise le vécu de l’homme qui l’a face à cette question fondamentale ? Nous avons soutenu que l’expérience de la crise était déjà une étape du cheminement décrit par Pascal. La condition humaine ne paraît anormale, révoltante, qu’à celui qui a entrevu ce qu’est la nature humaine. C’est parce que l’homme a perdu un bien supérieur que les biens dont il jouit à présent ne le satisfont pas. Le libertin nie parier car il dénie l’expérience de l’ennui qui n’est guère plus communicable que celle de grâce.
L’ennui chez Pascal
A l’origine de toutes les activités et de toutes les passions, il y a qu’on appellera, par référence au pur plaisir de Rousseau qui en constitue l’exact opposé, la pure douleur d’exister. L’on n’est en approche que dans l’interstice séparant deux désirs, après l’obtention, avant la poursuite d’un objet. L’homme peut alors éprouver le sentiment sui generis de sa « propre complexion » :
Ainsi l’homme est si malheureux qu’il s’ennuierait même sans aucune cause d’ennui par l’état propre de sa complexion. Et il est si vain, qu’étant plein de mille causes essentielles d’ennui, la moindre chose comme un billard et une balle qu’il pousse, suffisent pour le divertir (P 139).
Mais ce sentiment, éprouvé de manière toute charnelle, comme le suggère Pascal en parlantde la complexion de l’homme, ce sentiment a également un contenu cognitif. C’est à la fois une épreuve par laquelle on peut ou non passer, mais aussi un état général caractérisant l’existence. Ainsi, s’il se passe bien de tout objet, c’est parce que l’ennui coïncide avec la prise de conscience, plus ou moins confuse, non seulement du caractère illusoire de l’objet du désir, mais également de l’inconsistance ontologique du sujet de ce désir. Parce que l’homme a perdu son vrai bien, il se donne de faux biens qui non seulement ne peuvent le satisfaire, mais lui font oublier pour un temps le fait fondamental du péché originel, séparation de l’homme d’avec l’Être qui pourrait seulement le contenter.
Pascal multiplie les exemples à satiété pour montrer que, si l’homme cherche à donner une nécessité à l’objet son désir, il n’y en a en réalité aucune. Les motifs que les hommes donnent à leurs actions lui semblent occulter leur raison profonde. Non seulement parce que ce que nous considérons correspondre, pour parler comme Pascal, à la nature « en nous » (les « métiers ») ou procéder de la nature « hors de nous » (les lois prétendument naturelles), n’est en fait que le fruit du hasard. Mais aussi parce que presque toutes nos actions procèdent justement d’un même désir de nous détourner de nous-mêmes. Ce qu’il lui faut prouver pour amener l’homme à cesser ce qui pourra alors seulement être défini comme un divertissement, c’est-à-dire une diversion.
Les deux exemples privilégiés par Pascal sont centraux dans l’existence humaine. Il s’agit d’une part des métiers dont le choix « est la chose la plus importante à toute la vie » (P 649), mais qui s’explique, le plus souvent, par le hasard, c’est-à-dire une somme de contingences géographiques, historiques et, dirions-nous aujourd’hui, un conditionnement social (« A force d’ouïr louer en l’enfance cesmétiers et mépriser tous les autres on choisit » P 630). Il s’agit, d’autre part, de l’amour. Il semble que l’amour soit illusoire en ceci que le sujet nie spontanément la contingence de son origine. Loin que Pascal soutienne la conception romantique de l’amour que l’on a parfois voulu tirer d’une citation bien connue, il s’attache à en débusquer l’illusion. C’est dans ce contexte que s’introduit la fameuse analyse du moi. L’on voudrait être aimé pour ce que l’on est profondément, ce que l’on ne partage avec personne, ce qui de soi-même résisterait à l’érosion du temps. Or ce qui suscite l’amour ce n’est rien deplus que des qualités qui, en tant que telles, sont périssables et pourraient être partagées par d’autres sujets. Si l’on pouvait rendre raison de son amour, en se référant à de telles qualités, l’on montrerait du même coup qu’un autre sujet aurait pu aussi bien satisfaire à ces exigences. Aussi, parce qu’il voudra préserver la nécessité de son amour, le sujet invoquera-t-il un « je ne sais quoi » qui, pour autant que l’on ne pourra en rendra compte, échappera à la critique. « Parce que c’était lui, parce que c’était moi », écrit Montaigne ; certes, répond en quelque sorte Pascal, mais cela aurait pu être un ou une autre et il n’y en aurait pas moins eu cette illusion. Aussi réduit-il aussitôt, dans une citation célèbre, ce je ne sais quoi à «si peu de chose » – une singularité physique, en l’occurrence, qui disparaîtra avant la « substance » – :
Qui voudra connaître à plein la vanité de l’homme n’a qu’à considérer les causes et les effets de l’amour. La cause en est un je ne sais quoi. Corneille. Et les effets en sont effroyables. Ce je ne saisquoi, si peu de chose qu’on ne peut le reconnaître, remue toute la terre, les princes, les armées, le mondeentier. Le nez de Cléopâtre s’il eût été plus court toute la face de la terre aurait changé (P 413).

Portrait de Montaigne (anonyme du XVIème siècle)
C’est donc, selon Pascal, un monde où le désir se suffit à lui-même que le monde du divertissement. C’est un monde où les sujets attribuent à leur désir une fausse nécessité que l’on pourrait dire, en référence à ce fragment, empruntée. Mais comment s’expliquent, dès lors, les choix humains, leurs activités s’il est vrai que c’est la chasse que nous voulons plutôt que la prise ? Autrement dit, comment s’expliquent les agitations humaines si le désir précède l’objet du désir ? Pascal, en bon physicien sait qu’il ne suffit pas de repérer l’illusion, encore faut-il l’expliquer. Or, il semble qu’en rendent compte les facteurs conjugués du désir de se détourner de la misère humaine, la volonté de dominer les autres, enfin l’imitation des désirs. D’une part, il faut des activités violentes, des activités mouvementés, qui empêchent de penser ; d’autre part, puisque l’on ignore ce que l’on est, ce que l’on veut, « chacun prend d’ordinaire ce qu’il a ouï estimer » ; enfin, tout doit servir au moi à se glorifier. Une activité est donc jugée intéressante par l’homme en proportion à la fois de sa capacité à captiver son attention et de sa valorisation par les autres hommes. C’est pourquoi il est vrai qu’il estpréférable d’être roi et il serait absurde de le nier. Mais la préférabilité, si l’on peut dire, de ce métier, ne tient pas à une qualité qui lui serait intrinsèque, mais à ceci qu’il accapare le plus intensément l’attention et qu’il est donc prisé. D’où la fascination pascalienne pour cette fonction qui témoigne de la capacité humaine à construire sur du vide, mais aussi le nivellement qui résulte de sa conception du désir : « Les hommes s’occupent à suivre une balle et un lièvre : c’est le plaisir même des rois (P 39) ».
La grâce chez Pascal
Lorsque Pascal appréhende la situation de l’homme dans le monde et les « maximes humaines », c’est selon la modalité intellectuelle et affective de l’étonnement. Cet étonnement est renouvelé devant ce fait mystérieux : le libertin, l’honnête homme, etc., agissent comme si cette condition était « normale ». Pascal peut donc affirmer : « ce qui m’étonne le plus est de voir que tout le monde n’est pas étonné de sa faiblesse » (P 33).
Comment expliquer, si tout étonnement procède d’un écart – entre ce que l’on sait, et ce que l’on voit, ce à quoi l’on s’attendait, et ce qui arrive – que l’existence puisse être en elle-même à l’origine d’un étonnement ? Il semble qu’il faille distinguer, chez Pascal, la coutume au sens trivial du terme et une coutume d’ordre ontologique. La seconde consiste dans l’oubli de la différence qui sépare le premier homme et l’homme corrompu, cet oubli amenant à méconnaître la profonde dualité de l’homme qui en fait, sans la référence au péché originel, une question indécidable. Ce que nous allons vérifier, d’abord, sur le plan théologique de la pensée de Pascal, puis sur le plan de l’expérience.
Tantôt parce que, prenant conscience de la misère humaine, nous en oublions la grandeur ; tantôt parce que, considérant la grandeur humaine, nous en oublions la misère, nous confondons la véritable nature de l’homme et sa condition corrompue. Aussi, dans l’Entretien avec monsieur de Saci, Pascal dénonce-t-il les erreurs, symétriques, d’Epictète et de Montaigne. Le premier est condamné poursa superbe diabolique. Il a bien connu les devoirs de l’homme : il s’agit d’aimer Dieu et de se soumettreà sa Providence. Mais, croyant que sa volonté est libre et que son esprit est sain, il méconnaît l’état de corruption de l’homme qui, sans le secours de Dieu, est incapable de connaître le bien et d’accomplir ses devoirs. Le second, à l’inverse, perçoit la profonde misère humaine, mais oublie que, par la grâce, il est possible à l’homme d’être vertueux, de connaître la vérité. « Tout ce qu’il y a d’infirme » appartient « à la nature » et « tout ce qu’il y a de puissant » « à la grâce » ; or le problème de ces auteurs est, dans le premier cas, de faire comme s’il n’y avait pas eu le péché originel ; et, dans le second, de faire comme si l’état de l’homme à la suite de ce même péché, n’avait rien d’anormal.
De manière similaire, mais d’un point de vue historique, les jésuites confondent la grâce quiétait octroyée à Adam, qui lui permettait de faire à la fois le bien et le mal, et la grâce qui nous est à présent octroyée qui nous incline infailliblement au bien. La liberté d’Adam, liberté d’indifférence, s’opposait à la nécessité ; il suffit, à présent, que la liberté s’oppose à la contrainte, la grâce ne forçant pas l’homme à bien agir, mais agissant sur sa volonté en lui donnant la force et, pour ainsi dire, le goût d’agir de manière vertueuse. Mais il semble que l’on puisse également affirmer que les protestants eux-mêmes, qui ont pourtant insisté le plus sur la corruption humaine, ont méconnu la différence profonde séparant l’homme de la seconde nature et celui de la première nature. En effet, ce qui dérange Pascal chez les calvinistes, c’est certes la suppression totale de la liberté au niveau de la seconde nature ; mais c’est surtout que, selon l’interprétation que Pascal en donne, pour Calvin, Adam n’était pas moins déterminé que nous. Certains fragments des Pensées, qui concernent la seconde nature, pourraient être écrits par un calviniste, en particulier le fragment 42 ; mais jamais Pascal ne pourra affirmer, comme le font selon lui les calvinistes, que Dieu n’a pas seulement « permis », mais « voulu » le péché originel. D’abord parce que Pascal n’affirmera jamais que Dieu veut la damnation des hommes, mais seulement qu’il abandonne les pécheurs à eux-mêmes. Mais surtout parce que l’écart qui nous sépare d’Adam s’estomperait de nouveau.
L’homme est une image ambiguë. Il est à la fois grand par la grâce qu’il peut recevoir et misérable parce qu’il est. C’est pourquoi la grande erreur consiste bien dans l’oubli ou l’atténuation du caractère « monstrueux », c’est-à-dire contre-nature, de sa condition. Cette doctrine, que soutient Pascal, était déjà celle de saint Augustin qui préférait réserver le mot « nature » à la situation d’Adam au jardin d’Eden. Pascal peut donc se demander :
Mais qu’est-ce que la nature ? pourquoi la coutume n’est-elle pas naturelle ? J’ai grand peur que cette nature ne soit elle-même qu’une première coutume, comme la coutume est une seconde nature (P 126).
En effet, que nous apprend l’expérience ? Que l’homme est modelé par sa condition sociale, les habitudes et les règles de vie qu’on lui a transmises de génération en génération. S’il n’était pas corrompu, l’on pourrait connaître son essence qui déterminerait son mode de vie ; puisque Adam a péché, les hommes n’ont pour ainsi dire plus de nature : tout en eux est déterminé par leur condition (sociale, géographique, historique, etc.). La pluralité est donc corrélative à la corruption comme l’unité le serait à la pureté de la nature humaine. Si bien que la découverte de l’omniprésence de la coutume dans ses attitudes, ses croyances et sa manière d’exister, peut permettre à l’homme de prendre conscience de son état déchu. Il semble, conformément au premier sens de l’expression, que si tout en l’homme devient seconde nature (coutume, habitudes, etc.) c’est parce que la « nature » que nous connaissons est elle-même seconde, c’est-à-dire viciée, corrompue ; il semble, conformément au second, que l’état de corruption, à l’instar de la coutume, a pour effet de se faire passer pour naturel. En vertu d’une loi semblable au principe de relativité galiléenne, les hommes ne peuvent déterminer, à l’intérieur de leur « référentiel » s’ils sont, ou non, en mouvement.

Henri Gouhier
La question posée plus haut doit être posée de nouveau. En effet, si l’étonnement éprouvé à la rencontre d’autres cultures procède de leur comparaison avec la nôtre, comment l’épreuve de l’étonnement à l’égard de l’existence s’explique-t-elle ? Pascal a vécu, au terme de sa période ditemondaine, le trouble violent et l’étonnement salutaire qu’il décrit dans l’Écrit sur la conversion du pécheur. L’homme touché par la grâce n’est pas, d’abord, dans un état de béatitude. La « vue » nouvelle qu’elle inspire au pécheur consiste en un ébranlement de tout l’être. La grâce révèle la vanité des biens qu’il croyait trouver dans le monde en même temps qu’elle suscite en lui un sentiment ambigu à l’égard des « maximes humaines ». C’est ici qu’intervient l’étonnement en même temps que la prise de conscience du péché et de la détresse de notre situation : le converti passe de la « détestation » aux « pleurs » et de la colère à la charité devant la folie des hommes qui trouvent leur bonheur dans le monde plutôt qu’en Dieu. D’où, bien sûr, les variations dans les tons que prendra Pascal dans les Pensées, son étonnement se manifestant de manière comique ou tragique, variations témoignant bien de cette ambivalence de l’attitude du converti à l’égard des incroyants.
Le passage de la vie mondaine à la vie chrétienne est donc loin d’être paisible. Si l’itinéraire spirituel que parcourt le converti s’achèvera, idéalement, dans la certitude de et la joie en Dieu, il commence par la souffrance et le désespoir, et s’y mêleront toujours la crainte de perdre Dieu et le regret de ne pas l’avoir connu plus tôt. Par une sorte de purification, le pécheur, en même temps qu’il renaît à lui- même, meurt au monde et s’étonne de la vie qu’il a vécue comme si elle lui était étrangère. La grâce l’arrache à sa condition et, par la distance qu’elle introduit entre lui et le monde, elle lui permet de comprendre les hommes et d’en percevoir la vanité. Néanmoins, le discours de l’apologiste n’est pas vain car s’il ne peut provoquer la grâce, du moins peut-il, comme le remarque Henri Gouhier, lui servir d’instrument. La question du sens de l’apologie est alors non supprimée, mais déplacée. Dans quelle mesure l’apologie peut-elle constituer un instrument pour la grâce ? Il semble précisément que son rôle essentiel sera de troubler le lecteur des Pensées. « L’homme passe l’homme » et l’apologiste a pour devoir de le lui apprendre, usant de ses qualités de rhéteur, théologien et dialecticien, pour le troubler et le mettre en quête de son vrai bien. Ce qui explique qu’il faille, avant d’expliquer les contradictions de l’homme par la doctrine du péché originel, lui faire prendre conscience qu’il est un « monstre incompréhensible ». Comme le montre le fragment 130 des Pensées, le sentiment d’incompréhension n’est pas initial, mais consécutif au vertige que suscitent l’appréhension successive de la grandeur et de la misère de l’homme, et l’argumentation serrée de l’apologiste ; ce n’est pas tant un défaut de compréhension que la manière adéquate d’appréhender l’homme. L’étonnement peut être aussi provoqué par l’utilisation de l’antithèse, lorsqu’elle n’est pas seulement rhétorique, mais permet de voir « d’une vue » (P 559) la dualité humaine. La rencontre de deux prédicats contradictoires devra brusquer le lecteur et le désolidariser de l’évidence du monde et de l’homme. Elle vise, précisément, à permettre au lecteur de s’apercevoir de l’étrangeté fondamentale de sa condition et, tel est sans doute le grand cri pascalien, de son anormalité.
© Gabriel Arzounian
Notes :
[1] Nous citons les Œuvres complètes, Louis Lafuma, Seuil, L’intégral, 1963.
Bibliographie
Jacques Darriulat, Penser Les Pensées (1), Première leçon: la misère de l’homme. Consulté sur : http://www.jdarriulat.net/Auteurs/Pascal/PascalIntrod1.html#Text1.
Jacques Darriulat, PASCAL Penser Les Pensées (2), Deuxième leçon : le théâtre des vanités. Consulté sur : http://www.jdarriulat.net/Auteurs/Pascal/PascalIntrod2.html
Jacques Darriulat, PASCAL, Penser Les Pensées (3), Troisième leçon
: la chasse, non la prise. Consulté sur : http://www.jdarriulat.net/Auteurs/Pascal/PascalIntrod3.html
Jacques Darriulat, PASCAL, Penser Les Pensées (4), Quatrième leçon : la conversion. Consulté sur : http://www.jdarriulat.net/Auteurs/Pascal/PascalIntrod4.html
Lucien Goldmann, Le Dieu caché : Étude sur la vision tragique dans Les Pensées de Pascalet dans le théâtre de Racine, Paris, Éditions Gallimard, 1959
Pierre Guénancia, « Justices et ordre », in Au risque de l’existence, Editions universitaires de Dijon 2009.
Henri Gouhier, Blaise Pascal conversion et apologétique, Paris, J.Vrin, 1986
Jean Mesnard, Les Pensées de Pascal, Paris, SEDES, 1976
Hélène Michon, Philosophie, théologie et mystique dans les Pensées de Pascal, Paris, Honoré Champion, 1966Hervé Pasqua, Blaise Pascal penseur de la Grâce, Paris, Téqui, 2000
Pascal, André Comte Sponville. Pensées sur la politique, Rivages Poche, 2015
merci pour ce bel essai, clair et articulé que j’ai leur avec grand plaisir … il m’inspire deux reflexions.
La pensée de Pascal me semble étrangement résonner avec celle de Schopenhauer, bien que leurs conclusions soient opposées. Pour Schopenhauer, la vie est un pendule qui oscille de manière perpétuelle entre la souffrance du désir inassouvi et l’ennui qui suit l’assouvissement de ce désir. . L’ennui est donc le point culminant de la vie quand le désir est momentanément apaisé, une sorte de vide métaphysique Il semble que la pure douleurde l’ennui chez Pascal soit le pendant exact du vide qui s’abat sur l’individu schopenhauerien lorsqu’il a atteint son but. Le divertissement pascalien correspondrait alors à l’agitation sans fin de la volonté de Schopenhauer qui, incapable de se reposer, se jette dans une nouvelle quête.
Du coup, est ce qu’avant la bifurcation religieuse, la description de la misère humaine est très similaire chez les deux penseurs ? La différence fondamentale semble dans l’existence ou non d’un remède : la grâce pour Pascal, et le renoncement à la volonté, l’ascèse, pour Schopenhauer ?
Ma seconde reflexion a plus à voir avec la grâce. Vous expliquez que la grâce pascalienne, bien qu’agissant sur la volonté de l’homme pour l’incliner au bien, ne supprime pas la liberté mais agit plutôt comme une force qui arrache l’homme à sa condition déchue.
Il me semble que cette vision (imprégnée de jansénisme) s’oppose à la conception singulière de la grâce de Simone weil qui est un auteur que j’aime beaucoup. Pour elle, la grâce n’est pas tant une force active et infaillible qui nous est donnée qu’une « pesanteur » qui tombe sur l’âme lorsque celle-ci se vide d’elle-même. Dans ses cahiers elle écrit : « La pesanteur est le grand péché de l’âme. Ce qu’il y a de plus lourd en nous, c’est le moi. La grâce est une force qui entre dans l’âme vide. » . Contrairement à Pascal qui voit la grâce comme la solution au mal ontologique de l’homme déchu, Weil la perçoit comme un un « vide à comber » , une sorte de récompense pour la « décoration » du moi, c’est-à-dire le renoncement volontaire aux illusions et aux désirs terrestres. C’est un processus plus ascétique et mystique.
Je suis curieux de savoir comment vous situeriez le concept de grâce de Pascal par rapport à celui de Weil ? La grâce pascalienne, qui incline infailiblement au bien, ne risque-t-elle pas de sembler trop « facile » ou trop automatique par rapport à l’effort de « de-création » que Weil juge nécessaire pour la recevoir ? La douleur que vous décrivez chez le converti pascalien est-elle la même que la pesanteur de Weil ?
Quoi qu’il en soit, merci beaucoup pour votre texte qui, comme vous le voyez m’a fait phosphorer dès le petit matin ..
J’aimeAimé par 1 personne