
Léon Trotsky, à son bureau en 1919
Le trotskysme a été traversé par un profond débat sur la nature de l’URSS. Celle-ci étaitelle un « État ouvrier dégénéré », comme le voulait le fondateur de l’Armée rouge, ou bien un « capitalisme d’État » devant être analysé comme tel à la lumière d’une relecture de Marx ? À l’occasion du prochain anniversaire de la révolution d’octobre, retour sur un épisode du marxisme révolutionnaire.
La thèse de l’État ouvrier dégénéré
C’est en 1936, au neuvième chapitre de son ouvrage La Révolution trahie, que Léon Trotsky soutient, à propos de l’URSS, la thèse de « l’État ouvrier dégénéré » contre celle du « capitalisme d’État ». Cette dernière était alors essentiellement formulée au sein des courants anarchiste et conseilliste. Aux yeux de Trotsky, elle pose d’abord un sérieux problème politique en tendant à effacer la différence qui sépare le régime soviétique des régimes fascistes dans lesquels l’économie est en voie d’étatisation, à commencer par celui de Mussolini. Tout le propos de l’auteur de La Révolution trahie consiste dès lors à montrer en quoi l’appellation de « capitalisme d’État » doit d’abord être réservée aux régimes fascistes et pourquoi elle ne peut pas être étendue à l’URSS.
En réalité, souligne Trotsky pour débuter, le « capitalisme d’État » est d’abord une abstraction théorique qui ne peut pas avoir d’existence concrète. Effectivement, il « correspondrait à une situation dans laquelle la bourgeoisie tout entière se constituerait en société par actions pour administrer, avec les moyens de l’État, toute l’économie nationale. »[1] Dans un tel système économique, une répartition égale des bénéfices « s’appliquerait directement, sans concurrence des capitaux, par une simple opération de comptabilité. » Or, du fait des « profondes contradictions qui divisent les possédants entre eux », il n’y a « jamais eu de régime de ce genre et il n’y en aura jamais ». [2]
En fait, par l’expression, « capitalisme d’État », poursuit ensuite Trotsky, on entend, le plus souvent et surtout depuis les expériences de l’économie fasciste, désigner « l’étatisme », soit : « un système d’intervention et de direction économique de l’État »[3]. Or, entre l’étatisation soviétique et l’étatisme fasciste, mais aussi entre l’étatisation soviétique et l’étatisme des États-Unis de Roosevelt ou encore celui de la France de Léon Blum, toute la différence tient au maintien de la propriété privée et au rôle de l’État dans ce maintien. Ainsi, contrairement à l’étatisme du capital, la concentration soviétique des moyens de production entre les mains de l’État est un moyen, qui a pour fin l’abolition de la propriété privée et de l’État. Ce rapport moyen-fin prend ainsi la forme dialectique de l’aufhebung:
La propriété privée, pour devenir sociale, doit inéluctablement passer par l’étatisation, de même que la chenille, pour devenir papillon, doit passer par la chrysalide. Mais, la chrysalide n’est pas un papillon. Des myriades de chrysalides périssent avant de devenir papillons. La propriété de l’État ne devient celle « du peuple entier » que dans la mesure où disparaissent les privilèges et les distinctions sociales et où, par conséquent, l’État perd sa raison d’être. Autrement dit : la propriété de l’État devient socialiste au fur et à mesure qu’elle cesse d’être propriété d’État.[4]
À l’inverse, l’étatisme fasciste, tout comme celui des démocraties bourgeoises, ne vise nullement à substituer la propriété sociale à la propriété privée. L’intervention de l’État y est en effet mise au service de la défense de celle-ci :
Quels que soient les programmes des gouvernements, l’étatisme consiste inévitablement à reporter des plus forts aux plus faibles les charges du système croupissant. Il n’épargne aux petits propriétaires un désastre complet que parce que leur existence est nécessaire au maintien de la grande propriété . L’étatisme, dans ses efforts pour diriger l’économie, ne s’inspire pas du besoin de développer les forces productives, mais du souci de maintenir la propriété privée au détriment des forces productives qui s’insurgent contre elle. L’étatisme freine l’essor de la technique en soutenant des entreprises non viables et en maintenant des couches sociales parasitaires ; il est en un mot profondément réactionnaire.[5]
Pour l’auteur de La Révolution trahie, il est ainsi absurde de vouloir subsumer sous le concept de « capitalisme d’État » le système soviétique. Là où le capitalisme d’État est, par essence, réactionnaire, la concentration des moyens de production entre les mains de l’État soviétique réalise, elle, un grand progrès vers la double abolition de la propriété privée et de l’État.

« La révolution trahie », Léon Trotsky (Editions de Minuit, 1973)
Cependant, remarque enfin Trotsky, ce progrès est, depuis l’arrivée de Staline, suspendu du fait de la dégénérescence bureaucratique du système, qui place ce dernier dans une situation de contradiction insoluble entre : d’une part, une tendance à l’augmentation des forces productives préparant l’avènement de l’économie socialiste et, d’autre part, une tendance au maintien de la répartition bourgeoise des richesses, du fait des privilèges accordés aux dirigeants.
Ce dernier point amène alors Trotsky à envisager la question suivante : le maintien de la répartition bourgeoise des richesses fait-elle de l’URSS une société de classe ? En d’autres termes, la bureaucratie forme-t-elle une classe sociale distincte, exploitant le prolétariat ? À cette question, l’auteur de La révolution trahie rappelle, tout d’abord, que selon la grille d’analyse marxiste, une classe doit se définir relativement à sa position dans les rapports de production : est-elle, oui ou non propriétaire des moyens de production ? Or, souligne-t-il ensuite, en URSS, les moyens de production sont propriété de l’État et la bureaucratie ne peut donc pas agir comme une classe qui en tirerait directement le bénéfice de l’exploitation. Elle agit bien plutôt comme une caste mobile d’individus parasitaires, qui ne peuvent pas transmettre leurs privilèges sous forme d’héritage, contrairement à ce qui s’observe dans les sociétés de classe :
Les tentatives faites pour présenter la bureaucratie soviétique comme une classe « capitaliste d’État » ne résistent visiblement pas à la critique. La bureaucratie n’a ni titres ni actions. Elle se recrute, se complète et se renouvelle grâce à une hiérarchie administrative, sans avoir de droits particuliers en matière de propriété. Le fonctionnaire ne peut pas transmettre à ses héritiers son droit à l’exploitation de l’État. Les privilèges de la bureaucratie sont des abus. Elle cache ses revenus. Elle feint de ne pas exister en tant que groupement social. Sa mainmise sur une part énorme du revenu national est un fait de parasitisme social.[6]
La thèse du « collectivisme bureaucratique »
Après la publication de La Révolution trahie, des auteurs et militants trotskystes vont s’opposer à la thèse de l’« État ouvrier dégénéré », et défendre celle du « collectivisme bureaucratique ». Initié par le théoricien italien Bruno Rizzi dans La bureaucratisation du monde, publié en 1939, cette dernière est notamment reprise par le théoricien français Yvan Craipeau, alors membre du Parti ouvrier internationaliste (POI), puis de la fraction : « Comité pour la IVe Internationale » au sein du Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP), ainsi que par le politologue américain James Burnham, membre du Socialist Workers Party (SWP). En substance, cette thèse affirme que, sur le sol de la Révolution d’Octobre, est née une nouvelle classe, la bureaucratie, au sein de laquelle est distribuée, sous forme d’avantages et de privilèges, la survaleur extraite de l’exploitation du prolétariat au sein des moyens de production détenus par l’État. Cette thèse se distingue notamment de celle de Trotsky par deux propositions. Tout d’abord, le « collectivisme bureaucratique » serait un régime économique distinct du capitalisme et du socialisme ; il n’est donc pas une déviation par rapport à ce dernier. Ensuite, ne représentant pas de la sorte un progrès par rapport au capitalisme, il n’a pas à être défendu.
La formulation de la théorie du « collectivisme bureaucratique » a fait réagir Trotsky. De 1937 à sa mort, en 1940, il défendit ainsi sa propre théorie de l’« État ouvrier dégénéré » et ses implications dans une série d’écrits rassemblés, après sa mort, sous le titre En défense du marxisme, et publiée en 1942 aux États-Unis par le SWP. La lecture de ce recueil d’articles et de lettres permet d’entrevoir une controverse forte entre, d’une part, Trotsky et, d’autre part Burnham, entre autres. Cette controverse théorique, qui conduit une partie du SWP à scissionner et à quitter la Quatrième Internationale derrière Burnham et Max Shachtman, tourne alors autour d’une question stratégique concrète : faut-il soutenir l’URSS dans la guerre en cours ? Celle-ci venait, en effet, de signer, le 23 août 1939, un pacte de non-agression avec l’Allemagne nazie. Ce pacte semblait devoir convaincre quiconque qu’elle ne portait pas ou plus le drapeau de la révolution mondiale. En septembre 1939, Trotsky écrit lui-même : « Peut-on, après la signature du pacte germano-soviétique, reconnaître en l’U.R.S.S un État ouvrier ? »[7]. À cette question, le débat qui oppose alors Trotsky et une partie du SWP sert d’assise théorique à deux prises de position antagonistes. Si l’on affirme, à la manière de Burnham, qu’il existe une différence qualitative et non pas quantitative entre l’URSS et le socialisme, que celle-ci n’est qu’un autre visage de l’exploitation, alors non seulement elle n’a pas à être défendue, mais elle doit même être combattue. Si, à l’inverse, l’on affirme, comme Trotsky, qu’il existe une différence quantitative entre l’URSS et le socialisme, que celle-ci n’est que le produit d’une dégénérescence bureaucratique de celui-ci, alors la patrie de Staline doit être défendue contre les différents impérialismes, car les bases de la révolution jetées en octobre 1917, soit l’étatisation des moyens de production en vue de l’abolition pure et simple de la propriété et de l’État, sont toujours sauves.
La réaffirmation de la thèse du capitalisme d’État et la rupture avec le trotskysme : Tonny Cliff au Royaume-Uni et Socialisme ou barbarie en France
 Le débat sur la nature de l’URSS s’est poursuivi au cours des années 1940 et 1950. Il a conduit un certain nombre de théoriciens issus du trotskysme à rompre, en partie ou complétement, avec ce courant. Les cas de Tony Cliff, fondateurs du SWP anglais, d’un côté, et de Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, fondateurs de Socialisme ou barbarie en France, de l’autre, sont, nous semble-t-il, emblématiques.
Le débat sur la nature de l’URSS s’est poursuivi au cours des années 1940 et 1950. Il a conduit un certain nombre de théoriciens issus du trotskysme à rompre, en partie ou complétement, avec ce courant. Les cas de Tony Cliff, fondateurs du SWP anglais, d’un côté, et de Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, fondateurs de Socialisme ou barbarie en France, de l’autre, sont, nous semble-t-il, emblématiques.
En 1946, se constitue au sein du Parti communiste internationaliste (PCI), section française de la Quatrième internationale, la « tendance Chaulieu-Montal », dont le nom reprend les pseudonymes respectifs de Cornelius Castoriadis et Claude Lefort. Cette tendance se définit par son refus de la thèse de l’« État ouvrier dégénéré » et son soutien à la thèse du « collectivisme bureaucratique ». En 1948, elle quitte le PCI, avant de se constituer en organisation autonome en 1949 sous le nom de Socialisme ou barbarie. L’organisation publie alors une revue théorique du même nom, dans laquelle Castoriadis et Lefort vont finalement caractériser l’URSS comme un « capitalisme bureaucratique » et « totalitaire ». En 1949, dans la deuxième livraison de la revue, Castoriadis écrit ainsi un article intitulé « Les rapports de production en Russie », dont la démonstration entend s’appuyer sur l’œuvre de Marx lui-même[8]. Contrairement à ce que défendait Trotsky, il y soutient l’idée que la bureaucratie constitue bien une nouvelle classe sociale, qui détient le monopole des moyens de production, décide de l’orientation de la production et exploite la force de travail du prolétariat. Ainsi, là où l’auteur de la Révolution trahie insistait, dans sa caractérisation de la classe sociale dominante, sur sa capacité à tirer un bénéfice immédiat de l’exploitation des moyens de production et sur sa capacité à se reproduire par l’héritage, Castoriadis insiste, lui, sur sa position sociale dans les rapports de production : l’URSS est une société de classe, car un groupe y domine les rapports de production et une société capitaliste, car ce même groupe exploite la force de travail des prolétaires. Le capitalisme peut donc bien être « d’État », car ce n’est pas tant la propriété privée des moyens de production qui le définit, mais le rapport social d’exploitation, tel qu’il a été analysé au livre I du Capital de Marx. Pour Lefort, qui souscrit aux analyses de Castoriadis, il faut de plus caractériser le régime soviétique de régime « totalitaire », en insistant sur l’abolition de la séparation entre l’État et la société civile qui s’y observe sous la direction du parti[9]. Après avoir rompu avec le trotskysme au moment où ils quittèrent le PCI, Castoriadis et Lefort s’éloigneront finalement progressivement du marxisme, le premier s’en expliquant notamment dans la partie inaugurale de son magnum opus, L’institution imaginaire de la société (1975), intitulée : « Marxisme et théorie révolutionnaire »[10].
À la fin des années 1940, Cliff est, pour sa part, exclu de la Quatrième Internationale pour son identification de l’URSS à un capitalisme d’État et fonde, en 1950, le SWP britannique. On peut prendre connaissance de ses analyses par la lecture de son ouvrage Le capitalisme d’État en Russie, écrit en 1948 et publié en 1955[11]. Tout d’abord, il y soutient que la bureaucratie stalinienne est une classe. Pour ce faire, il s’appuie notamment sur une définition donnée par Lénine de la classe, qui ne fait pas intervenir la notion d’héritage comme chez Trotsky :
Nous appelons classes d’importants groupes de personnes qui se distinguent par la place qu’elles occupent dans un système de production sociale donné, historiquement établi, par leurs rapports avec les moyens de production (la plupart de temps [pas toujours] formulés et fixés par des lois), par leur rôle dans le système social de travail, et par conséquent, par la façon dont ils obtiennent la part du revenu national dont ils disposent et par l’importance de cette part. Les classes sont des groupes d’hommes tels que l’un de ces groupes peut s’approprier le travail d’un autre groupe grâce à la différence de leur situation dans un système donné d’économie sociale.[12]
Si l’on s’en tient à cette définition, alors la bureaucratie stalinienne, qui tire profit du surtravail du prolétariat, est donc bien une classe, et non pas simplement une caste, le premier concept désignant un groupe de personnes ayant une position particulière dans les rapports de production, tandis que le second désigne un groupe « politico-judiciaire », dont les membres peuvent appartenir à différentes classes.
Ensuite, Cliff soutient que la bureaucratie stalinienne constitue la « pure et ultime incarnation du capital ». Pour commencer, il s’appuie sur Marx pour donner la caractérisation suivante du capitalisme :
Les deux fonctions qui sont les fondements du capitalisme, l’extraction de la plus-value et sa transformation en capital, se trouvent divisées avec la séparation du contrôle et de la direction. Alors que la fonction de la direction est d’obtenir la plus-value des travailleurs, le contrôle la fait se transformer en capital. Seules ces deux fonctions sont nécessaires à l’économie capitaliste ; les actionnaires n’apparaissent de plus en plus que comme consommateurs d’une certaine partie de la plus-value. La consommation d’une partie du surproduit par les exploiteurs n’est pas spécifique au capitalisme, elle a existé dans tous les systèmes de classes. Ce qui est spécifique au capitalisme, c’est l’accumulation pour l’accumulation, dans le but de soutenir la concurrence.[13]
De là, il en conclut que : « Nous pouvons donc dire que la bureaucratie russe “possédant” comme elle le fait l’État, et contrôlant le processus d’accumulation, est l’incarnation du capital sous sa forme la plus pure », avant d’ajouter, plus loin : « La bureaucratie russe en tant que négation partielle de la classe capitaliste traditionnelle est en même temps la plus véridique incarnation de la mission historique de cette classe. »[14]
Enfin, sur ce dernier point, l’auteur du Capitalisme d’État en Russie en arrive alors à utiliser implicitement les théories trotskystes de la « révolution permanente » et du « développement inégal et combiné », pour formuler l’idée selon laquelle la Révolution d’Octobre fut un échec au regard de la norme socialiste, car le prolétariat ne réalisa pas simplement les tâches politiques historiques de la bourgeoisie (démocratie et libertés formelles), mais aussi sa tâche économique, en permettant la mise en place d’un État qui a fait passer la Russie d’un régime semi-féodal à un régime de nature capitaliste. Stratégiquement, il en ressort que, contrairement à ce que soutenait Trotsky, la révolution prolétarienne à venir sur le sol russe ne devra pas seulement être de nature politique (lutte contre la bureaucratie et ses privilèges), mais bien de nature sociale et économique (abolition de la société de classe sur la base d’une socialisation réelle des moyens de production).
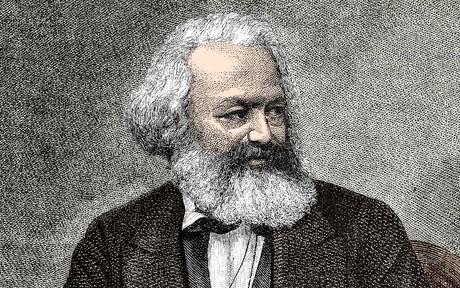
Karl Marx
Défendre l’héritage de 1917 contre toute forme de subsomption historique
« État ouvrier dégénéré » ou « capitalisme d’État » ? Cette question est, comme on l’a vu, non pas simplement descriptive, mais bien normative. Chacune des thèses en présence est, en effet, chargée d’implications stratégiques, qui, en tant que telles, ne peuvent être comprises qu’à la lumière d’un contexte historique donné. Pour Trotsky, il s’agissait de défendre les acquis de la Révolution de 1917 à la fois contre les différents impérialismes occidentaux et contre la bureaucratie stalinienne. Pour les tenants de la thèse du « capitalisme d’État », il s’agissait d’affirmer l’indépendance du prolétariat mondial à l’égard de l’URSS, en renvoyant dos à dos le bloc de l’ouest et le bloc de l’est dans une même politique d’extraction de survaleur du travail des ouvriers et ouvrières.
Conséquemment, on pourrait considérer que le débat reste de facto ouvert, la tradition du marxisme révolutionnaire pouvant laisser les deux thèses cohabiter à titre théorique en son sein, sans que cela n’ait d’incidence sur la politique et la stratégie qu’il entend défendre aujourd’hui. Cependant, ce serait là se méprendre, tant sur le plan descriptif, que normatif. Sur le plan descriptif, il paraît, tout d’abord, difficile de caractériser l’URSS de « société de classe », dans la mesure où une classe sociale se caractérise bien par sa propre reproduction dans le temps, de génération en génération. Ainsi, s’il est vrai que la bureaucratie soviétique a pu être tentée de faire de ses avantages et privilèges un patrimoine à transmettre, elle n’y est pas parvenue et doit bien plutôt être qualifiée de « caste » parasitaire. Ensuite et conséquemment, il paraît difficile de faire de l’URSS une variante du capitalisme. Ainsi, s’il est vrai que le prolétariat russe et celui des « Démocraties populaires » furent « exploités », au sens précis que ce terme revêt dans le livre I du Capital de Marx, on ne peut pas faire de l’exploitation une condition suffisante pour définir une société comme capitaliste ; il faut encore que cette exploitation se fasse sur la base d’une privatisation des moyens de production par une classe sociale, qui, par ce fait, devient la classe dominante. Or, comme nous l’avons vu avec Trotsky, si la bureaucratie n’est pas une classe, mais une caste, elle ne peut pas être considérée comme la détentrice privilégiée des moyens de production.
Sur le plan normatif maintenant, la thèse du capitalisme d’État a pour effet tendancieux d’effacer la Révolution d’Octobre, ses réalisations et son importance de la mémoire du marxisme révolutionnaire et au-delà. En effet, dans une espèce de course à la radicalité, il s’agissait finalement de subsumer sous un même concept, le « capitalisme », le bloc de l’ouest et le bloc de l’est. Mais, ce faisant, la Révolution d’Octobre fut, au mieux, vue comme un échec, au pire jetée dans les poubelles de l’histoire. Or, ce n’est pas parce que de cette révolution accoucha finalement un régime bureaucratique digne des meilleurs romans de Kafka, qui gouvernait des rapports de production au sein desquels l’exploitation fut érigée en sport national stakhanoviste, qu’il faut la rejeter. Ce serait oublier toutes ses réalisations progressistes et ne pas voir, comme Trotsky nous l’enseigne, que l’arrivée au pouvoir de Staline est comparable à la réaction thermidorienne qui succéda à la Révolution française et ses aspirations les plus progressistes.
© Timothée Becuwe
Notes :
[1] Trotsky, La révolution trahie, in De la révolution, Les éditions de minuit, 1963, p. 600.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem, p. 595
[5] Ibidem, p. 601
[6] Ibidem, p. 603
[7] « L’URSS dans la guerre » (1939), in Defense du marxisme, URL : https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/defmarx/dma3.htm
[8] URL : https://www.marxists.org/francais/general/castoriadis/works/1949/index.htm
[9] Socialisme ou barbarie,no 19, juillet-septembre 1956
[10] Pour une lecture critique de cette première partie, on lira avec intérêt l’intervention de Daniel Bensaïd au colloque « Castoriadis », tenu à Saint-Denis et Cergy du 1er au 4 mars 2007, et reproduite dans le numéro 21 de Contretemps (2008, 1ère série) ; URL : https://www.contretemps.eu/politiques-de-castoriadis/
[11] URL : https://www.marxists.org/francais/cliff/1955/00/cliff_19550000.htm
[12] Cité par Cliff. URL : https://www.marxists.org/francais/cliff/1955/00/cliff_19550000.htm
[13] Ibidem.
[14] Ibidem .
Pingback: Tony Cliff : l’URSS comme capitalisme d’État contre Trotsky – Homo Hortus