
Jean-Clet Martin
Jean-Clet Martin est philosophe et écrivain. Ancien Directeur de programme au Collège International de Philosophie, il est l’auteur d’une oeuvre importante, entre autres Deleuze (Éditions de L’éclat), Enfer de la philosophie (Léo Scheer) ou Plurivers (PUF, coll. travaux Pratiques). L’année dernière, nous nous étions entretenu autour de son ouvrage Le siècle deleuzien (Editions Kimé) dans la collection «Bifurcations» qu’il dirige. En ce début d’année 2017, il publie Asservir par la dette (Max Milo), l’occasion pour nous d’une discussion autour de la dette, de notre asservissement, ainsi que des vies et des morts des Etats.
Quelles sont les raisons philosophiques qui ont motivé votre volonté d’interroger le problème de la dette ? Si je ne m’abuse, Asservir par la dette est l’un de vos premiers livres aussi politiques, dans un ton quasi-pamphlétaire ?

« Asservir par la dette », Jean-Clet Martin (Max Milo)
En effet, c’est un ouvrage explicitement politique quand les autres n’étaient politiques que de manière implicite, mais un implicite qui y dessinait déjà un tracé important. Par exemple quand j’interrogeais la question de l’enfer, du mal ou encore une intrigue criminelle de la philosophie, il y avait forcément des enjeux politiques en regard. Mais ces regards étaient appelés par les problèmes de la philosophie. Une manière d’entrer en lutte avec des formes de bêtise ou d’exclusion lorsqu’elle dresse de nouveaux plans de bataille. C’est inévitable ! La philosophie est une forme de combat, un Kampfplatz pour parler comme Kant qui en fait aussi quelque chose de martial. Elle déclare la guerre à l’opinion et aux certitudes majoritaires. Lorsque prévaut une idée du Bien, c’est évidemment étrange… Pourquoi faut-il distinguer et selon quelle règle ? Au nom d’une telle distinction s’établit une hiérarchie qui permet de juger, de discriminer, de mettre en place toute une série d’exclusions qui prennent rapidement le nom de « mal ».
Alors il me semble que pour les « temps contemporains » le concept de dette porte avec lui une constellation morale et qu’il connaît une histoire sans précédents, une intrigue qui met en relation la sphère des échanges, la politique, l’économie, selon une figure assez particulière. Tellement particulière d’ailleurs qu’il fallait peut-être bien un pamphlet pour la rendre visible. S’y joue, en effet, une nouvelle répartition, une ligne de conflits assez intéressante. Pour exemple, le bug annoncé au passage de l’an 2000… Il est le signe, comme je le disais récemment à Taddeï, d’une mutation dans les rapports de pouvoir. Il est le symptôme d’une transformation dans la manière de compter, de rendre des comptes à travers une dématérialisation de la monnaie. Les transactions se mesurent désormais selon des nano-secondes que seul l’ordinateur sait évaluer. Comment légiférer sur la circulation d’une monnaie qui s’est libérée des limitations de l’espace autant que du temps, c’est une question juridique autant que politique devenue cruciale et qui pose un certain nombre de problèmes aux Etats qui en dépendent dans leur financement…
Diriez-vous, dans une tonalité nietzschéenne, que l’Etat est mort mais que son ombre plane toujours ?
Que l’Etat soit mort on pourrait presque s’en réjouir… Mais je ne sais si on peut parler d’Etat de manière univoque. Le concept d’Etat est davantage pluriel et renvoie à une multiplicité. Il n’y a pas un Etat, mais des Etats qui ne se valent pas et dont la signification est pour ainsi dire irréductible à la figure de l’autorité, elle qui revêt une forme de transcendance absolue. L’Etat, au sens où je l’entends, est immanent au champ social ou n’existe pas. C’est pourquoi j’ai évidemment beaucoup de difficulté à admettre qu’il puisse y avoir des sociétés sans Etat, même dans le sillage des analyses de Clastres. C’est très en amont que Rousseau, après Hobbes, construisit d’ailleurs ce mythe, une espèce d’état de nature, avec la nécessité d’introduire là-dedans des catégories morales : « l’homme naturellement bon », tandis que Hobbes se paie une autre utopie, celle de « l’homme naturellement mauvais » qu’il compare au loup, réclamant un Etat d’exception. Refuser l’immanence de l’Etat au sein d’une société, c’est se laisser aller à la figure mythique d’un commencement. Mais je suis plutôt, comme vous le savez, du côté de la « différance », de ce qui diffère, de ce qu’on ne peut traiter en terme d’origine (fût-ce en cherchant une origine de l’inégalité parmi les hommes, etc.) Il y a, comme le remarquera tout de suite Rousseau, une difficulté d’établir l’origine, un « funeste supplément », une figure surnuméraire qui pose la question du contrat. Et le contrat n’a pas besoin d’une nature, d’une origine. Il diffère d’une toute autre façon que la dette. Il est fantomatique, spectral, toujours déjà contracté pour nous protéger justement de la dette. C’est ce que Deleuze notera même à propos du masochisme. Le couple masochiste est sans dette. On ne peut trouver plus politique que ça. Tout dans cette relation est codifié par un contrat, des conventions qui n’ont rien à voir avec des pulsions naturelles qu’on opposerait simplement au sadisme selon le concept presque organique du sadomasochisme. Je prends cet exemple un peu extérieur pour dire que même ce qui nous paraît redevable de l’instinct -jouir, souffrir, etc- est en vérité de l’ordre d’une institution, quelque chose de contracté. Et dans ce contrat, la relation de pouvoir témoigne d’une politique qui n’a rien à voir avec celle qui s’adosse à la nature.
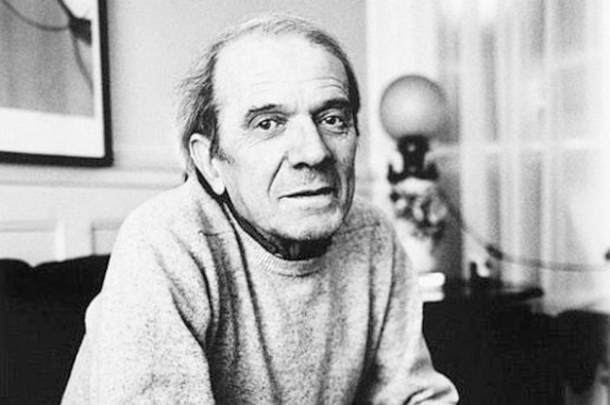
Gilles Deleuze
La politique naturaliste est déjà morte depuis l’avènement de la démocratie. L’Etat comme expression d’une nature est mort sur l’échafaud. Le sang royal a coulé. Le sang du politique est vidé. Tant mieux d’une certaine manière même si on peut dire que Louis XVI n’était pas le pire et qu’il a payé pour les autres. Par conséquent, quand je parle de la mort de l’Etat, c’est bien plus grave que ça. Je pense ici plutôt à la mort de Créon, mort de l’Etat comme expression du contrat, du droit positif, mort de l’Etat comme ensemble de conventions autour du travail, des salaires, des acquis sociaux… C’est une question micro-politique. Foucault aussi comprenait que le pouvoir ne vient pas d’en haut, mais des pénates, qu’il y a des concierges, des gardiens de nuit, des gens au bistrot aussi qui imposent leur terreur. Et le fascisme c’est plutôt ça, quelque chose qui vient casser les contrats, les conventions au nom de ce qui est naturel, bien entendu de tous, universel immédiat, bien arrosé au nom de la famille, des intérêts privés… La grande affaire des hommes infâmes c’est de gruger l’Etat, de défiscaliser, de ne surtout rien concéder au bien public. Bon, on voit suffisamment que l’Etat n’est pas une réalité homogène et on ne peut le confondre avec les instincts du despote. Le despote en grec, c’est toujours quelqu’un qui vient de la sphère privée, particulière. Il n’a rien à voir avec l’Etat, pas même avec le Tyran auquel un contrat peut faire appel pour rétablir la vie publique, menacée par la liesse. Je dirais que ce qui nous menace aujourd’hui ce sont précisément des despotes plus que des Tyrans. Même Bachar el-Assad est un despote plus qu’un Tyran – dont évidemment on ne voudra pas davantage ! Et en Europe, il n’y a plus d’hommes d’Etat. Il n’y a plus que de la gouvernance et un despotisme correspondant. L’Etat comme expression du Droit est donc mort. Et cela ne va pas mieux du côté de ceux qui crient au nationalisme, ceux qui se croient dépositaires du peuple. On le voit aujourd’hui avec les affaires qui émaillent la campagne électorale devant des candidats qui contestent le Droit et la Justice. Mais ce n’est tout. L’Etat souffre depuis les années 73 d’autres agressions, menées par une oligarchie qui le prend en otage et se nourrit de sa destruction. Voilà à peu près mon idée sur la mort de l’Etat, la triple menace despotique, nationaliste et financière qui pèse sur lui. Il ne survit plus que comme un fantôme, mais les fantômes connaissent, je l’espère, les moyens de leur retour…
Pensez-vous que Marx est encore assez puissant pour amener quelque chose aux contemporains à propos de la dette, dans la mesure où vous mobilisez surtout des philosophes comme Nietzsche ou Deleuze ?
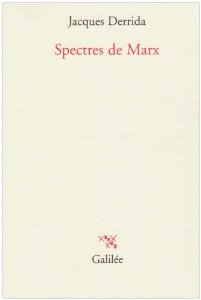
« Spectres de Marx », Jacques Derrida (Galilée)
Marx pourrait être l’acteur d’un retour politique, ce retour sur lequel je m’étais arrêté. C’est l’idée du livre de Derrida Spectres de Marx. Pour ma part, il y a chez Marx une réflexion sur le travail, sur l’automatisation qui me paraît décisive. Il y a une division du travail qui est réalisée dit-il pour diminuer le temps de travail, sa pénibilité. Comme si la technique nous permettait d’échapper à la sueur, à la dépendance, à l’esclavage. L’évolution des techniques est imparable de ce point de vue. C’est évident que le temps de travail se fait rare dès lors que tout peut se résoudre de manière numérique et par imprimantes 3D. Historiquement, la vérité du travail a toujours été celle de sa réduction. Les congés payés apparaissaient au MEDEF de l’époque comme une impossibilité. Le samedi chômé de même. Recevoir de l’argent pour ne pas travailler pendant quatre, puis cinq semaines, était considéré comme un parjure. Il y a une valorisation du travail par les pires. Les camps allemands comportaient à l’entrée la formule « Arbeit macht Frei », alors que de toute évidence seule la mort y était souveraine et qu’on n’y entrait pas pour en ressortir vivant. Et on dirait que cette valorisation n’est pas démentie par les Allemands qui continuent à parler du travail de façon étrange. Comment faire du travail forcé, de la flexibilité une exigence moderne ? C’est tout à fait incompréhensible. Il me semble que Marx nous permet pour le moins de penser cette aliénation que représente le travail quand il est imposé dans une relation de pouvoir. On ne peut pas ne pas voir immédiatement qu’il y a là quelque chose comme une lutte et que cette lutte est interminable. Mais lutte contre quoi ? contre qui ? Si le concept de lutte est un concept toujours vivant, en revanche il ne saurait s’agir de la lutte des classes. La notion de classe a volé en éclats au nom de spectres plus volatils. Fantôme d’Etat contre spectres financiers et drones stratégiques. Le monde a changé…
A propos de Deleuze, est-ce que cet asservissement par la dette est l’accomplissement d’une servitude volontaire propre aux sociétés de contrôle ?
Il me semble que Deleuze, justement, ne raisonne plus d’après des classes mais en terme de populations dont les segmentations sont beaucoup plus fines. Il n’y a plus de sujets du politique qui passerait par des postures figées comme celles de la « bourgeoisie » des « prolétaires »… C’est pourquoi j’ai tant insisté sur la mutation des sujets et des formations sociales depuis la Révolution. C’est le chapitre le plus important du livre. Tout le monde reconnaît que les classes sociales n’ont jamais été universellement arrêtées. Les « serfs » ou les « nobles » ne sont pas les mêmes agents de l’histoire que les « prolétaires » ou les « bourgeois » et il n’y a pas de raison à ce que ces acteurs se soient statufiés au sein de formations sociales qui ont considérablement bougé durant le XXe siècle. Disons qu’il n’y a plus vraiment de prolétariat aujourd’hui en France. La lutte change pour ainsi dire de front. Il faut de nouveaux instruments pour rendre les conflits d’intérêt visibles, pour saisir les enjeux qui traversent la société. Ce sont des personnages inédits qui entrent sur la scène de l’Histoire qu’avec Chantal Jacquet je nommerais des « Transclasses » en un sens sans doute très différent. Les réseaux sociaux, les moyens de communication numériques, la mondialisation, l’informatisation des moyens de production conduisent évidemment à des formes de subjectivation, de socialisation qui n’ont plus rien à voir avec un « cogito » capable de se boucler sur sa propre certitude, capable de se libérer de la servitude par la certitude de son excellence, de sa formation personnelle, de son instruction, de l’école. Le sujet des sociétés de contrôle est buissonnier. Pour fuir la dette qu’il endosserait en restant sur place ou en refusant la flexibilité, fera preuve d’un puissant mouvement sur des lignes qui ne sont plus seulement celles du travail, de la reconnaissance sociale. Ce sujet passe par des IP, des créations de pseudo, des amitiés, des liens dont le mode de représentation rejaillit sur sa propre figuration, sur sa propre certitude de soi. C’est l’objet du second chapitre de mon essai qui montre que l’homme endetté résiste en passant sur de nouvelles lignes de subjectivation, assez inventives, créatrices de personnages que la littérature aujourd’hui ne pourra plus rabattre sur celles du XIXe siècle – par exemple du côté de la bande dessinée autant que de la science-fiction ou du cinéma. J’avais abordé ce point déjà dans la dramaturgie du théâtre, de l’opéra contemporain par mon livre sur L’enfer et encore dans Le mal et autres passions obscures, et je suis en train de poursuivre cette exploration littéraire des « personnages » pour un livre à venir.
Vous montrez la dématérialisation progressive de l’argent, notamment dès Aristote parlant d’ « empreinte ». Cette virtualité est-elle le danger, le responsable de notre asservissement à la dette ?

« Ossuaires », Jean-Clet Martin (Payot)
Disons que la dématérialisation est une condition des mutations dont je parlais tout à l’heure. Cette dématérialisation a été longtemps religieuse comme j’essaie de le dire dans l’analyse du « corps glorieux », dans la circulation et la fabrication de « l’hostie » comparable à la mise en œuvre de la monnaie. C’est un acquis de mon ouvrage Ossuaires que Derrida avait beaucoup aimé et que je vais sans doute rééditer un jour chez Kimé. J’y reviens d’ailleurs dans la dernière partie de mon livre sur la Dette. Cette circulation de l’empreinte qu’Aristote déjà avait notée, culmine aujourd’hui sous forme « digitale » de sorte qu’il n’y a plus rien d’analogique dans nos échanges. L’argent n’existe plus dans sa forme matérielle. On est dans un monde totalement virtuel dont il existe heureusement un pendant créatif du côté des images de synthèses que j’avais abordées dans mon essai sur L’image virtuelle. Je dis ça pour rappeler que tout n’est pas mauvais, que le passéisme n’est pas mon genre. Il y a là forcément des lignes de fuite créatrices pour ce monde écrasé sous des formes de pouvoir iniques. Ce pourquoi l’acquis du livre sur la dette envisage un certains nombre de conséquences politiques quant à la dématérialisation. La thèse du livre consiste à reconnaître qu’il n’y a plus de matérialisme, que le matérialisme historique et les conditions de productions matérielles se sont éthérés dans la mondialisation des échanges sous forme de profits devenus totalement irréels. Le monde est devenu Spéculatif en ce sens. La dette même est irréelle. C’est cet irréalisme que j’aurais tendance du reste à opposer au réalisme, au « nouveau réalisme » qui semble requérir certains auteurs de la philosophie contemporaine assez éloignés des véritables enjeux du monde contemporain.
Pourquoi aucun Etat et aucun peuple ne choisissent-ils de ne jamais rembourser la dette ? N’est-elle pas essentiellement ce qu’on ne devrait jamais pouvoir rembourser ?
Il y a une dissociation actuellement entre Etat et Monnaie qui n’est pas abordée de façon sérieuse par les économistes. La vérité de cette affaire est qu’on ne va rembourser que le prêt alloué et contester la bulle spéculative qui nourrit surtout les Allemands. Il y a, de manière sous-jacente à la dette reconnue, une dette virtuelle qui est en train d’enfler selon des processus très complexes qui échappent aux Etats. La dette prend des tours absolument affolants sur le point d’éclater, de se démultiplier de façon galopante, à tel point que les pays européens du sud mettraient forcément plusieurs siècles à la rembourser. C’est parfaitement monstrueux d’aliéner l’avenir au bien être des choses du passé. Impossible à admettre cela et les luttes en cours vont bientôt l’annoncer. Ce serait à la gauche, de Mélenchon, de Hamon, que reviendrait la nécessité de traiter de ce problème et de trouver les conditions historiques pour construire de nouvelles perspectives, redéfinir ce qu’est un intérêt et comment l’intérêt n’a rien à voir avec un taux, repenser l’échange en y intégrant les forces et énergies physiques, seuls lieux d’échanges vitaux. Cette relocalisation des formes d’échange, dans l’éolien, le solaire, l’océanique là où se creusent des bassins attracteurs in situ, voilà la seule perspective pour les « économies » ou « écosophies » de l’avenir.
Entretien préparé par Jonathan Daudey
Propos recueillis par Jonathan Daudey
Merci pour vos propos dont l’ampleur demande quelques commentaires. Nos sujets principaux sont donc : « l’Etat », la société, la politique, l’économie et la nature de la monnaie.
Doit-on rappeler que nous sommes tous et également – moi, tous les outres et pour toujours – nature-humaines avant d’être culture, et que c’est inéluctable !
Une philosophie radicale et précise – nécessaire en temps crise de culture et civilisation – est impossible sans cette reconnaissance et ce regard fondamental.
La nature qui nous regarde doit être profondément contemplée à la recherche des fondamentaux – pas seulement pour faire attention aux marches ou pour choisir mieux ses aliments. Organisée, définie et stable, la nature que se développe dans ses circonstances universelles permet l’élaboration de perspectives générales et radicales sur lesquelles dresser des prévisions et des aprioris tout à fait raisonnables. Certainement, l’empirisme et le positivisme consolident des praxéologies, apportent des choses d’utilités transitoires, mais ne peuvent pas révéler des directrices morales ou des orientions étiques – la philosophie invoque des responsabilités qui demandent des choix qui s’arbitrent sur des aprioris.
Une référence à un « état politique » évoque deux dispositions : 1) un état-de-chose collectif qui ne peut pas être inhérent – considérant l’humanité pour qui exister est un choix -, mais résultat de vecteurs économiques, culturels et politiques habituellement peut réfléchis ; 2) la conséquence d’interférences et d’exercices de pouvoir imposés et objectivant la croissance et manutention d’organisations étatistes dispensateurs de privilèges et profits.
Nous vivons dans une culture dont la métaphysique et les idées fondatrices, prises dans leurs dimensions diachroniques (évolution historique) et synchroniques (les cultes du dimanche, rituels et étiquettes culturelles), ne correspondent pas vraiment à la réalité, ne lui font pas honneur ; donc une culture déjà très imprégnée de « surréalités » et dissociée de la réalité, depuis ses lointains débuts.
Un état de chose social – avec ses architectures politiques et urbaines, châteaux et églises bien choyés par le patrimoine publique, ses organisations, exercices de pouvoir économique, cybernétiques bien ordonnées, progressives et de plus en plus techniques – commence, bien-sûr, par des différenciations et des choix fondamentaux. Comme l’exercice de la raison est notre apanage et nous corresponds, les distinctions ou différenciations les plus prudentes et raisonnables auront plus de possibilités de converger avec l’ethos humain, correspondre à notre nature ; ce que aura, on peut le prévoir, un effet bénéfique – nos projets personnels et collectifs ne se heurteront pas si frontalement a la réalité et aux processus existentiels.
Comme un court d’eau qui avant de devenir un fleuve est rejoint et renforcé par nombreux ruisseaux intégrant la même géographie, la structure d’une société évolue suivant son cours, para accrus et lentes transformations, ainsi que l’être humain. L’élan initial, pour être fondateur, sera toujours inscrit dans les meurs ; il fait partie marquante et central de cet « esprit social », c’est une empreinte profonde qui se reconditionne et se réactualise dans l’histoire. Les fondations initiales et rebondissements historiques de cet état de chose social – dont « l´État » et la partie politique active ou moteur – sont présentes, avec tout un éventail de modulations et mutations, dans l’assemblage culturel que configure la société : l´origine marque le caractère d’une société et se maintien présente et actuelle. Le début conditionne la fin ; le présent ancre dans l’infini et notre origine et le moment que se transforme suivant son cours.
La toute première distinction, l’impression baptismal qui civilise et qui, comme un fractal, se réactualise dans les historicités des individus, regarde a l’identité que l’on se fait de soit même ; réfère à la perception de notre statut dans l’ordre des choses ; reporte aux rapports que l’on imagine avoir avec ce que est autre et universel.
A sa source, du point de vue des références universelles les plus radicales, être nature-humaine apporte deux possibilités d’identifications ; une bifurcation : soit pour se comprendre 1) être réel et naturel, ou, 2) surréel et surnaturel ; bien ou mal ce reconnaitre, en harmonie ou exclusion ; à nous de choisir, ou laisser à autrui le pouvoir de nous prescrire une identité, des relations et un destin. A cette même nature est aussi donné le pouvoir, encore plus radical, de nier et refuser l’existence ; donc, l’existence que pour nous, humains, demande une acquiescence ; exister ou pas et de quel façon, est donc une liberté, un choix, un gout, un savoir qui pourra être raisonnable et responsable, honorable, ou pas du tout. L’existence dont les philosophes appréhendent l’essence a sa souche atemporelle, révèle être une réalité conjonctive et radicale ou la conscience est du monde et le monde est pour elle.
Une idée initiale, montée sur une distinction imaginaire que dissocie et démembre l’état-être proposé par la nature pour en faire l’esprit déporté d’un royaume surnaturel et incidentement lancé dans la matérialité pour des « raisons » exclusivement connues par des élus célestiels engendre une profonde désharmonie, un égarement cosmique et un désarroi cognitif ; dégénère et dégrade l’humanité tout à son début et dans plusieurs dimensions : notamment, celles de l’authenticité, des possibilités morales, de l’éthique et de intelligence. D’une forme ou d’une outre, la politique suit et accompagne le choix inaugural, dans notre cas, une partition sectaire initiale mutile l’harmonie cosmique.
Théocraties, aristocraties, ploutocraties, sociocracies (etc.) ne sont que des mouvements qui germinent dans les sillons da la chute inaugural et qui sont promus para des chimériques envoyés de l’au-delà, des descendants des dieux ou, simplement, des riches héritiers d’anciens conquérants ou chefs de clans, ou encore par les élus des « républiques démocratiques » que reçoivent, dans le sacrement laïc de l’élection, une intuition politique inoculée para le vote du peuple comme par la volonté d’un dieu. C’est bien la politique, toujours opérante d’une façon ou d’une outre, qui comme un chef d’orchestre rège ces relations.
Bien-sûr, une société est formée d’une masse passive, plus ou moins productive – que ce soit comme concierges, gardiens de la paix, professeurs d‘écoles publiques ou privées, etc. – oubliée des universels, obéissante et fidèle aux prescriptions culturelles de partis, d’églises et d’autres dénominations. Ce ne sont pas ces gens-là, ces groupes de métier et d’occupation qui, au long du processus que mène a la forme actuelle et essentiellement corrompu de gouvernance ont progressivement adultère et falsifié la monnaie d’une réalité mercantile a une représentation symbolique reproduite sans contrainte para ceux qui la fabrique et monopolise – avec une certaine prudence et attention d’ordre stratégique destiné à maintenir dans la durée l’utilité et pouvoir trompeur de la falsification.
C’est ce « système monétaire » internationalisé après la chute des formes antérieur de gouvernance (l’ancien régime monarchique) que finance et ultimement soutiens la totalité de l’appareille politique dont la fonction principal est faire tourner la machine sociale et le marché au gré de cette tromperie.
Il n’y a pas de dissociation entre « l’État » (que n’existe pas) et le monde de la vrais « monnaie » que, lui aussi, est bien mort et n’existe plus. Ces deux inexistants sont les fantômes que comme des masques cachent le Léviathan, également tirant, despote et aveuglés par le pouvoir ; fantômes qui, en plus, donnent comme valeur marginale, une certaine allure et importance aux caporales associés, élus ou nommées, que ensembles entretiennent les braves gens racontant des lurettes – et la foule se laisse emballer en direction a une terre promise ; un abîme inévitable et, d’une certaine façon, choisi.
Voter à gauche, à droite ou au milieu, appuyer la construction d’éoliennes financées de la même contrefaçon ne changera vraiment pas grand-chose – le Léviathan et un monstre que travaille à deux mains ; dans les coulisses il dirige avec la droite et administre avec la gauche. Il serait mieux que les jours d’élections personne n’allât voter ; zéro à tous les prétendants aux fonctions publiques ! Que les communautés commençassent à idéaliser des monnaies locales comme celle du Lac Léman ; que les individus échangeassent leurs économies en bitcoins – une monnaie qui, même virtuelle, possède une ancre de matérialité de nature technologique et qui est une vrai monnaie parce qu’elle ne peut pas être gonflé ou contrefaite, ni falsifié, et quelle appartient vraiment à ceux qui la gagne.
Une vision systémique est essentielle, elle permet de faire des alliances, de coordonner des actes et projets divers, vérifier leurs efficacités et insertions, définir leurs valeurs finales et réelles, leurs importances dans des dimensions mais générales, trouver des ressources et faire confluer d’autre vecteurs. Ou est ce grand royaume régi par des conseils de sages ; ou tous les habitants appartiennent à la cour, avec le même titre de noblesse : homo sapiens sapiens.
J’aimeJ’aime
Pingback: Entretien avec Jean-Clet Martin : « Toute ma philosophie est une philosophie du vivant qui tourne autour de l’empreinte » | Un Philosophe
Pingback: Entretien avec Jean-Clet Martin : « Néocriticisme, tel est le nom qui pourrait convenir au livre que j’ai fait autour de Ridley Scott » | Un Philosophe
Pingback: Entretien avec Jean-Clet Martin : « J’ai allégrement transgressé les bornes du criticisme par mon intérêt pour la science-fiction, pour le monstrueux et désormais pour l’image propre à la BD » | Un Philosophe