
Boethius (miniature)
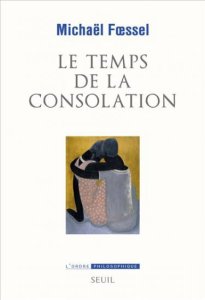
« Le Temps de la Consolation », Michael Foessel (Seuil/L’ordre philosophique)
« Le concept s’affaire toujours autour d’une blessure » écrivit, un jour, Jacques Derrida. C’est que le réel est tragique. Il est une plaie, mais le mouvement du concept sert à (ré)concilier, à refermer la plaie. La consolation pourrait être de ces concepts, ou du moins tel que l’établit le projet présenté dans Le temps de la consolation. Nous traversons, plus que jamais peut-être, une crise humaine, un temps marqué profondément par la détresse et le désarroi, d’où un regain philosophique envers la consolation. Michael Foessel, à traves son titre, propose bien dirait-on une solution : consoler. Consoler la tristesse des hommes, voilà une thèse qui est néanmoins poussée à contre-courant. Dans une époque où les populations réclament coûte que coûte des traitements de chocs, notamment dans la question politique la plus quotidienne, en se déplaçant vers l’intérêt et le soutien déraisonné des extrêmes en tout genre, penser la consolation est sans doute une originalité. Les contours du nouveau monde se dessinent parfois avec les pinceaux de l’ancien, dans la croyance que les larmes des temps passés ont définitivement séché. Une belle naïveté apparente émane, au sens positif du terme, de ce renouveau philosophique de la consolation – une sorte de Renaissance de la com-passion de la désolation.
Mais il nous semble que la détresse n’est pas le privilège des dernières décennies, à l’image de ce que Philippe Muray énonce : « Le réel, à toutes les époques, est irrespirable[1]». A cette froide désolation ambiante s’adjoint une bouillante ambiance de désillusion. Tout a déjà été essayé pour palier à la souffrance humaine, tout a été éclusé et récusé, mais la consolation en tant que telle fut délaissée, voire oubliée. Plus personne ne croit en la consolation : elle a (été) trop souvent déçue – certes moins dans les religions et les psychologies qui s’en donnent à coeur joie. Dans Le temps de la consolation, la faute se trouve, en partie, imputée à la modernité. Les Temps Modernes endossent le rôle de bouc-émissaire temporel, étant accusés d’être la figure paternelle qui a enfanté le vide et le chaos dans les valeurs établies. Aussi le texte de Foessel ne faiblit pas devant la tâche qui s’ouvre à lui de penser cette absence de pensée de la consolation de notre « postmodernité » – si tant est que cette dénomination ait du sens. Par-delà ces premières remarques, il convient de mettre en perspective et en interrogation le projet philosophico-politique que Foessel décrit.
Philosophique, car l’auteur reproche très justement à la philosophie d’avoir laissé le champ de la consolation aux religions et à la psychologie. Le talent premier de ce livre est de faire état du concept de « consolation ». Son déplacement se fait en marge de la philosophie, sur les seuils de porte des autres domaines de la pensée et de la croyance. Foessel nous donne à voir les croquis et les esquisses qui se donnent pour objectif de penser, sur une longue durée, la grande toile de la consolation de l’homme. Boèce, Sénèque, Hegel, Kant ou Heidegger colorent de leurs mots ces traits fins de la pensée. Tout est relu et revu à la lueur de la consolation. Cette réévaluation de la Tradition donne à comprendre à nouveaux frais des passages souvent clefs de textes fort classiques. Politique, car l’idée de départ a l’intention de re-mettre sur pied le geste d’une cohésion, celui de l’être-ensemble, au sens premier de la πολις : « le potentiel politique de la consolation réside dans l’affirmation qu’une autre voie existe[2] ». Même si le livre ne mentionne pas que la consolation est non seulement une « technique de soi[3] » qui, en elle-même, est toujours limitée au singulier. Le projet paraît humanitaire, tendant au général et à son intérêt. La proposition politique perd peut-être de sa force sur ce point : consoler c’est ré-affirmer la pré-dominance de l’individu, de sorte que la consolation ne s’envisagerait qu’à cette échelle. Peut-il y avoir réellement une consolation de la communauté ou de l’humanité dans sa totalité ? En effet, la consolation demande une proximité d’être-là, à être-là, et c’est sur ce point que surviennent les problèmes : consoler une présence singulière rend-il possible la consolation du monde entier de ce même geste ? Une politique de la consolation semble complexe, voire limitée. Foessel donne l’impression, après l’avoir effleurée abondamment en introduction, de délaisser peu à peu cette Idée politique, pour montrer (involontairement?) que la seule politique tenable historiquement et concrètement destinée à l’édification d’un être-ensemble aurait les formes dessinées et les couleurs plus vives de la réconciliation : « C’est pourquoi la modernité a engendré une exigence plus haute que celle de la consolation : la réconciliation. Nous appelons « réconciliation » le projet philosophique, mais aussi politique de triompher de ce que l’on a perdu[4] ». En dépit des reproches fort judicieux que marque Foessel vis-à-vis de cette forme de réconciliation, il expose peut-être malgré lui une réconciliation qui soit concrètement viable. Les pages tournent et la consolation, dans sa perspective politique, est laissée sur le bas-côté de l’utopie, au profit certes d’une analyse intéressante de sa narration, de son énonciation, de sa grammaire. Cette bifurcation en sous-sol du propos ouvre cependant une petite frustration au lecteur, à qui fut promis une authentique politique de la consolation.

Michael Foessel
Consolation n’est pas guérison : le texte le répète, à juste titre, dans plusieurs passages : « On console ce que l’on prétend ne pas savoir guérir[5] ». Ainsi, il n’y a pas de médecine de la consolation. Dans les premières pages du Gai Savoir, Nietzsche explique
attendre la venue d’un philosophe médecin, au sens exceptionnel de ce terme – et dont la tâche consistera à étudier le problème de la santé globale d’un peuple, d’une époque, d’une race, de l’humanité – qui un jour aura le courage de porter [s]on soupçon à l’extrême et d’oser avancer la thèse : en toute activité philosophique il ne s’agissait jusqu’alors absolument pas de trouver la « vérité », mais de quelque chose de tout à fait autre, disons de santé, d’avenir, de croissance, de puissance, de vie…[6]
On pourra le comprendre et Michael Foessel s’en explique : il ne sera donc pas apôtre de Nietzsche. La « grande santé » n’est pas envisagée ou considérée sous le concept de consolation. Pourquoi donc préférer la consolation à la guérison ? Car un homme malade ou en souffrance a besoin d’être soigné, pas de se faire consoler. C’est ici le moment de faire s’affronter peut-être deux conceptions, deux projets qui pourraient finir par s’accoupler. Il est vrai que Nietzsche regarde parfois d’un bon œil la consolation. Toutefois, il analyse, avec la virulence qui lui est propre, ce qu’elle vaut[7] : il repère deux étapes de la consolation. Le premier niveau décrit le sentiment de vengeance du dernier homme. Qu’est-ce à dire ? Tout homme malheureux décide d’en faire souffrir un autre, alors il est tenté de chercher le reste de puissance et se consoler avec le peu de pouvoir qui reste sur le monde qui l’entoure. Le second niveau estime le nouvel homme, le surhumain, c’est-à-dire que tout homme malheureux comprend son malheur comme une « punition[8] » et un moyen d’échapper en partie à sa destinée. Il cesse alors de vouloir faire souffrir autrui, car la découverte qu’il fait lui trouve une nouvelle satisfaction qui le console. La force de Nietzsche consiste à comprendre que la consolation est une étape de la guérison, mais que le corps [Leib] qui fait exister l’homme est le lieu qu’il faut guérir, en commençant par promouvoir la réhabilitation du corps. Rien ne sert d’être uniquement un médecin de l’âme dans la lignée d’Epicure : le philosophe doit se faire simultanément médecin du corps de l’homme souffrant. Foessel porte son attention aux « bleus » de l’âme, et tente de les affronter en réactivant les grands textes philosophiques et littéraires. Mais après ce très beau moment que constitue Le temps de la consolation, un temps de la guérison pourrait compléter le projet en travaillant l’approche corporelle et charnelle de la consolation. En ouvrant les champs de réflexion sur le chef d’œuvre de Jacques Derrida Le toucher, Jean-Luc Nancy, on trouverait l’occasion d’inscrire le rôle du corps dans la technique de la consolation.
De plus, si « l’indiscrétion à l’égard de l’indicible est probablement la tâche même de la philosophie[9] », mettre, (dé)poser des mots sur les choses, les événements, donne lieu, non pas unilatéralement à une consolation mais aussi à une guérison par la mise en signification d’un élément en apparence dépourvu de sens. Faire son deuil ne se fait pas uniquement par la consolation spirituelle de celui qui pleure, mais aussi par une guérison lente et profonde grâce à l’aspect performatif des mots sur le corps et notre sensibilité propre. Dès lors, Foessel ne soupçonne peut-être pas assez le consolateur, il le prend trop vite comme un personnage bien intentionné, non sans se méfier des belles paroles psychologisantes. Et il a, de son point de vue, de bonnes raisons. Néanmoins, consoler n’est-il que l’acte purement destiné vers l’autre-souffrant? Posons ici un argument polémique pour ouvrir une discussion, née du livre et du propos de Foessel, intéressant, nécessaire, disons en guise de prolongement, de voisinage. La consolation ne serait-elle pas en réalité à la guérison, ce que l’indignation est à la révolte, dans la mesure où elle donnerait bonne conscience sans changer activement le réel, sans jamais guérir ? Le souffrant continuera à souffrir, qu’importe la consolation. Cette critique cynique propose de concevoir que la consolation est une conservation : elle aide à faire passer la pilule – la pilule passe tout de même. Nous serions, de facto, tentés de dire que le consolateur console pour lui-même et non pas pour autrui ; autrement dit, elle n’est en rien « un apprentissage de l’altérité[10] », elle se maquillerait plutôt comme telle. On aimerait donc risquer une question dans la foulée d’une enquête extrêmement instruite : Si guérir est une tâche à l’ambition sans égal, consoler se montrerait peut-être trop, dans cette perspective nietzschéenne, comme une tromperie envers l’autre. Alors la philosophie comme consolation devient une antiphilosophie. Pourquoi donc ? Si la philosophie est une quête de la vérité, et la consolation un heureux mensonge, alors la philosophie comme consolation serait une « science » du mentir-pour-guérir. C’est pourquoi Schopenhauer, rejoint Nietzsche, en écrivant ceci : « ma philosophie est sans consolation ; et simplement cela parce que je dis la vérité[11] ». Derrière cette provocation se dissimule une possible contradiction formelle de penser une érection de la philosophie en tant que méthode de consolation dont Foessel va envisager avec toute la précision requise le rayonnement, la longue histoire qui en produit le sens.
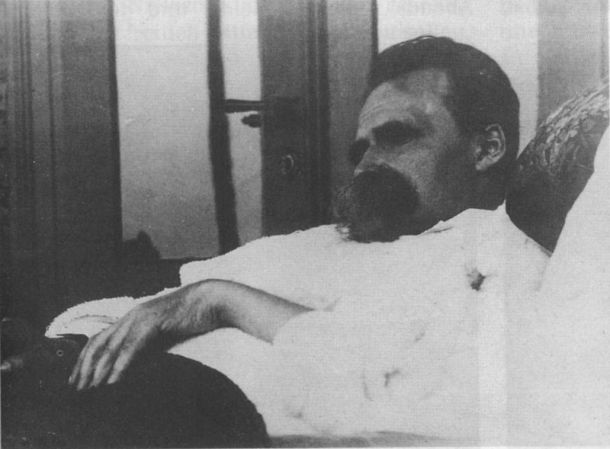
Friedrich Nietzsche
La consolation permettrait certes de remplir le vide que notre ère construit inlassablement. La désolation de la « modernité » est marquée par la perte de quelque chose : la question du progrès intervient, retrouvant ce que dit Compagnon à son propos : « Pour ma part, je pense qu’il est juste d’avancer sans omettre de regarder dans le rétroviseur. C’est prudent et sensé. Comme ces écrivains [ndlr, Baudelaire, Barthes…], j’estime que tout progrès implique un regret[12] ». Ce vide, disons-le cette fois-ci sans cynisme, a été comblé par le divertissement : se divertir pour oublier et ne pas regretter, c’est-à-dire se consoler. L’homme se console, bon gré mal gré, par le divertissement, même si celui-ci est refusé catégoriquement par Michael Foessel, peut-être contre Pascal. Dans ses Pensées, Pascal (pré)voit avec précision le vide et l’angoisse – Heidegger l’existentialise – comme étant respectivement rempli et détourné par le divertissement : « Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n’y point penser[13] ». Qu’il fustige aussi le divertissement sur un autre front, cela n’empêche pas que Pascal est, ici, nietzschéen, en décrivant le besoin d’oubli de l’humanité pour pouvoir survivre aux douleurs spirituelles et physiques de la Mémoire, et les consoler véritablement. La mémoire de l’oubli apparaît comme la condition sine qua none de la grande consolation. Puisque Foessel parle des temps présents, il faut alors considérer que son temps de la consolation lutte directement contre notre temps de la consommation qui, pis, n’est pas même un divertissement. Consommer pour se consoler, là se tient la tragique réalité de notre époque : consommer permet de compenser notre refus de penser. L’ « homme moderne » se console avec les objets et les mots qui servent à guérir, comme c’est le cas des psy–chanalyse, –chiatrie –chologie, auxquelles Foessel cherche, avec vigueur, à dénier la vertu consolatrice pour procéder avec talent à une refondation de la consolation ouverte à la philosophie. Le livre peut déboucher ainsi sur de justes soupçons, sur une critique de certaines sociologies politico-historiques, qui interrogeraient les fonctions du retour du religieux, après la mort des grandes idéologies qui avaient servi de consolation au XXème siècle. En bref, Le temps de la consolation se présente comme un brillant et érudit répertoire philosophant des occurrences fondamentales de la pensée de la consolation dans l’histoire de la philosophie, de Platon à nos jours. De beaux « intermèdes » littéraires ponctuent le texte, mettant en scène la pratique de la consolation. Ces pages ouvrent, avec prudence, un projet politique, pensant une exclusion de la consolation hors du religieux et du tout-psychologique, dans la naissance d’un espoir peut-être vain, de réinscrire la philosophie dans une ancienne modalité de son rôle social. Ce qui en tout cas fait l’équivoque autant que l’intérêt du livre.
© Jonathan Daudey
Retrouvez cette recension d’abord publié sur Strass de la philosophie en cliquant ICI
Notes :
[1] Muray, Philippe. Festivus Festivus
[2] Foessel, Michael. Le temps de la consolation. Seuil, L’ordre philosophique, p. 27
[3] Ibid, p. 13
[4] Ibid, p. 225
[5] Ibid, p. 10
[6] Nietzsche, Friedrich. Le Gai Savoir, Préface, §2
[7] Nietzsche, Friedrich. Aurore, §15
[8] Ibid.
[9] Levinas, Emmanuel. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, chap. 1
[10] Foessel, Michael. Le temps de la consolation, p. 25
[11] Schopenhauer, Arthur. Pensées et fragments, repris dans Foessel, Michael. Le temps de la consolation. Op. cit., p. 223
[12] Entretien avec Antoine Compagnon, in PHILITT : http://philitt.fr/2015/02/05/entretien-avec-antoine-compagnon-tout-progres-implique-un-regret/
[13] Pascal, Blaise. Pensées, éd. Le Guern, p. 126